vendredi, 16 septembre 2022
Hégémonie et contre-hégémonie de la norme juridique : vers une théorie juridique multipolaire

Hégémonie et contre-hégémonie de la norme juridique: vers une théorie juridique multipolaire
par Valentin Krotov
Source: https://www.ideeazione.com/egemonia-e-contro-egemonia-della-norma-giuridica-verso-una-teoria-giuridica-multipolare/
Si nous parlons d'hégémonie dans la politique mondiale, nous ne pouvons actuellement pas prendre l'influence hégémonique en considération sans aborder, en même temps, les mécanismes juridiques de l'hégémonie.
À cet égard, la théorie de Gramsci parle de l'exploitation spirituelle et culturelle de la classe ouvrière (du prolétariat) à travers des valeurs "bourgeoises", contribuant ainsi à l'embourgeoisement du prolétariat. De la même manière, la philosophie européenne, l'anthropologie européenne et la culture européenne sont devenues la source du droit international, de ses principes et de ses normes.
La formation du droit international dans sa forme moderne est un processus relativement récent. De plus, il n'y a pas si longtemps, dans les relations juridiques internationales, il y avait une division directe des peuples en "civilisés" et "non civilisés". Ce n'est que depuis l'adoption de la Charte des Nations unies en 1945 et jusqu'à ce jour que nous assistons à un ressac de l'arrogance directe des fondateurs du système moderne de relations internationales.
À cet égard, la théorie de l'origine du droit international a longtemps prévalu, selon laquelle le droit international s'est formé entre le 13ème et le 16ème siècles et s'est perfectionné en 1648 avec la paix de Westphalie, puis s'est étendu à d'autres nations et civilisations non européennes.
La nature néocoloniale du droit international est également toujours présente, car le modèle du système juridique international, dans son ensemble, est construit sur la logique civilisationnelle des États d'Europe occidentale.

La principale source du droit international est le traité international. La signification conceptuelle d'un traité international est que les sujets des relations internationales (les États) expriment mutuellement et librement leur volonté.
À son tour, l'État, en tant que partie d'un traité international, est un individu collectif (une personnalité internationale). Par conséquent, l'ordre international établi se présente comme le résultat d'un traité entre plusieurs États.
Si l'on regarde à travers le prisme de l'histoire et de la philosophie européennes, avant l'établissement de l'ordre mondial et du nouveau système de relations internationales, il y avait une "guerre de tous contre tous" (selon Thomas Hobbes).
Ainsi, dans les relations internationales avec leur structure conventionnelle (multilatérale) de traités internationaux, les idées de Thomas Hobbes, exposées dans son célèbre ouvrage Léviathan, ont été mises en œuvre.
Par conséquent, le droit international moderne est inconcevable sans la mise en conformité des systèmes juridiques nationaux avec les mêmes normes juridiques. Nous constatons que le droit international est plus que visiblement influencé par la philosophie européenne, c'est-à-dire que le droit international est un droit issu de l'ontologie européenne.

Montrons certaines des origines conceptuelles du droit international moderne.
1) Thomas Hobbes et la théorie du contrat social.
L'orientation anti-guerre du droit international moderne remonte au Pacte de Paris de 1928, un traité qui renonce à la guerre comme instrument de politique nationale. Le traité a été initié par le ministre français des Affaires étrangères Aristide Briand et le secrétaire d'État américain Frank Kellogg.
En particulier, l'activiste Jameson T. Shotwell incite Briand à conclure le traité anti-guerre. Shotwell a grandi dans une famille de quakers. Les Quakers étaient connus pour leur rejet de toute forme de violence et pour leurs vastes activités sociales visant à promouvoir les idéaux d'humanisme et de pacifisme dans la société.
Ainsi, une partie importante de la base du droit international reposait sur une option religieuse propre au christianisme occidental modernisé.
La base juridique de la sécurité internationale globale a finalement été institutionnalisée dans la Charte des Nations unies, qui proclame les principes garantissant le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'existence indépendante des États et le développement de la coopération internationale.
Aujourd'hui, les normes juridiques internationales sont l'incarnation du concept de stabilité hégémonique.
La version libérale de ce concept présente l'hégémonie comme un instrument de stabilité de l'ordre international et de sécurité internationale ; la destruction de cette stabilité, selon les idéologues libéraux, conduit à de nouvelles déstabilisations et à des guerres.
Par exemple, l'affaiblissement de l'hégémonie britannique a conduit à la déstabilisation de l'ordre international. Cette affirmation est étayée par les événements de la guerre mondiale de 1914, l'établissement de régimes fascistes en Europe et la Seconde Guerre mondiale. La prise de l'hégémonie mondiale par les États-Unis a conduit à la création du système de sécurité international actuel.
Le caractère libéral de l'hégémonie américaine souligne le fait que cet ordre mondial s'est positionné comme rationnel et le seul possible.
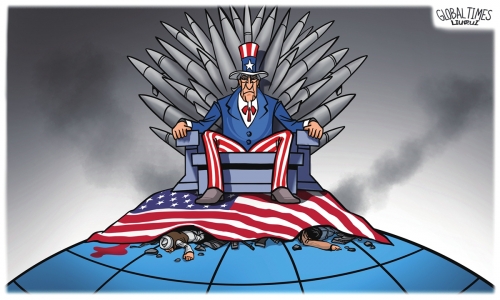
Depuis lors, la solution militaire des problèmes politiques est devenue d'importance secondaire, car l'agression ouverte est interdite par le droit humanitaire international, mais elle permet en fait de nouvelles méthodes d'expansion de l'influence grâce à la technologie des réseaux [1].
Dans le même temps, l'hégémon représenté par les États-Unis se permet d'ignorer les normes du droit humanitaire international, spéculant sur les valeurs de la démocratie et de la stabilité internationale tout en menant des interventions militaires, utilisant même les forces armées de l'Alliance de l'Atlantique Nord.
Cependant, l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine a suscité une forte condamnation de la part du bloc occidental parmi les pays de l'ONU et un blocus économique sans précédent, qui ne correspond en rien au droit économique international, mais constitue un outil politique anti-juridique dans la lutte pour le maintien de l'hégémonie.
2) L'établissement du capitalisme international comme norme économique mondiale.
Au début de la nouvelle ère de l'économie internationale, le passage de la coopération bilatérale entre États à la coopération multilatérale a joué un rôle important.
L'émergence de traités internationaux multilatéraux (conventions) est un trait distinctif de la forme moderne de la mondialisation, qui a contribué à la création de principes et de normes communs pour réglementer les relations du marché mondial.
Le développement de la mondialisation est directement lié à la propagation de l'économie de marché, qui a remplacé le système de commande et de contrôle établi dans les pays du bloc socialiste. Un facteur direct de la propagation de la mondialisation est l'effondrement de l'URSS et du bloc des États socialistes.
C'est ainsi que gagne le capitalisme mondial, qui dictera dorénavant ses conditions au monde entier.
Le principe de base de la mondialisation des marchés est le respect des "quatre libertés": la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d'œuvre. La convergence des marchés donne naissance à des sujets interétatiques de droit international, qui créent un cadre juridique commun pour la coordination de la politique économique.
Les théoriciens libéraux du capitalisme international affirment que l'existence d'un État hégémonique libéral est l'une des conditions fondamentales du plein développement de l'économie de marché mondiale.
Au fil du temps, le développement du capitalisme mondial est devenu de plus en plus centralisé.

Ainsi, en 1947, les États-Unis ont lancé l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui est devenu la base de la formation d'une immense zone de libre-échange. De plus en plus de pays à l'esprit libéral ont rejoint la zone.
Entre autres choses, l'intégration politico-juridique est nécessaire parce que les États-nations perdent leur capacité effective à exercer un contrôle sur les marchés des matières premières et les marchés financiers qui ont depuis longtemps dépassé un certain territoire [3].
L'hégémonie capitaliste mondiale prend ainsi forme.
La justification éthico-juridique de cette hégémonie est la théorie des droits de l'homme, qui se veut universelle à l'échelle mondiale.
3) Les droits de l'homme en tant que doctrine politique et juridique hégémonique.
La doctrine moderne des droits de l'homme remonte à la Renaissance (14ème et 16ème siècles). Au cours de cette période, le concept d'humanisme a commencé à émerger, dans lequel le libre arbitre et la dignité de l'homme ont commencé à être interprétés comme expression de la bonté et de la ressemblance avec Dieu. L'âme est présentée comme quelque chose d'inconditionnellement noble et pur. L'homme est considéré comme déjà sauvé et rien ne peut défaire son salut. L'homme est ainsi placé au centre de l'univers et acquiert, du point de vue du droit, un statut juridique différent.
Les idées d'empirisme et de mécanisme comme forme de philosophie séculaire ont gagné en popularité dans le Nouvel Âge.
Empirisme - "philosophie de l'expérience", cette doctrine reconnaît l'expérience sensuelle de l'homme comme le seul moyen de connaître le monde. En tant que tel, il rejette le caractère sacré et l'expérience de la révélation.
Mécanisme - l'idée que la structure du monde est comme une machine globale.
Dès lors, le mécanisme et l'empirisme de la modernité contribuent à la désacralisation du monde et de l'homme (l'homme est un microcosme).
"La place de Dieu dans le monde, c'est l'esprit dans l'homme, la place de la matière dans le monde, c'est la place du corps en nous." - Sénèque, Lettres, 65, 24.
L'homme, quant à lui, est perçu comme un mécanisme et, en tant que tel, perd progressivement, au fil de l'histoire, sa subjectivité.
La personne est remplacée par un individu, et c'est l'individu qui devient le sujet des relations juridiques et aussi du droit international.
Toutes les notions conceptuelles (dignité humaine, droits de l'homme, valeur de l'individualité de chacun) ont une signification abstraite et donc purement technique.
La définition, le statut juridique et la signification de l'individu dépendent de l'évolution des circonstances politiques et des approches de l'interprétation du droit international.
La méthode doctrinale d'interprétation du droit, largement utilisée dans le droit international des droits de l'homme, permet d'interpréter les normes juridiques en fonction des tendances politiques immédiates.
C'est ainsi, par exemple, qu'est apparu le discours sur les "droits des LGBT", qui a été conceptuellement dérivé de la théorie générale des droits de l'homme et en est ensuite devenu une partie intégrante.
Les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
Ce sont ces deux documents qui constituent la base juridique de la création des garanties des droits de l'homme.
En élargissant la portée de ces textes, les instances internationales ont ainsi fait de l'homosexualité, déjà protégée par le droit international, un sujet de notoriété publique.
Le résultat est que le processus de normalisation de l'homosexualité, propre à la civilisation occidentale, est désormais au centre du discours du droit international.
À cet égard, nous portons notre attention sur la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations unies. En particulier, dans les affaires Toonen contre l'État de Tasmanie et Young contre l'Australie de 1992. Ces deux cas sont parmi les premières preuves officielles de l'existence d'un discours légalisé sur les relations homosexuelles.
En général, le discours sexuel est un sujet public depuis la révolution sexuelle aux États-Unis et en Europe (dans les années 1960 et 1970). La sexualisation de la société occidentale a fait entrer le côté intime des relations humaines dans la sphère publique et, comme nous l'avons vu dans la pratique du Comité des droits de l'homme de l'ONU, dans la sphère des relations internationales.
La participation d'un État à des groupements interétatiques a également pour effet de transférer certains de ses pouvoirs souverains. Cependant, aujourd'hui, la source des obligations internationales ne réside pas seulement dans les décisions juridiques des organes interétatiques, mais aussi dans les interprétations des normes des traités internationaux, qui constituent ensuite l'ordre juridique de l'État à travers les positions interprétatives des organes interétatiques, souvent les tribunaux. L'un de ces organismes est la Cour européenne des droits de l'homme.

En outre, la Cour européenne des droits de l'homme se considère autorisée à adapter les droits de l'homme reconnus en fonction de l'évolution de la société européenne, ce qui peut conduire à la reconnaissance de droits qui ne sont pas directement inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [4].
À partir de la jurisprudence du Comité des droits de l'homme de l'ONU et de la Cour européenne des droits de l'homme, nous observons le phénomène de l'hégémonie juridique des États d'Europe occidentale. Cela se produit lorsque les particularités morales, éthiques et juridiques d'une civilisation particulière sont présentées comme communes à l'ensemble de la communauté mondiale, ce qui ne correspond pas au principe de l'égalité souveraine des États et aux particularités socioculturelles des différentes civilisations.
L'arrogance ontologique des architectes de l'ordre international traverse tout le système du droit international.
La communauté internationale se positionne comme la communauté exclusive, tandis que tous les autres États qui ne font pas partie de la Déclaration occupent une position inclusive. L'un des principaux mécanismes d'hégémonie en droit international est donc le prestige. Le prestige en tant que catégorie sociologique peut également être considéré dans le contexte du droit international.
A l'aube de la création des Nations Unies (la Société des Nations), l'anthropologue américain Melville Hescovitz et un groupe de scientifiques de l'American Anthropological Association ont publié un mémorandum, exprimant leur opinion sur le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. "La déclaration devrait être fondée sur des normes universelles de liberté et de justice, sur la base du principe selon lequel <...> un homme n'est libre que s'il peut vivre à la hauteur de la conception acceptée de la liberté dans sa société" [5]. La déclaration est donc fondée sur le principe selon lequel <...> un homme n'est libre que s'il peut vivre à la hauteur de la conception acceptée de la liberté dans sa société.
Ainsi, alors que dans la théorie de l'hégémonie classique de Gramsci, la classe dominante veut convaincre toutes les autres classes qu'elle est fondée sur un consensus de classe (l'état du tout), le droit international moderne part du principe qu'il est le destin et le droit de toute l'humanité.
Cette stratégie du droit international, renforcée par les résultats bien connus de la guerre froide, a transformé toute la réalité géopolitique.
La Russie dans le contexte juridique international
En 1991, l'Union des républiques socialistes soviétiques a cessé d'exister et le Pacte d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle (Pacte de Varsovie) a été dissous.
Le monde bipolaire a donc cessé d'exister. Pour la même raison, la confrontation entre les deux approches du statut de la propriété, de la démocratie et du droit a cessé.
La défunte Union soviétique, puis la Fédération de Russie, ont signé un certain nombre d'instruments juridiques internationaux importants dans le domaine de la politique et des droits de l'homme, s'intégrant ainsi au contexte juridique et idéologique de l'Europe.
Ainsi, le parlementarisme, la démocratie légale des partis et le capitalisme sont devenus partie intégrante du système politique et économique de la nouvelle Russie.
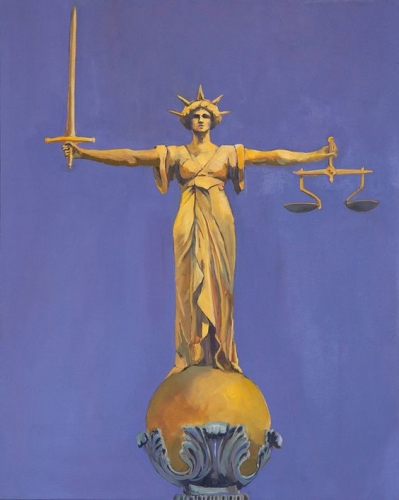
La définition de notre État comme "État de droit" a établi un vecteur précis pour l'ensemble du système politico-juridique de la Fédération de Russie. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, nous subordonnons le système politique de notre État à l'ordre juridique international (directement ou indirectement par le biais d'une législation nationale fondée sur des principes et des normes juridiques internationaux).
Cependant, l'Union soviétique s'est engagée sur la voie de l'intégration éthico-juridique avec l'Europe occidentale dès 1966, lorsqu'elle a signé les premiers documents internationaux dans le domaine des droits de l'homme : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Depuis lors, de la perestroïka jusqu'à récemment, la Russie a fusionné avec le monde global dans le contexte éthique et juridique.
L'ensemble du système constitutionnel, et par conséquent la législation sectorielle, est construit en fonction de ces obligations juridiques internationales.
En d'autres termes, l'ensemble du système juridique public et privé était fondé sur les valeurs et les idéaux politiques occidentaux. Cela est resté le cas aujourd'hui, mais a récemment commencé à évoluer vers la souveraineté de l'esprit-valeur, et donc du système juridique.
La situation a changé radicalement avec le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Le déclenchement des hostilités a mis en évidence les contradictions entre la Russie et les pays d'Europe occidentale. L'une des conséquences du conflit a été le retrait de la Fédération de Russie du Conseil de l'Europe (une décision de j ure a été prise par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe d'expulser la Fédération de Russie de l'organisation).
Le retrait de la Fédération de Russie de l'organisation pourrait, d'une certaine manière, servir à construire un modèle d'institutions étatiques et juridiques sur une base fondamentalement différente. En outre, le modèle existant présente des inconvénients importants, qui font l'objet de recherches par certains universitaires nationaux.
Le professeur Y. I. Skuratov, récipiendaire du titre de docteur en jurisprudence, conclut que "l'emprunt des institutions étatiques et juridiques occidentales, l'idéologie politique et juridique libérale sont devenus l'une des raisons de la déstabilisation du système juridique et politique national, de l'augmentation de la criminalité, de l'aliénation des gens vis-à-vis du gouvernement et de l'État... La modernisation de la société russe dans le courant de l'occidentalisation a causé de graves dommages à la culture juridique nationale..." [6].
À la lumière de la restructuration globale de l'ensemble de l'ordre mondial et de la destruction du modèle unipolaire, il est nécessaire de développer une nouvelle théorie juridique qui soit pertinente dans un monde multipolaire [7].
Vers une théorie juridique multipolaire
Les idées d'un autre marxiste célèbre (outre le susmentionné Antonio Gramsci), Georg Lukacs, peuvent être pertinentes pour la formation d'un droit mondial multipolaire.
Ce philosophe a largement contribué au développement du concept de conscience de classe.
Lukacs a présenté la conscience de classe comme un système de croyances partagé par ceux qui appartiennent collectivement à une classe socio-économique particulière.
Lukacs a également souligné que la conscience de classe n'est pas la conscience agrégée des individus d'une classe particulière, mais la conscience intégrale d'un groupe de personnes partageant la même position de classe.
D'autre part, le concept de conscience de classe dans le capitalisme selon Lukacs implique la présence d'une fausse conscience dans le prolétariat. Ces derniers n'ont pas une idée claire de leurs véritables intérêts et ne comprennent pas leur véritable position socio-historique et économique.
Tout comme la fausse conscience du prolétariat selon Lukacs, les peuples du monde moderne se trouvent aujourd'hui dans une fausse conscience, qui a abandonné sa propre identité afin de s'intégrer au système politique et juridique moderne.
Ainsi, la fausse conscience des peuples non-européens inclut le libéralisme en général et, en particulier, sa doctrine éthico-juridique des "droits de l'homme".
Il est possible d'opposer à la fausse conscience des peuples non-européens une "conscience de civilisation" qui correspondrait organiquement au code géopolitique, historique et culturel-religieux d'une civilisation particulière.
Il convient de noter que la base de la formation d'un ordre juridique multipolaire existe depuis des milliers d'années sous la forme des traditions juridiques de divers États et civilisations.
Pendant de nombreux siècles, de nombreuses régions du monde ont eu leur propre vision de l'homme, de la propriété, du crime et de la punition, qui s'est développée indépendamment du système juridique romano-germanique, mais elles disposaient en même temps d'institutions juridiques autonomes qui régulaient organiquement les relations sociales dans les sociétés non-européennes.
Notes:
[1] Voir pour plus de détails : Savin L.V. "Network-centric and Network Warfare. Une introduction au concept".
[2] Giplin R. L'économie politique des relations internationales. Princeton : Princeton University Press. 1987. 85.
[3] Ohmae K. La fin de l'État-nation : l'essor des économies régionales. N.Y., 1995 ; Scholte J.A. Globalization, First edition : A Critical Introduction. N.Y., 2000.P. 211-215.
[4] Voir : Mathieu B. Trouver un équilibre entre la protection de l'identité nationale et le respect des obligations internationales : la liberté d'expression face à des défis surmontables // Journal of Foreign Law and Comparative Law. 2021. Т. 17. № 1. С. 20 - 21.
[5] Déclaration des droits de l'homme, soumise à la Commission des droits de l'homme des Nations unies par le Comité exécutif de l'American Anthropological Association // American Anthropologist. 1947. № 49. P. 541.
[6] Skuratov Y. I. La nature eurasienne de la Russie et certains problèmes modernes de développement des institutions juridiques de l'État. - Ulan-Ude, 2012.
[7] Voir en détail : Dugin A. G. Théorie du monde multipolaire. Pluriversum. Tutoriel. - 2015.
15:21 Publié dans Actualité, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : droit, constitution, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 15 septembre 2022
L'espace instable entre l'ancien et le nouvel ordre
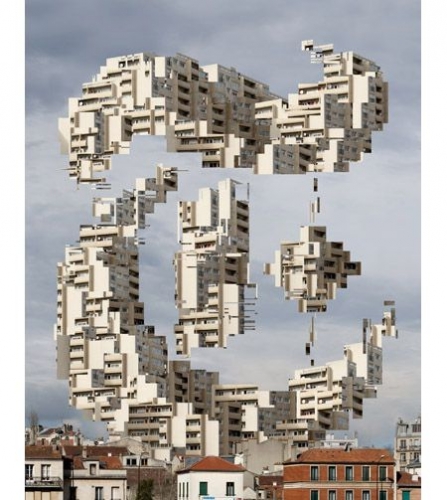
L'espace instable entre l'ancien et le nouvel ordre
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/09/13/vanhan-ja-uuden-jarjestyksen-epavakaa-valitila/
Selon le diplomate et universitaire indien Shivshankar Menon, "une sorte d'anarchie se glisse dans les relations internationales" - non pas l'anarchie au sens strict du terme, mais plutôt "l'absence d'un principe central d'organisation ou d'un hégémon".
"Les États-Unis ont mené deux ordres après la Seconde Guerre mondiale", divise Menon (photo). Premièrement, "un ordre keynésien qui ne s'intéressait pas particulièrement à la manière dont les États géraient leurs affaires internes dans un monde bipolaire de guerre froide".
Dans les années 1990, c'était le tour de "l'ordre néolibéral dans un monde unipolaire", dans lequel une Amérique puissante ignorait complètement la souveraineté nationale et les frontières nationales des autres États quand elle le voulait.
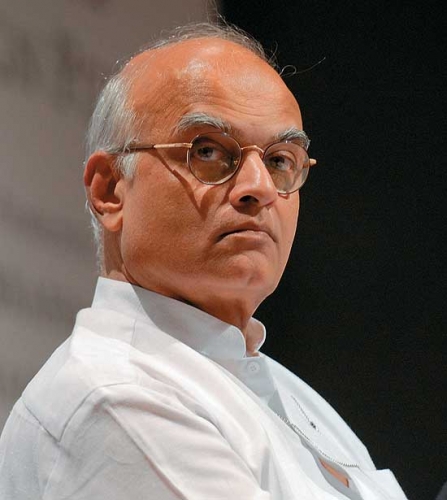
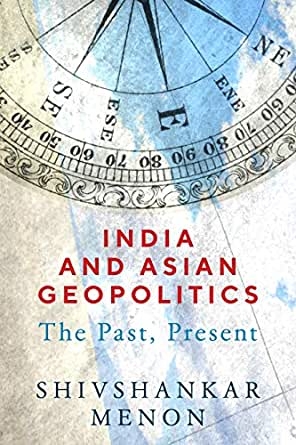
Les deux ordres ont affirmé être "ouverts, fondés sur des règles et libéraux" et ont prétendu "défendre la démocratie", les soi-disant "valeurs du libre marché, les droits de l'homme et l'État de droit".
En réalité, ils étaient fondés sur la "domination et la coercition militaires, politiques et économiques" des États-Unis. Dans l'ère post-soviétique, la plupart des grandes puissances, y compris la Chine émergente, ont suivi, du moins dans une certaine mesure, les règles truquées de l'ordre dirigé par l'Occident.
Mais les événements de ces dernières années laissent penser que cet arrangement appartient au passé. Les grandes puissances, y compris les États-Unis, se comportent désormais, selon Menon, de manière "révisionniste", c'est-à-dire qu'elles poursuivent leurs propres objectifs au détriment de l'ordre international.
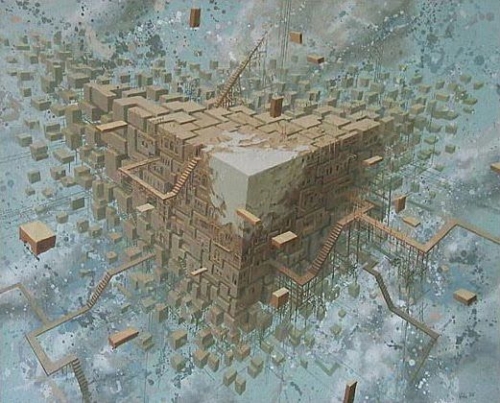
Ce révisionnisme se manifeste souvent par des différends territoriaux, comme ceux qui opposent la Chine à ses voisins, l'Inde, le Japon, le Vietnam et d'autres pays de la région maritime asiatique, et le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est renforcée par l'alliance de l'OTAN.
Selon Menon, le révisionnisme se reflète également dans les actions de nombreuses autres puissances, "comme la suspicion croissante à l'égard du libre-échange aux États-Unis, le renforcement militaire d'un Japon autrefois pacifiste et le réarmement de l'Allemagne".
De nombreux pays sont mécontents du monde tel qu'ils le voient et cherchent à le changer à leur avantage. Cette tendance pourrait conduire à une géopolitique plus conflictuelle et à des perspectives économiques mondiales plus faibles.
Menon estime qu'à l'heure actuelle, "le monde est à la dérive". Dans l'espace instable actuel entre l'ancien et le nouvel ordre, les grandes puissances n'adhèrent plus à des principes et des normes clairs (on peut se demander si elles l'ont jamais fait).
De nombreux autres pays suivent leur propre voie. Le "principe de la souveraineté des États" est désormais invoqué pour mener une politique fondée sur la préférence des États, plutôt que la politique "fondée sur les valeurs" mise en avant par l'Occident (qui est, après tout, très fausse).
Ces dernières années, les États-Unis ont cultivé la rhétorique trompeuse selon laquelle le monde serait à nouveau défini par une confrontation entre deux blocs - le "monde libre" dirigé par l'Occident et les "États autocratiques". Les États soumis aux sanctions occidentales ont formé des partenariats stratégiques entre eux.
Alors que les anciennes normes et institutions s'érodent, des caractéristiques autoritaires sont déjà évidentes dans de nombreuses démocraties. Cette tendance s'est accélérée à l'époque de la pandémie, lorsque des restrictions à la libre circulation des personnes ont été imposées en raison de la crise sanitaire. "Les lois et règlements élaborés dans les circonstances exceptionnelles de la 'nouvelle normalité' permettent de renforcer le contrôle de l'État à l'avenir.
L'économie mondiale globalisée se fragmente en blocs commerciaux régionaux et la concurrence pour les avantages économiques et politiques entre les grandes puissances s'intensifie. Les pays doivent apprendre à se débrouiller dans cet entre-deux et se préparer à un avenir incertain.
"Une solution consiste à se tourner vers l'intérieur", analyse Menon. La Chine, l'Inde, les États-Unis et bien d'autres pays l'ont fait ces dernières années, en soulignant d'une manière ou d'une autre leur autosuffisance: la "stratégie de double circulation" de la Chine, la promesse de M. Biden de "reconstruire en mieux" et l'engagement de l'Inde, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, en faveur de l'aatmanirbharta, ou autosuffisance, en sont des exemples.
Si les pays veulent devenir plus indépendants économiquement, ils veulent aussi être mieux préparés militairement. Toutes les grandes puissances ont cherché à étendre leurs capacités de défense. Malgré les conséquences économiques de l'ère pandémique, les dépenses mondiales de défense ont dépassé les deux mille milliards de dollars pour la première fois en 2021.
Selon un professeur indien, une autre réponse à la situation actuelle est que les États forment des "coalitions ad hoc". La dernière décennie a vu l'émergence d'un certain nombre d'arrangements multilatéraux, tels que la Quad Alliance, les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai et le regroupement I2U2 de l'Inde, d'Israël, des Émirats arabes unis et des États-Unis.

Chaque problème semble donner lieu à un nouvel acronyme. Ces arrangements servent des objectifs géopolitiques spécifiques et, bien qu'ils puissent contribuer à renforcer les relations bilatérales entre certains pays, ils ne se rapprochent pas des groupements de l'époque de la guerre froide.
De nombreux États de taille moyenne ou plus petite franchissent inévitablement les lignes de démarcation et cherchent à équilibrer leurs relations avec les grandes puissances. La réaction de l'alliance des pays d'Asie du Sud-Est (ASEAN) aux différends entre les États-Unis et la Chine et le développement des relations entre Israël et les monarchies sunnites du Golfe par le biais des "pactes abrahamiques" sont des exemples de cette tendance.
Plus récemment, de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ayant des liens étroits avec l'Occident ont résisté à l'envie de rejoindre le front des sanctions anti-russes, alors que le conflit gelé en Ukraine se réchauffait à nouveau. Ces pays ne manifestent pas automatiquement de la sympathie pour le jargon cynique sur les "valeurs" propagé par l'Occident.
Cet équilibrage et cette couverture encouragent la recherche de solutions locales aux problèmes locaux, qu'il s'agisse d'accords économiques et commerciaux régionaux ou de solutions négociées aux différends politiques. Le processus de mondialisation, qui estompe les frontières, est-il en train de se retourner contre nous ?
Si les grandes puissances remettent bruyamment en question la sagesse de l'ancien ordre, les pays plus faibles ont déjà perdu la foi en la légitimité et l'équité de "l'ordre international fondé sur des règles".
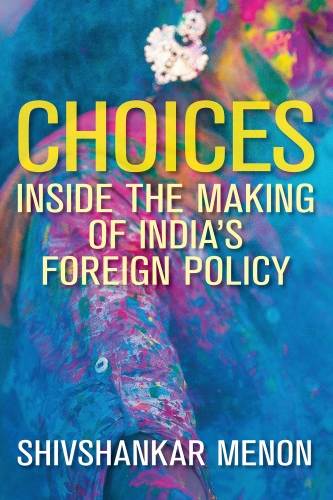
C'est particulièrement vrai pour les pays du Sud, qui ont vu l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, le G20 et autres échouer dans leurs efforts. Aujourd'hui, plus de 53 pays sont menacés par une grave crise de la dette.
Alors que l'ancien ordre se désintègre et que le nouveau peine à émerger, le Prof. Menon estime que "les pays ayant une compréhension claire de l'équilibre des pouvoirs et une vision d'un ordre futur coopératif qui sert le bien commun auront un avantage".
Il est peu probable que l'équilibre des pouvoirs, qui évolue rapidement, fournisse la base d'un nouvel ordre stable avant un certain temps. Menon prévoit que les grandes puissances "se déplacent de crise en crise au fur et à mesure que leur insatisfaction à l'égard du système international et que la méfiance des unes à l'égard des autres grandit, comme une sorte de mouvement sans mouvement".
Le penseur indien est pessimiste quant à l'avenir. Menon note que "la capacité des grandes puissances s'est affaiblie en termes de gestion des relations étrangères, de gestion des crises, ou de capacité à résoudre les problèmes transnationaux".
Étant donné que les conclusions de Menon sont publiées dans Foreign Affairs, un journal du groupe de réflexion "Council on Foreign Relations" fondé par David Rockefeller, on peut se demander s'il ne suggère pas également que la solution réside dans une "gouvernance mondiale plus centralisée".
22:05 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, instabilité, ordre mondial, shivshankra menon, inde, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 12 septembre 2022
L'alternative eurasienne: la vision d'Alexandre Douguine pour l'ère post-américaine

L'alternative eurasienne
Lectures à méditer : la vision d'Alexandre Douguine pour l'ère post-américaine
A propos de l'édition allemande de "Mission Eurasie"
Karl Richter
Il y a quelques semaines, le journaliste, philosophe et géopoliticien russe Alexandre Douguine s'est brièvement retrouvé sous les feux de l'actualité dans son pays, lorsque sa fille Daria a été victime d'un attentat à la bombe non loin de Moscou en août.
Dans ce contexte, les médias occidentaux ont qualifié à plusieurs reprises Douguine, né en 1962, d'homme qui murmure à l'oreille des puissants, voire qui serait le "cerveau de Poutine" ("Putin's brain"). C'est sans aucun doute exagéré. Ce qui est vrai, c'est que Douguine, qui s'était déjà fait un nom dans la Russie post-soviétique dans les années 1990 en tant que penseur patriotique et révolutionnaire, était au tournant du millénaire le conseiller de Gennady Selesnov, alors porte-parole de la Douma.
Dans les années qui ont suivi la fin de l'Union soviétique, il a été l'un des premiers à évoquer le concept d'un ordre mondial "multipolaire" comme alternative au "One World" dominé par les États-Unis, concept que la politique étrangère russe a également adopté à l'époque. Au fil des années, Douguine a élargi son approche à la philosophie, voire à la spiritualité, et il est considéré aujourd'hui en Russie comme un éminent inspirateur d'idées. Il est également vrai que la politique étrangère russe suit depuis quelques années un cours de plus en plus "impérial", qui tient compte des nécessités géopolitiques. Douguine, qui a publié une douzaine de livres et d'innombrables articles dans des revues depuis les années 1990, a sans aucun doute contribué à cette évolution.
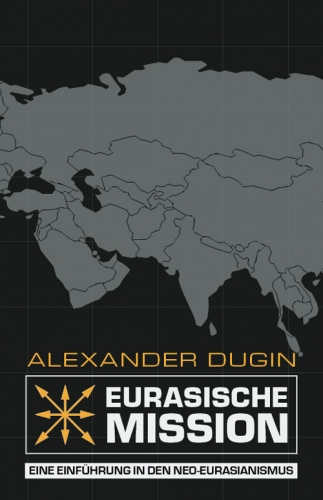
Son dernier livre, intitulé Eurasische Mission, vient de paraître en traduction allemande et se veut une "introduction au néo-eurasisme". Il est déjà clair que l'"eurasisme" ou la "pensée eurasienne" n'est pas vraiment une nouveauté. Douguine fait référence à une poignée de penseurs et de scientifiques russes du siècle dernier comme étant ses fondateurs, tels le philologue et linguiste Nikolai S. Troubetskoï (1890 - 1938), l'historien Lev Nikolaevitch Gumilev (1912 - 1992) ou l'historien de la culture et philosophe Ivan A. Ilyine (1893 - 1954) ; ce dernier a été honoré il y a des années par Poutine lors d'une petite cérémonie ; il est considéré comme une sorte de "philosophe maison" par le chef du Kremlin.
Selon Douguine, l'eurasisme a été formulé très tôt comme une idée reflétant les origines "multiculturelles" et supranationales de la Russie, c'est-à-dire l'oblitération par les Mongols et les Tatars pendant des siècles. L'idée eurasienne est donc également en certaine contradiction avec le concept de nationalisme occidental et bourgeois: "Cette originalité de la culture et de l'État russes (qui présente des traits à la fois européens et asiatiques) définit (...) la voie historique particulière de la Russie et son programme national et étatique, qui ne coïncide pas avec celui de la tradition d'Europe occidentale".
D'un autre côté, cela représente une grande chance, surtout aujourd'hui: car l'idée eurasienne montre une voie praticable pour que de grands espaces culturels et géographiques puissent trouver un ordre intérieur pacifique, fondé sur le respect et la diversité, même sans guerres d'extermination (USA!) ni nivellement culturel (One World!).
C'est la thèse centrale de Douguine : si le monde veut survivre à l'effondrement inévitable de l'ordre mondial américano-capitaliste, il doit se mettre d'accord sur un contre-projet radical qui permette fondamentalement une coexistence pacifique: "Le mouvement eurasianiste est un lieu de dialogue multilatéral égalitaire pour des sujets souverains. (...) Nous devons unir nos efforts pour dessiner une carte accessible pour les peuples d'Eurasie pour le nouveau millénaire".
Remarquable : même l'UE, avec sa tendance à la formation d'États supranationaux, semble utile dans cette voie - elle pourrait contribuer à ce que l'Europe retrouve un rôle autonome, indépendant des États-Unis, dans son propre environnement géopolitique.
Mais en fin de compte, Douguine ne se fait pas d'illusions : il n'y aura pas de coexistence pacifique avec l'hégémon mondial américain. Car celui-ci, suivant sa logique capitaliste libérale, ne tolère pas de cultures, de peuples et d'espaces économiques autonomes à côté de lui. Les États-Unis sont le "pays du mal absolu". "L'empire américain devrait être détruit, et tôt ou tard, il le sera".
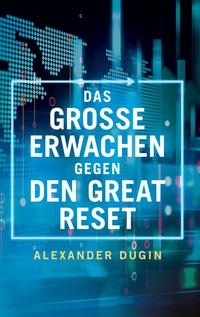 Face au cancer de la mondialisation occidentale, le contre-projet "eurasiatique" a la fonction d'un message révolutionnaire qui peut encore tout changer pour le mieux à la douzième heure : "L'idée eurasiatique est un concept révolutionnaire au niveau mondial qui doit servir de nouvelle plate-forme de compréhension mutuelle et de coopération pour un grand conglomérat de puissances différentes : États, nations, cultures et religions qui rejettent la version atlantiste de la mondialisation".
Face au cancer de la mondialisation occidentale, le contre-projet "eurasiatique" a la fonction d'un message révolutionnaire qui peut encore tout changer pour le mieux à la douzième heure : "L'idée eurasiatique est un concept révolutionnaire au niveau mondial qui doit servir de nouvelle plate-forme de compréhension mutuelle et de coopération pour un grand conglomérat de puissances différentes : États, nations, cultures et religions qui rejettent la version atlantiste de la mondialisation".
La guerre en Ukraine, que Douguine voit comme une conséquence inévitable des provocations atlantistes continues, n'a fait qu'accélérer cette évolution. La guerre se joue en fin de compte sur le visage futur du monde. Douguine ne cache pas que la Russie est ici "destinée à prendre la tête d'une nouvelle alternative globale, eurasienne, à la vision occidentale de l'avenir du monde".
Pour certains lecteurs de "droite", tout cela est très fort de tabac - d'autant plus que Douguine déclare explicitement que l'État-nation classique est dépassé. Les droitiers occidentaux peuvent ne pas être d'accord. D'un autre côté, l'Allemagne dispose, avec le Saint Empire romain germanique, d'une vision d'empire vieille de plusieurs siècles, qui présente de nombreux points communs avec le concept eurasien de Douguine.
Au final, son livre - dont Constantin von Hoffmeister a assuré une traduction fluide et agréable - est une lecture captivante et inspirante pour tous ceux qui en ont assez de l'Occident, de l'OTAN, des gay prides et de l'obsession du genre. Certes, Douguine n'est pas un "homme de droite", encore moins un "nationaliste". Mais c'est un penseur visionnaire du 21ème siècle. Tout porte à croire qu'il aura raison. L'ère "multipolaire" n'en est qu'à ses débuts.
Karl Richter
20:39 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique, Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, eurasisme, géopolitique, alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, russie, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 11 septembre 2022
Giorgia Meloni et les prochaines élections italiennes - Entretien avec Marco Malaguti, directeur d'Essenzialismi

Giorgia Meloni et les prochaines élections italiennes
Entretien avec Marco Malaguti, directeur d'Essenzialismi
Marco Malaguti (né en 1988 à Bologne), directeur du nouveau portail culturel et philosophique Essenzialismi (www.essenzialismi.it). Auteur pour la plateforme géopolitique Aliseo depuis mai 2022, membre du groupe de réflexion "Centro studi politici e strategici Machiavelli". Expert en philosophie romantique et postmoderne.
L'entretien a été réalisé et traduit de l'anglais par Alexander Markovics pour le journal allemand Deutsche Stimme.
Cher Monsieur Malaguti !
Vous êtes vous-même journaliste et vous vous intéressez depuis des années à la politique intérieure italienne. Le 25 septembre, l'Italie réélit son Parlement. La favorite est Giorgia Meloni, connue entre autres pour sa phrase célèbre "Je suis Giorgia. Une femme, une mère et une chrétienne. Et personne ne m'enlèvera cela". Comment évaluez-vous personnellement Mme Meloni et ses chances de gagner les prochaines élections ?
Ce que Giorgia Meloni récolte est le résultat d'un travail de plusieurs années. Contrairement à Salvini, Meloni a toujours eu une vertu fondamentale en politique: la patience. Son héritage politique comprend le MSI, un descendant direct du parti national fasciste, et elle s'est toujours préparée à participer au gouvernement, une nécessité que Salvini n'a jamais ressentie comme urgente. Par conséquent, Salvini s'est rapproché de tous les partis "marqués" au sein de l'UE, y compris le FN français. Bien que ce dernier soit historiquement plus proche du parti de Meloni, les Fratelli d'Italia (FdI) se sont plutôt rapprochés des partis conservateurs au pouvoir dans plusieurs pays de l'UE, notamment le PiS polonais et le FIDESZ hongrois. Cette manœuvre a également concerné l'autre côté de l'Atlantique : alors que Salvini tentait de se faire une réputation d'ami de Poutine (une opération qu'il a complètement annulée après l'invasion de l'Ukraine), Meloni a assisté à de nombreux événements conservateurs aux États-Unis, comme le CPAC, et est devenue membre de l'Institut Aspen. De ce point de vue, elle a fait preuve de clairvoyance : bien qu'elle ait également eu des sympathies pro-russes dans le passé et que beaucoup dans son parti les partagent, elle a compris à l'avance que l'Occident allait radicaliser son action contre la Russie et qu'elle devait faire le ménage à temps, une mesure que ni Salvini ni Berlusconi, qui est un ami proche de Poutine, n'ont été en mesure de mettre en œuvre. Les FdI seront le parti le plus fort dans une coalition de droite et probablement le parti le plus fort d'Italie, mais il serait faux de considérer ces voix comme un héritage de Meloni. L'écrasante majorité de ces voix proviendront de la Ligue, qui les avait précédemment obtenues de Forza Italia. De manière générale, les électeurs de droite en Italie se sentent largement sous-représentés et cherchent à chaque fois un autre candidat pour défendre leurs intérêts. Meloni était tout simplement la seule candidate restante. Ce serait une erreur de considérer ces électeurs comme des habitués du FdI.

Marco Malaguti.
Giorgia Meloni remporte les élections législatives en s'alliant avec Silvio Berlusconi et Matteo Salvini, qui ont tous deux une grande expérience politique et ont déjà travaillé avec Meloni par le passé. Malheureusement, Berlusconi et Salvini ont tous deux déçu de nombreux électeurs et légitimé le gouvernement technocratique européen de Draghi. Les critiques mondialistes décrivent l'ancienne journaliste comme une candidate d'"extrême droite" et mettent en garde contre un glissement de l'Italie vers un nouveau fascisme. Comment évaluez-vous idéologiquement la nouvelle alliance de droite en Italie ? Pourrait-elle réellement conduire à une révolution conservatrice en Italie ?
Meloni a réussi à se forger une réputation de pureté idéologique et d'intransigeance pour elle-même et son parti, mais la réalité est différente. Les FdI ne sont rien d'autre que les successeurs de l'Alleanza Nazionale (AN), un parti qui a déjà passé de nombreuses années dans une coalition avec Berlusconi, et de nombreux membres de l'AN font désormais partie des FdI. Meloni a elle-même été ministre de la Jeunesse dans le dernier gouvernement Berlusconi. L'idée qu'on se fait d'elle comme d'une femme politique intransigeante qui ne s'est jamais aventurée dans les bas-fonds de la gouvernance est donc romantique, mais fausse.
D'un point de vue idéologique, la coalition des droites italiennes a toujours été d'une grande confusion : des libéraux aux nostalgiques du mussolinisme, des régionalistes aux centralistes. Si je devais montrer ce qui unit cette coalition, je devrais d'abord citer l'aversion pour les impôts, une politique de sécurité stricte en termes de loi et d'ordre, ainsi qu'une hostilité voilée envers l'immigration et l'agenda LGBT. Si je cite des thèmes particuliers, c'est parce qu'il n'existe pas d'idéologie ou de philosophie formulée à laquelle la droite italienne adhère en bloc.
Le travail culturel qui définit une fois pour toutes ce que doit être la droite italienne n'a été fait que récemment et arrive trop tard, souvent écrasé en outre par le lourd héritage du fascisme, dont les Italiens ont encore aujourd'hui une bonne opinion, si l'on exclut les lois raciales. Je ne pense pas qu'un gouvernement de droite puisse déchaîner une "révolution conservatrice" en Italie, et encore moins un retour généralisé du fascisme. De manière réaliste, on peut s'attendre à un assouplissement de la censure des médias et à un arrêt momentané de l'agenda LGBT, mais tout cela sera perdu avec le prochain changement de gouvernement si cette politique n'est pas accompagnée d'un travail culturel profond en coulisses, qui n'a été mené que de manière très partielle et inefficace jusqu'à présent.
En matière de politique étrangère et de géopolitique, Giorgia Meloni adopte des approches plutôt non conventionnelles pour un parti de droite. Elle a ainsi déclaré publiquement vouloir suivre les directives de Bruxelles et livrer des armes à l'Ukraine. Que pensez-vous de ce positionnement géopolitique? Est-ce que cela permettra à l'Italie de récupérer sa souveraineté auprès de l'UE et des États-Unis ou est-ce que cela signifie une consécration de son statut de vassal des États-Unis ?
Aucun des partis de droite de la coalition n'a actuellement la volonté et la possibilité de changer la position atlantiste de l'Italie. La position vis-à-vis de l'UE est plus nuancée, mais la Lega et les FdI sont désormais sceptiques quant à une sortie de l'Italie hors de l'UE, alors que Forza Italia a toujours été pro-UE. Cependant, l'européisme des FdI est très différent de celui des libéraux et plus proche de la vision eurocritique de Varsovie et Budapest que de l'européocentrisme français ou de la forte adhésion à l'euro en Allemagne. Ce recentrage permet d'une part d'éviter que les électeurs eurosceptiques ne quittent les FdI pour des partis plus radicaux (par exemple Italexit ou ISP), mais d'autre part il place l'Italie dans une situation d'assiégeant du noyau européen franco-allemand, sous contrôle américain.

Cet axe, qui marche de concert avec le groupe consolidé de Visegrad, serait complété par l'Italie et les pays du sud de l'UE. Ce processus joue sur le profond mécontentement en Italie et dans ces pays en raison des politiques d'austérité mises en place par l'UE du Nord au détriment de l'UE du Sud. Ce n'est pas un hasard si Meloni a signé un pacte d'amitié avec le leader du parti espagnol Abascal. Si elle l'emporte en Italie et que la droite triomphe à Madrid grâce à Vox, nous serions alors face à la réalisation d'un rêve de Donald Trump : l'implosion de l'UE et la poursuite de cette politique de "diviser pour mieux régner" qui empêche l'Europe de s'émanciper de ses maîtres de Washington.
14:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marco malaguti, giorgia meloni, italie, fratelli d'italia, élections législatives italiennes, europe, affaires européennes, entretien, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La revue de presse de CD - 11 septembre 2022
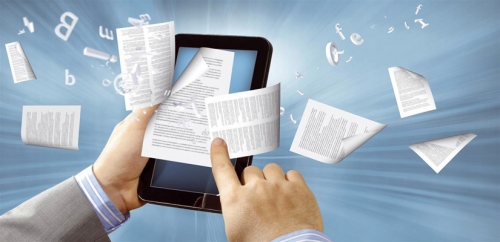
La revue de presse de CD
11 septembre 2022
EN VEDETTE
Katya Kopylova, diplomate russe : « La réponse en cas d’attaque sera radicale ! »
Katya Kopylova est diplomate et juriste russe. Jeune, très jolie, francophone sans aucun accent, interview d’un ovni : une tête – très - bien faite qui nous donne une belle leçon de géopolitique, historique et politique.
Livre noir
https://www.youtube.com/watch?v=xedMf06kWdU
ALLEMAGNE
L'industrie allemande met en garde contre l'explosion des coûts énergétiques : « L'Allemagne devient un musée industriel »
Les mises en garde contre les conséquences de la politique énergétique actuelle et l'explosion des coûts de l'énergie qui en résulte se font désormais entendre dans les milieux industriels. Début août déjà, le célèbre propriétaire de Trigema, Wolfgang Grupp, entre autres, avait mis en garde contre une « grande vague de licenciements ». Et la Chambre bavaroise de l'industrie et du commerce (BIHK) a déclaré qu'au vu des prix actuels de l'électricité, des milliers d'emplois étaient menacés rien qu'en Bavière ; si le gaz russe venait à manquer, ce chiffre pourrait atteindre un million rien qu'en Bavière.
euro-synergies.hautetfort.com
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/02/l...
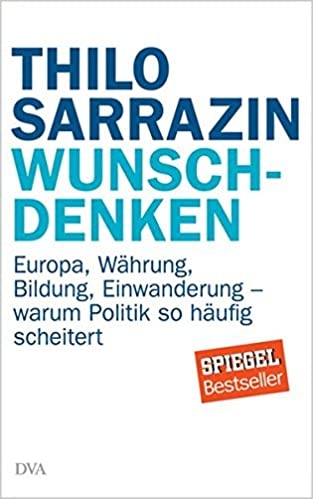
Lu à l’étranger : Thilo Sarrazin, Les vœux pieux en politique
Figure majeure du SPD, exclu après avoir publié un livre critique sur l’immigration, Thilo Sarrazin continu d’analyser la vie politique allemande avec des livres qui sont toujours des bestsellers. Son dernier ouvrage analyse la prise de contrôle du sentimentalisme sur la vie politique. La rationalité et le temps long sont effacés pour être remplacés par l’émotivité et la réponse au court terme. Un livre non encore traduit en français mais qui permet de comprendre les débats intellectuels en Allemagne.
revueconflits.com
https://www.revueconflits.com/lu-a-letranger-thilo-sarraz...
CHILI
Réforme constitutionnelle au Chili : la « voix du peuple » contre la gauche
Le dimanche 4 septembre, tous les Chiliens sont allés voter et les résultats sont sans ambiguïté : le texte constitutionnel, porté avec enthousiasme par le président Boric a été rejeté par 61,86 % des voix.
contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/09/06/438306-reforme-co...
COMPLOTISME (?) – « c’est celui qui l’dit qu’y est »
A quoi sert la vaccination de masse ? De l’infertilité au transhumanisme…
Ce qui est appelé vaccin aujourd’hui semble se rapprocher toujours plus d’un outil de bricolage génétique qui permettrait aux dieux de l’enfer du great reset de prendre le contrôle de la production et de l’exploitation humaine. Une image qui m’a frappée récemment est la suivante. Elle sort directement des tiroirs de sympathisants de l’UE. Devant une Tour de Babel, flanquée de 11 étoiles inversées, se trouvent des « humains ». A les regarder de plus près, on imagine que ce sont des personnages de Légo. Or, ces gens seraient les « Nouveaux » européens. Autant de transhumains ?
lilianeheldkhawam.com
https://lilianeheldkhawam.com/2022/09/04/a-quoi-sert-la-v...
DÉCONSTRUCTION
« Le Seigneur des anneaux » d’Amazon souille le chef-d’œuvre de Tolkien
La plus grande menace de la Terre du Milieu et du monde du Seigneur des anneaux n’est plus Sauron ou Morgoth, mais les wokes.
contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/09/04/422688-le-seigneu...
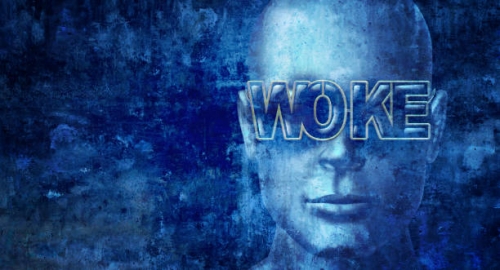
L’idéologie woke s’attaque aux sciences de l’Homme
Censurer préventivement la science au nom du moralisme progressiste n’est pas seulement idiot, immoral et dangereux : c’est aussi se placer sur le terrain du lyssenkisme, du nom de Trofim Lyssenko, la pseudo-science stalinienne.
contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/09/03/438003-lideologie...
Sandrine Rousseau a raison
Dans une vidéo très bien réalisée, le Youtubeur Lapin du Futur se paye Sandrine Rousseau. Tout en appelant ceux qui la critiquent à ne pas se contenter de le faire en se moquant ou en rigolant. Car il a parfaitement saisi que derrière Sandrine Rousseau et quelques autres extrémistes de la « déconstruction » et de la « Table rase », il y a un véritable projet de société révolutionnaire qu’ils veulent mettre en place, pendant qu’une autre partie de la société se conforte dans son immobilisme sans bâtir un projet de société parallèle à celle que veulent ces nouveaux Khmers rouges.
lelapindufutur
https://www.youtube.com/watch?v=4_ud394BiVQ
Vers l’euthanasie à marche forcée
C’est un puzzle qui se met en place sous nos yeux. Chaque pièce y trouve sa place. La vie politique étant pensée en séquences de communication, en fenêtres de tir afin de parvenir à faire adopter sans heurts tel ou tel texte de loi, il semble désormais clair qu’Emmanuel Macron proposera une loi consacrée à l’euthanasie active et au suicide assisté. « La réforme des retraites n'est pas dans les 60 priorités du gouvernement, mais il s'apprête à lancer le processus qui conduira – sans surprise – à légaliser l'euthanasie active et le suicide assisté. S'offrir facilement un succès dans l'opinion plutôt qu'affronter la contestation », analyse avec clarté Guillaume Tabard.
laselectiondujour.com
https://www.laselectiondujour.com/vers-leuthanasie-a-marc...
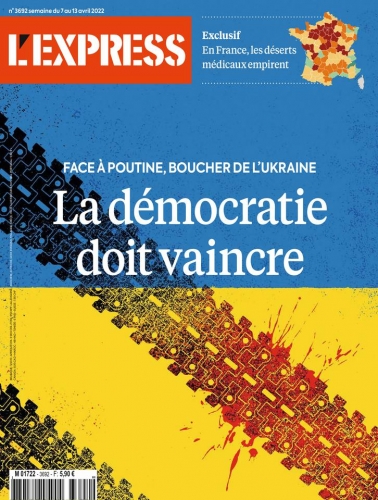
DÉSINFORMATION/CORRUPTION/CENSURES/DÉBILITÉ
L’Express, parfait exemple de propagande de guerre
Le 24 mars 2022, un mois après le début de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, l’Ojim revenait sur les dix principes de la propagande de guerre. Pour nos lecteurs avides de mettre en pratique leurs capacités à repérer ces axiomes, la lecture du numéro 3712 (25 août 2022) de L’Express sera éclairante.
ojim.fr
https://www.ojim.fr/lexpress-nous-les-ukrainiens-propagan...
Revue de presse RT du 28 août au 3 septembre 2022
Notre exercice hebdomadaire de ré/désinformation grâce au média russe Russia Today. Cette semaine, il est visible que RT cherche, par sa sélection d’infos, à montrer la totale contre productivité des sanctions prises contre la Russie. Elles n’ont qu’un effet, mettre l’unité politique occidentale en danger, l’économie européenne à genoux et les citoyens au froid. Et l’Ukraine qui se prépare à devenir un centre terroriste, sous couvert de résistance…
lesakerfrancophone.fr
https://lesakerfrancophone.fr/revue-de-presse-rt-du-28-ao...

Censure et fake news : Le Monde et LCI dans la tourmente
La onzième édition 2022 d’un rapport conduit par Le Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) analysant l’activité des consommateurs sur le secteur des médias au niveau mondial, a été rédigée en interrogeant 93 000 « consommateurs » répartis sur tous les continents et 46 marchés distincts. D’après cette étude, il s'avère que seulement 29 % des Français ont confiance dans les médias, ce qui démontre une véritable crise de confiance. Et pour cause : le narratif sur les Gilets jaunes, le covid et la guerre en Ukraine, a beaucoup accentué cette séparation entre la presse et le citoyen. En témoigne ces deux exemples : avant de présenter ses excuses à ses lectrices et lecteurs ainsi qu’au président de la République, Le Monde, journal quotidien autrefois prestigieux, a dépublié suite à la colère de l'Elysée une tribune du politologue Paul Max Morin car « ce texte reposait sur des extraits de citation qui ne correspondent pas au fond des déclarations du chef de l’État ». Seulement quelques jours plus tard, c'est au tour de LCI de faire des siennes. Lors d'une émission, un journaliste provoque la stupeur. Assurant qu'il s'agissait de « propagande russe », celui-ci affirme qu'une manifestation, organisée notamment contre les rationnements énergétiques et pour la sortie de l'Otan, ne s'est jamais déroulée... alors qu'elle a bel et bien eu lieu le samedi 3 septembre.
francesoir.fr
https://www.francesoir.fr/opinions-tribune/censure-et-fak...
Les influenceurs virtuels sont-ils plus puissants que les influenceurs humains?
Face aux dangers liés à la réputation et au comportement des influenceurs « réels », les influenceurs virtuels apparaissent comme une solution efficace, car ils accomplissent des missions similaires sans exposer aux mêmes risques. Le phénomène des influenceurs virtuels prend de plus en plus d’ampleur et semble être privilégié par certaines entreprises. Plus fiables, moins chers, toujours disponibles, les influenceurs virtuels sont aussi incroyablement populaires et réalisent des performances remarquables auprès des consommateurs. Ils permettent aux marques d’être plus créatives tout en maîtrisant totalement le contenu.
theconversation.com
https://theconversation.com/les-influenceurs-virtuels-son...

Une presse française lâche et paresseuse
Ah, finalement, qu’il est doux d’être journaliste en France dans un journal de révérence ! Jadis, c’était un travail fatigant, voire stressant et parfois même risqué : il fallait aller chercher l’information directement sur le terrain et la corroborer le carnet de notes à la main. Certains événements pouvaient impliquer de mettre sa vie en danger ; et certaines informations, une fois obtenues, pouvaient signifier une exposition directe aux rétorsions des puissants…
contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/09/07/438385-une-presse...
Palestine : la désinformation au 20h de France 2 continue
En juillet 2021, nous nous intéressions à la couverture qu’infligeait le « 20h » de France 2 au conflit opposant Israël aux Palestiniens. Nous notions alors à quel point c’est une constante dans cette rédaction, pour ne pas dire une ligne éditoriale, que de mutiler l’information (et le droit d’être informé) sur ce conflit en accumulant les œillères, les angles morts et les biais, voire les mensonges. Un constat qui ne s’est pas démenti depuis, y compris lorsqu’une journaliste palestinienne, mondialement reconnue, a été récemment assassinée par l’armée israélienne.
les-crises.frs
https://www.les-crises.fr/palestine-la-desinformation-au-...
ÉCOLOGIE
Environnementalisme systémique contre environnementalisme instrumental
La protection de l'environnement est l'une des questions les plus cruciales et les plus facilement instrumentalisées du monde contemporain. Pour comprendre la nature structurelle du problème, il faut commencer par une compréhension de base des mécanismes sous-jacents de la dynamique du capital, caractérisée par le besoin intrinsèque de croissance pérenne et de concurrence entre les agents économiques. L'état stable pour la société et l'économie décréterait l'effondrement du modèle capitaliste.
euro-synergies.hautetfort.com
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/06/e...


ÉCONOMIE
La « shrinkflation », cette arnaque tapie dans les rayons de vos supermarchés
Le mot « shrinkflation » est une contraction du verbe to shrink (« réduire », en anglais) et du mot « inflation ». C’est la tablette de chocolat qui a gardé le même nombre de carrés et son prix mais a perdu un demi-centimètre de chaque côté ; c’est le pot de fromage blanc ou de rillettes dont le fond remonte désormais jusqu’à la moitié ; le tube en carton des rouleaux de toilette qui a pris du diamètre ; les kilos qui ne font plus que 980 grammes, les céréales qui se baladent à l’aise dans leur boîte en carton ou certaines bouteilles d’eau minérale qui ne contiennent plus que 1,15 litre, contre 1,25 hier et 1,5 avant-hier. Etc.
Bvoltaire.fr
https://www.bvoltaire.fr/la-shrinkflation-cette-arnaque-t...
ÉNERGIES
Nucléaire : une énergie qui dérange (vidéo)
Alors que près d’un Français sur deux considère comme prioritaire le maintien de nos capacités nucléaires actuelles, l’atome fait un retour remarqué sur le devant de la scène – et ce après une longue période de disgrâce. A la faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, dans la recherche d’une indépendance énergétique réaffirmée, ou bien encore pour limiter l’envolée des prix de l’électricité, tous les politiques – ou presque – semblent recommander son remède. Pour autant il est légitime de s’interroger sur cette source d’énergie et les fantasmes qu’elle véhicule. Qu’en est-il vraiment ? Professionnels et experts nous donnent les clefs pour mieux comprendre l’atome. Une excellente enquête.
documentaire-et-verite.com
https://documentaire-et-verite.com/nucleaire/
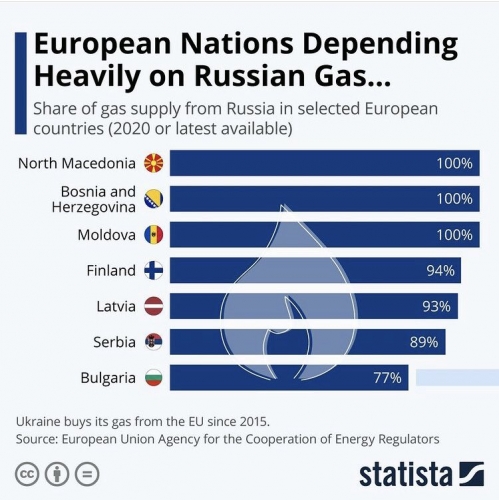
La crise énergétique s’aggrave en Finlande du fait des sanctions prises contre la Russie
Les effets secondaires des sanctions anti-russes deviennent de plus en plus insupportables pour les pays occidentaux. La Finlande a activé le niveau d’alerte maximal en raison de la crise énergétique, en prenant des mesures exceptionnelles pour gérer les difficultés d’approvisionnement. Le chef du gouvernement a même déclaré que le pays allait connaître une « économie de guerre », alors que la Finlande n’est manifestement en guerre avec aucun autre État. Ce scénario révèle la voie désastreuse que l’Occident a choisi de suivre par sa propre décision.
breizh-info.com
https://www.breizh-info.com/2022/09/03/207488/la-crise-en...
Nucléaire : machine arrière toute !
Il est toujours possible de faire machine arrière. La Californie a reconsidéré la fermeture de la centrale nucléaire de Diablo Canyon.
contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/09/03/438086-nucleaire-...
ÉTATS-UNIS
Les États-Unis pompent les poches des Européens avec l'excuse de la guerre
L'Occident collectif parle de l'introduction éventuelle d'un plafond sur les prix du pétrole en provenance de Russie. Toutefois, Moscou ne vendra pas d'or noir aux pays qui prennent une telle mesure, a déclaré le vice-premier ministre Alexander Novak. Quelles conséquences se cachent derrière le désir des États-Unis et de leurs alliés d'isoler la Russie, a demandé l'expert en économie Dmitry Adamidov
euro-synergies.hautetfort.com
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/06/l...
LA CIA ET LES MÉDIAS (6/6) – Le rôle de la Commission Church
Comment les médias les plus puissants d’Amérique ont travaillé main dans la main avec la Central Intelligence Agency et pourquoi la Commission Church les a couverts.
les-crises.fr
https://www.les-crises.fr/la-cia-et-les-medias-6-6-le-rol...

FRANCE
Énergie : Macron, président de la disette
Pourquoi avons-nous abandonné l’énergie nucléaire dont l’abondance était garantie ? Pour des raisons électoralistes (glaner des votes écologistes) pour inonder des industriels de l’énergie renouvelable de subventions (capitalisme de copinage).
Frédéric Bastiat fut le premier à dénoncer le système d’accaparement par la ruse de la spoliation légale par l’État (« cette grande fiction selon laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde ») au nom d’une prétendue solidarité (« la Fraternité légalement forcée »). Il faudrait que chaque électeur mécontent puisse expédier Sophismes économiques et La loi à son député, sénateur, maire, et pourquoi pas à l’Élysée et Matignon pour qu’un peu de bon sens revienne dans les cerveaux de « la France d’en haut ».
contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/09/07/438353-energie-ma...
Le nucléaire français, histoire d’un désastre politique et idéologique
Prix en gros du mégawattheure à plus de 1.000 euros, Élisabeth Borne appelle les entreprises françaises à la « responsabilité collective » et n'exclut pas des coupures de courant cet hiver pour les particuliers. Comment la France, pays exportateur d'électricité, a-t-elle pu en arriver là ? Retour sur les 10 ans qui ont tué l'industrie nucléaire. Schizophrénie ou/et imbécillité ?
bvoltaire.fr
https://www.bvoltaire.fr/reportage-le-nucleaire-francais-...
Jean-Luc Mélenchon en mode Guy Mollet
Depuis son résultat au premier tour de l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a adopté un comportement qui peut apparaître comme erratique mais qui finalement obéit à une logique et permet de le rattacher à un précédent politique. Juste après la deuxième Guerre mondiale, et avant le début de la guerre froide, Guy Mollet avait pris le contrôle de la SFIO (nom du PS de l’époque) avec des positions très à gauche et un discours résolument marxiste. Il avait même initié des contacts avec le PCF pour discuter d’une éventuelle fusion des deux partis !
vududroit.com
https://www.vududroit.com/2022/09/jean-luc-melenchon-en-m...
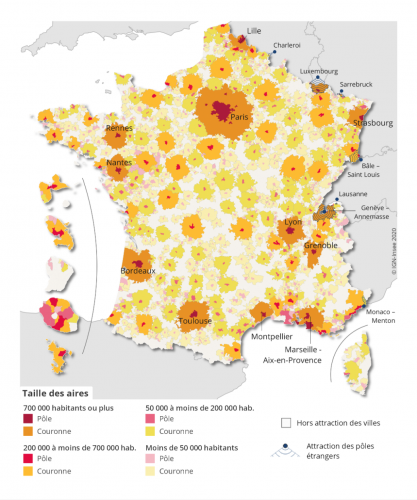
Zones rurales contre zones urbaines : deux France s’opposent-elles vraiment dans les urnes ?
À la suite des élections présidentielle et législatives de 2022, de nombreux commentateurs ont mis en avant le clivage entre les ruraux et les urbains pour rendre compte des résultats du vote. Ce discours médiatique est produit principalement par des commentateurs qui pointent depuis des années, cartes à l’appui, le fossé – croissant – entre le vote des grandes villes et le vote d’une « France périphérique ». Il y aurait une opposition politique entre une France des métropoles, multiculturaliste, gagnante de la mondialisation et une France éloignée des grands pôles urbains, perdante de la mondialisation, subissant un déclin industriel et économique. Mais existe-t-il véritablement deux France opposées sur le plan électoral ? Si tel est le cas, l’origine de cette fragmentation est-elle essentiellement liée au contexte économique local ou à la composition de ces territoires ?
revueconflits.com
https://www.revueconflits.com/zones-rurales-contre-zones-...
GAFAM
Référé de BonSens contre Bill Gates: l'audience aura lieu le 22 septembre au tribunal de Nanterre
L'association BonSens.org et trois de ses administrateurs ont assigné en référé le co-fondateur de la multinationale Microsoft Bill Gates devant le tribunal judiciaire de Nanterre par le biais de leur avocat Me Diane Protat. Après que cette assignation a été dument délivrée au domicile américain de M. Gates, le cabinet d’avocats américain K&L Gates, un cabinet de Seattle fondé en 1883, dont l’un des principaux associés fut William H. Gates, père de Bill Gates, s’est constitué avocat le 6 septembre et représentera donc le milliardaire dans ce dossier. L'audience aura lieu le 22 septembre 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.
francesoir.fr
https://www.francesoir.fr/politique-france/refere-de-bons...
Les réseaux sociaux vous espionnent, contrez-les !
Les réseaux sociaux sont devenus des armes dont nous sommes les munitions. Heureusement, nous pouvons arrêter les tirs.
contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/09/10/438330-les-reseau...
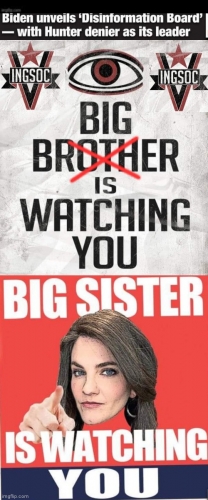
Plus de 50 employés de l'administration Biden impliqués dans une vaste opération de censure des réseaux sociaux
Selon les documents publiés le 31 août 2022 par le journal The Epoch Times, plus de 50 responsables de l’administration du président Biden issus d’une douzaine d’agences, ont été impliqués dans des efforts pour faire pression sur les entreprises de médias sociaux afin que celles-ci luttent contre « la désinformation » présumée. L'objectif : censurer les opinions qui vont à l’encontre du narratif selon lequel le vaccin « sûr et efficace » est la seule possibilité de venir à bout de l’épidémie de Sars-CoV-2.
francesoir.fr
https://www.francesoir.fr/politique-monde/plus-de-50-empl...
GÉOPOLITIQUE
Dossiers déclassifiés : La Grande-Bretagne a soutenu les États-Unis après la destruction d’un avion de ligne iranien
En 1988, un navire de guerre de la Marine américaine a abattu un avion de ligne iranien, tuant les 290 civils à bord. Des dossiers récemment déclassifiés montrent comment le gouvernement de Margaret Thatcher a offert un soutien immédiat aux États-Unis et a participé à la dissimulation de l’affaire.
les-crises.fr
https://www.les-crises.fr/dossiers-declassifies-la-grande...
GRANDE-BRETAGNE
Décès de Elisabeth II, un obstacle au RESET levé. Refondation de la France.
Le roi Charles, portant la couronne des Objectifs de Développement durable de l’Agenda 2030 à la rencontre du World Economic Forum de 2020. La veille de la « pandémie » covidienne. Elisabeth II est décédée ce 8 septembre 2022 à l’âge de 96 ans. Avec elle disparaît une figure de poids qui n’aurait pu cohabiter avec l’officialisation de la Nouvelle gouvernance associée au Nouveau Monde. Sa fonction est incompatible avec l’organisation transversale mondiale. C’est en ce même 8 septembre qu’une campagne médiatique française a annoncé la mise en place d’un Conseil National pour la Refondation du pays. Ce hasard de calendrier aidera grandement à atténuer les réactions populaires au lancement de ce projet.
Le blog de Liliane Held Khawam
https://lilianeheldkhawam.com/2022/09/09/deces-de-elisabe...

LECTURES
Deux citations extraites de l’excellente revue hebdomadaire Antipresse (N° 352 | 28.08.2022), de Slobodan Despot :
« Le mot “cybernétique” est de la même étymologie grecque que “gouvernail“ et “gouverner“ : kubernetikè. La Domination planétaire tire ainsi le plus imparable parti de la Cybernétique, qui n’est pas tant la science des ordinateurs que la modalité moderne, mathématiquement assistée, de ce que Heidegger nomme la Führung, c’est-à-dire la direction impulsée par les ‘’chefs’’ (les Führers), et de sa doublure d’animosité et d’annihilation à l’encontre de l’animal. » Séminaire sur La Gestion Génocidaire du Globe, citation extraite de l’intervention intitulée « Les animaux malades de la Cybernétique », de Stéphane Zagdanski :
« Le temps des révolutions est aujourd’hui clos, nous vivons celui de l’extermination et, par ricochet, celui de la survie et de l’autodéfense. » « Vers l’autodéfense, Le défi des guerres internes », de Bernard Wicht, Jean-Cyrille Godefroy éditeur.
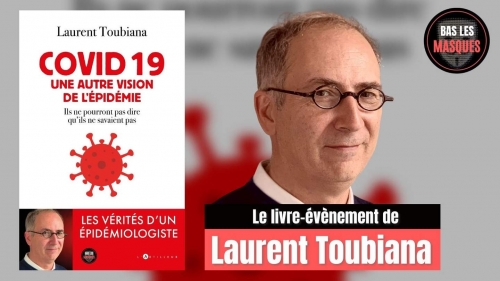
Titre :
COVID 19. Une autre vision de l’épidémie. Sous-titre : Ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas, de Laurent Toubiana. L’Artilleur, 272 p., 2022.
Auteur :
Laurent Toubiana est docteur en physique, épidémiologiste et chercheur à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Dirige de sa création en 2014 l’IRSAN (Institut de Recherche pour la valorisation de Santé).
Présentation :
Il s’agit du livre d’un honnête homme, savant sachant de son état, qui écrit pour ceux qui veulent comprendre ce qui s’est passé depuis 2020 et ces deux ans (pour l’instant) de démence, de propagande, de manipulation et de totalitarisme plus que rampant. Très clair, agrémenté de différents graphiques qui auraient mérités une présentation plus immédiate, il s’agit certainement du livre le plus clair et honnête sur la pseudo-pandémie que nous aurions subie.
Extraits :
« |…] la politique de massification des tests voulue par le gouvernement. Cette politique d’utilisation dévoyée des tests est parfaitement scandaleuse. En moins de deux ans, plus de 220 millions de tests ont été effectués pour une population de 67 millions d’habitants. Cela ne s’était jamais produit avant le Covid dans l’histoire du suivi des épidémies. »
« C’est apparemment Monsieur Jean Castex] qui, de 2005 à 2006, a été le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, où il a participé à l’introduction de la notion d’objectifs et de rentabilité dans l’hôpital et à une rationalisation des coûts dans le cadre du plan hôtel 2007. Nous sommes donc collectivement renseignés sur l’une des origines de la détérioration des soins. »
« Au début de ce livre, j’ai dit que mon propos était radical. Il n’a de radical que celui d’analyser les données épidémiologiques de la crise Covid et d’en conclure finalement que nous avons eu de la chance car cette épidémie était banale. Là où nous avons eu moins de chance, c’est dans la manière dont elle a été traitée. ça ce n’était pas banal. En vérité, mon discours n’apparaît comme radical qie par contraste avec la radicalité des mesures mises en place par les autorités sanitaires et avec le climat d’anxiété généralisée entretenu pour que les populations s’y soumettent. »
MONDIALISME
Donation américaine de plusieurs millions de dollars: une fondation de gauche veut renverser Orbán - et Soros se pointe à nouveau...
Le responsable de la communication du Fidesz, István Hollik, a indiqué aux médias qu'il était illégal en Hongrie qu'un parti reçoive des fonds de l'étranger. Selon lui, Márki-Zay et son équipe ont « abusé de la loi » puisqu'ils ont reçu les fonds sur le compte de leur association. Hollik a également attiré l'attention sur le fait qu'Action for Democracy avait des « milliers de liens » avec George Soros. (mü)
euro-synergies.hautetfort.com
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/02/d...
RÉFLEXIONS
Alain de Benoist : « La guerre qui se déroule actuellement en Ukraine est en fait une guerre des Etats-Unis contre la Russie »
En cette rentrée scolaire 2022-2023, nous avons donné la parole à Alain de Benoist, afin de faire le point sur l’actualité chaude du moment (guerre en Ukraine, crise politique et économique en France) mais aussi sur les perspectives, y compris chez nous, à moyen et long terme. Un entretien qui ouvre de nombreuses perspectives, loin des clichés éculés de nos politiciens et de nos « médias ».
breizh-info.com
https://www.breizh-info.com/2022/09/06/207529/alain-de-be...
« Le totalitarisme prend le pas sur la démocratie »
Pour l'instant pas censurée sur ma chaîne : archivez-la et diffusez-la ailleurs. « Aujourd'hui les représailles contre les défenseurs des droits humains sont très inquiétantes, et sont des exemples du traitement prochainement réservé à la société civile, de manière arbitraire. Lorsque les premières lignes, représentées par les citoyens qui se sont exposés depuis plus de deux ans à manifester leur inquiétude pour la protection des droits humains, auront été muselées et éliminées, c'est à ce moment-là que le peuple comprendra à quel pouvoir il a affaire, car le totalitarisme se déchaîne une fois qu'il a éliminé toute véritable opposition politique. »
arianebilheran.com
https://www.arianebilheran.com/so/adOBvPrZp?languageTag=e...
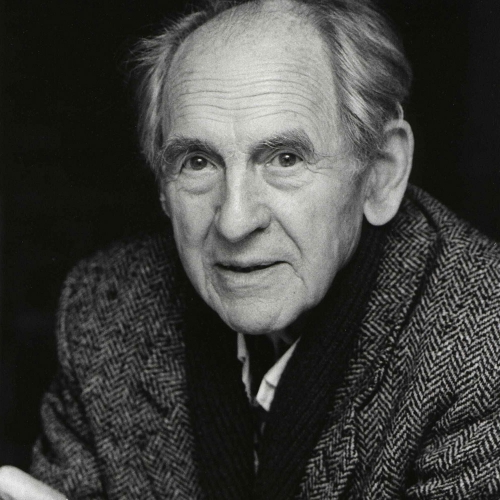
Small is beautiful: Leopold Kohr et le refus de l’Etat totalitaire moderne
Nous allons vivre un cauchemar étatique dans tous les pays. Le penseur austro-américain Léopold Kohr était cité avec Jacques Ellul et Guy Debord à la fin du documentaire apocalyptique Koyaanisqatsi. C’est comme cela que je l’ai découvert en 1983. En réalité son nom est inconnu alors que son lemme est mythique : small is beautiful. Kohr est l’esprit qui a mis en doute le monde moderne dans tout ce qu’il a de gigantesque, de titanesque, d'autoritaire et de compliqué.
euro-synergies.hautetfort.com
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/03/s...
L’absolue nécessité de la peur
Les gouvernants ne font plus qu’une chose : surfer sur les peurs pour accroître leur pouvoir. Le pire ? Cela semble marcher.
contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/09/09/438473-labsolue-n...
RUSSIE
Retour sur les allégations de crimes de guerre russes en Ukraine : Boutcha (3/3)
Le 3 avril 2022, une vidéo commence à tourner sur les réseaux sociaux montrant une route jonchée de cadavres (ici reprise floutée par Sky News). Elle n’a ni date, ni explication. Mais, les internautes qui la partagent sur Twitter en sont déjà persuadés : il s’agit de victimes ukrainiennes de la barbarie russe. Qui a besoin de preuves quand les images semblent parler d’elles-mêmes ? Qui d’autre que les méchants envahisseurs russes pourraient massacrer ainsi des civils en pleine rue ? Cela semble tout à fait logique pour la majorité des gens qui croient déjà que les Russes ont bombardé la maternité et le théâtre de Marioupol, juste pour le plaisir de tuer des femmes et des enfants. La diabolisation était déjà lancée. Boutcha ne fait que confirmer ce dont beaucoup étaient déjà convaincus : les Russes sont des barbares et commettent des crimes de guerre en masse.
Francesoir.fr
https://www.francesoir.fr/retour-sur-les-allegations-de-c...
SANTÉ/LIBERTÉS
Le professeur Didier Raoult répond aux accusations de l’IGAS et des ministres
Afin de tirer un bilan de la crise du Covid-19, nous recevons le professeur Didier Raoult : angle de couverture médiatique des traitements précoces, conflits d’intérêts liés à l’industrie pharmaceutique, effets secondaires de la vaccination anti-Covid, ou encore attaques médiatiques et politiques contre l’IHU Méditerranée Infection, sur l’ensemble de ces thèmes brûlants, le célèbre microbiologiste répond sans concession à toutes nos questions dans le cadre de cet “Entretien essentiel“ fleuve.
francesoir.fr
https://www.francesoir.fr/le-professeur-didier-raoult-rep...

UKRAINE
[PODCAST] Ukraine : un siècle de tragédies – avec Stéphane Courtois
Stéphane Courtois est historien (directeur de recherche honoraire au CNRS), spécialiste de l’histoire d’Europe de l’Est et des régimes communistes. Dans cet entretien réalisé fin mai 2022, nous parlons de l’Ukraine. Quelle est l’histoire de cette nation, de son peuple, de son État, et de son territoire ? Des principautés vikings à l’époque contemporaine, Stéphane Courtois nous emmène à travers des siècles d’une histoire riche, rude et passionnante.
contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/09/09/438459-podcast-uk...
UNION EUROPÉENNE
La folle stratégie de l’Europe pour la sécurité alimentaire
Ce rapport officiel de l’UE a été rédigé par des personnes aux ventres pleins, aux rêves idéologiques de pureté alimentaire et qui n’ont aucune idée du défi que représente l’obtention d’une récolte. Douloureux à lire mais encore plus à ignorer, je présente ici mes commentaires sur certains passages. Je ne cesse de me pincer quand je dis que c’est l’état d’esprit de nos dirigeants européens. Ce serait drôle si tant de gens ne risquaient pas de mourir ou de souffrir de malnutrition, en grande partie à cause de leur idéologie ignorante du culte de la nourriture.
contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/09/05/426312-la-folle-s...
L’enfer est pavé de bonnes intentions : l’Europe
L’Europe est un sujet qui nous a toujours été vendu comme répondant à de nobles intentions. Certes. Mais de quelle Europe parlons-nous ? Et la prééminence du politique sur tous les sujets ne fausse-t-elle pas tout débat de fond, menant petit à petit à l’enfer de la désillusion ?
contrepoints.org/
https://www.contrepoints.org/2022/09/03/167472-lenfer-est...
L’avenir de l’Union Européenne selon Olaf Scholz
Le chancelier allemand Olaf Scholz a prononcé un important discours sur sa vision de l’Union européenne, à l’Université Charles de Prague, le lundi 29 août (texte intégral en lien ci-dessous, traduit par la revue Le Grand Continent). Affirmant à quatre reprises que l’UE doit s’adapter au « changement d’époque », il a esquissé un programme de réformes pour qu’elle renforce son rôle « géopolitique » et défende sa « souveraineté ». Le point essentiel de ce programme est l’abandon de la règle de l’unanimité au profit de la « majorité qualifiée » dans les domaines de la politique étrangère et de la fiscalité. Autrement dit : un pays membre de l’UE ne disposerait plus d’un droit de véto pour bloquer une décision prise à la « majorité qualifiée » (c’est-à-dire adoptée par 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population de l'Union européenne : c’est l’un des modes de vote actuellement appliqué au sein du Conseil des ministres de l’Union européenne dans certains secteurs : Agriculture et pêche, Compétitivité, Emploi, etc.).
laselectiondujour.com
https://www.laselectiondujour.com/lavenir-de-lunion-europ...
13:08 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, france, affaires européennes, politique internationale, presse, journaux, médias |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 09 septembre 2022
Oskar Lafontaine demande que l'Europe se détache des États-Unis

Oskar Lafontaine demande que l'Europe se détache des États-Unis
Bernhard Tomaschitz
Source: https://zurzeit.at/index.php/oskar-lafontaine-fordert-abkoppelung-europas-von-den-usa/
Les dirigeants politiques de la coalition "Ampel" sont de "fidèles vassaux des États-Unis" !
Oskar Lafontaine a tenu des propos clairs dans une tribune publiée dans le Berliner Zeitung. L'ancien politicien de la SPD et de Die Linke y attire l'attention sur les dessous du conflit ukrainien, et plus précisément sur "l'image que les Etats-Unis ont d'eux-mêmes, à savoir qu'ils sont une nation élue qui prétend être et rester la seule puissance mondiale".
Et au plus tard avec le coup d'Etat de Maidan en 2014, les Etats-Unis auraient montré qu'ils n'étaient pas prêts à prendre en compte les intérêts de la Russie en matière de sécurité: "Ils ont mis en place un gouvernement fantoche pro-américain et ont tout fait pour intégrer les forces armées de l'Ukraine dans les structures de l'OTAN". Lafontaine fait également référence à la crise de Cuba en 1962, lorsque les États-Unis ont risqué une guerre nucléaire en raison du déploiement de missiles nucléaires soviétiques à Cuba.
Lafontaine s'en prend durement à l'Allemagne, qui "n'est pas un pays souverain". Pour l'homme de 78 ans, les dirigeants de la coalition "Ampel" comme le chancelier Scholz (SPD), la ministre des Affaires étrangères Baerbock et le ministre de l'Economie Habeck (tous deux membres du parti Die Grünen) ainsi que le ministre des Finances Lindner (FDP) sont de "fidèles vassaux des Etats-Unis", et le chef de la CDU Merz un "fidèle atlantiste".

Lafontaine écrit que "la politique étrangère allemande nuit aux intérêts de notre pays et ne contribue pas à la paix en Europe". Il demande que l'Europe se détache des États-Unis et joue un rôle de médiateur entre les puissances mondiales rivales. Selon lui, l'Allemagne et la France ont le potentiel pour mettre en place une politique étrangère et de sécurité européenne indépendante.
Pour conclure son intervention, Lafontaine pointe du doigt le grand bénéficiaire du conflit ukrainien et des sanctions contre la Russie, suicidaires pour l'Europe : "Les entreprises industrielles européennes sont en train de partir et de créer de nouvelles filiales aux Etats-Unis. De même, les énormes commandes pour l'industrie de l'armement américaine et les bénéfices exorbitants engrangés par l'industrie de la fracturation hydraulique américaine, nuisible à l'environnement, montrent de manière éclatante à qui profitent cette guerre et ces sanctions".
18:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, europe, affaires européennes, politique internationale, oskar lafontaine, gauche allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 septembre 2022
Plus jamais de gaz russe. Ce n'est pas Poutine qui l'a dit, mais les Anglo-Saxons

Plus jamais de gaz russe. Ce n'est pas Poutine qui l'a dit, mais les Anglo-Saxons
par Maurizio Blondet
Source : Maurizio Blondet & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/gas-russo-mai-piu-ma-non-lo-ha-detto-putin-bensi-gli-anglosassoni
Supposons que les choses en Ukraine tournent bien, c'est-à-dire tournent comme les souhaits, les rêves ou les cauchemars déclarés de l'OTAN, des Occidentaux et des Anglos le voudraient : Zelensky gagne la guerre et triomphe, Poutine est vaincu, il est pendu à Nuremberg, et un gouvernement soumis aux souhaits de l'Occident est installé à Moscou, qui célèbre son premier jour d'installation par une Gay Pride (nos valeurs). Pensez-vous qu'ensuite, pacifiés, l'Alliance atlantique et les États-Unis nous laisseront, nous Européens, recommencer à acheter du gaz et du pétrole russes, comme avant ? Que nous reviendrons à cette normalité qu'ils appellent maintenant "la dépendance de l'Europe au gaz russe" ?
Enlevons cela de nos têtes. Les États-Unis et les Anglos ont manigancé le réarmement et la préparation de l'Ukraine et fomenté toutes les provocations qui ont conduit Poutine à déclencher le conflit, dans le but même de couper et de sceller les veines énergétiques russes qui fournissaient pacifiquement et à bon marché du gaz, du pétrole brut, du charbon au demi-milliard d'Européens et assuraient leur bien-être. L'Europe, et non la Russie, était dès le départ la cible à frapper par la crise conçue depuis belle lurette pour être mise en œuvre. Les Anglos ont pour eux la théorie de McKinder qui dit : celui qui domine le heartland domine un monde de terre - inatteignable par les navires prédateurs de l'empire britannique - qui s'étend sans interruption de l'Europe à la Chine en passant par la Russie, un immense ensemble continental autosuffisant, qui commerce par le rail, qui n'a nul besoin de dépendre des puissances atlantiques.
Disposer d'une théorie géopolitique est l'une des raisons du succès ; les Allemands qui n'en ont pas, et qui n'ont plus d'érudit qui l'a énoncée de manière lucide, sont nettement désavantagés : ils intégraient leur économie au gaz et au pétrole brut russes sans le dire, entre chiens et loups, laissant les choses "se faire" ; et ils sont perdants parce qu'ils n'osent pas énoncer, ni même concevoir, la théorie qui les sauverait (et nous sauverait tous) : "Rester avec Poutine" et s'intégrer à l'est jusqu'en Chine et en Iran.
La victoire de la théorie anglosphérienne de MacKinder a un facteur aggravant pour nous : elle n'est pas censée être appliquée temporairement. La pénurie de gaz et de pétrole brut - foudroyante et autodestructrice pour nos économies - est censée devenir une donnée permanente. Ben van Beurden, directeur général de Shell en Europe, a été clair : le gaz devra désormais être rationné sur le vieux continent, car les pénuries pourraient durer plusieurs années. Pour le Premier ministre belge, le diagnostic est le suivant : la crise durera cinq à dix ans. Mais la vérité est venue de la bouche de l'ancien vice-président d'Aramco, la principale compagnie pétrolière d'Arabie saoudite, qui a une fois de plus réitéré la position du gouvernement de son pays face aux demandes du président américain Joe Biden d'augmenter la production de pétrole : ce n'est pas un problème passager, car il n'y a pas assez de capacité de production dans le monde pour remplacer le gaz russe qu'importait l'Europe.
La passivité et la soumission avec lesquelles le ministre allemand de l'économie et le chef de la principale association d'entreprises du pays ont averti la semaine dernière que l'Allemagne se dirigeait vers l'abîme d'une désindustrialisation rapide sont remarquables. Nombre de ses entreprises, grandes et petites, sont soumises à une "pression énorme menant à une rupture structurelle", ont-ils déclaré, et à leur fermeture éventuelle - acceptant l'épuisement du "modèle économique" centré sur l'utilisation massive d'énergie, principalement importée de Russie, et à des prix inférieurs à ceux que proposent les États-Unis et d'autres exportateurs du monde.
Dans le Corriere, Federico Fubini énonce l'adhésion totale du pouvoir italiote à la théorie de MacKinder : "la guerre économique entre la Russie et l'Union européenne est loin d'être terminée. Et la seule certitude est que le camp capable d'encaisser le plus longtemps les sacrifices que ce conflit implique l'emportera".
Attendre un sauvetage anglo-saxon, qu'attendre du leadership sans qualité de l'Allemagne ?
Mais la crise énergétique touche également les États-Unis. Les administrations Trump et Biden ont toutes deux fait pression par le passé sur l'Allemagne pour qu'elle remplace les importations de gaz russe par du gaz américain, même si celui-ci est plus cher. Aujourd'hui, cependant, les États-Unis n'ont pas la capacité de fournir à l'Europe le gaz qu'ils produisent. Son prix a augmenté de 21,8 % depuis le 2 août, alors que les réserves stratégiques d'énergie chutent à des niveaux dangereux. Cette situation a incité l'administration Biden à demander aux compagnies pétrolières d'arrêter immédiatement les exportations, avertissant que si elles ne le font pas, le gouvernement prendra des mesures d'urgence. Il se trouve qu'à la veille des élections de mi-mandat, le gouvernement se tourne vers sa production pour stabiliser les prix locaux de l'essence.
Entre-temps, la tourmente financière met en évidence un écart grandissant entre la spéculation sur les prix à terme de l'énergie et les réserves physiques d'énergie. La semaine dernière, un rapport de Goldman Sachs a confirmé que le manque de liquidités entraîne une extrême volatilité financière des prix de l'énergie et que cela coexiste avec un resserrement croissant des stocks physiques, ce qui laisse présager de nouvelles turbulences dans les prix de l'énergie. Dans le même temps, de nouveaux alignements importants apparaissent sur la scène géopolitique. La récente signature d'un protocole d'accord entre les gouvernements de la Russie et de l'Iran implique l'investissement de 40 milliards de dollars pour exploiter conjointement leurs réserves de gaz naturel, qui sont parmi les plus importantes au monde.
Il y a un avenir dans le Heartland, mais pas pour nous ...
22:45 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, gaz, énergie, europe, états-unis, russie, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 07 septembre 2022
Nous avons mis nos têtes dans la bouche du canon
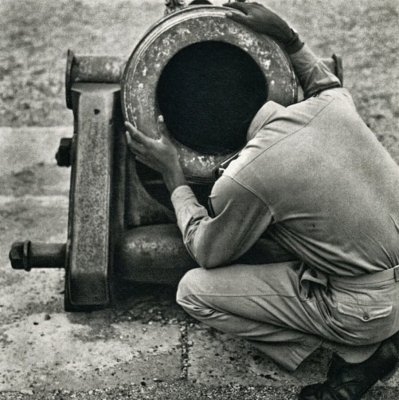
Nous avons mis nos têtes dans la bouche du canon
par Maurizio Murelli
Source : Maurizio Murelli & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/abbiamo-infilato-la-testa-nella-bocca-del-cannone
Résumé
Une fois la guerre froide terminée et l'URSS implosée, l'Occident a commencé à rogner sur les intérêts nationaux de la Russie : élargissement de l'OTAN à l'Est en violation des pactes, agression armée contre des nations qui étaient sous le parapluie protecteur de l'URSS, telles la Serbie, la Libye, la Syrie, l'Irak. Il faut noter que la Russie est mise en cause pour son intervention armée dans le Donbass pour protéger la population qui est en fait soumise à un massacre depuis huit ans avec l'aval des Occidentaux, alors qu'il aurait été légitime et normal qu'en Irak, parmi les casus belli avancés par les Américains, il y ait la protection des Kurdes que Saddam aurait réprimés et contre lesquels des armes chimiques inexistantes étaient sur le point d'être utilisées : huit ans de guerre et des millions de morts. Passons sur l'instrumentalisation des Kurdes et le sort qui leur est réservé en Syrie ou sur la table de négociation pour élargir l'OTAN, passons à la "Légion étrangère" américaine composée d'Européens qui agissent contre les intérêts des Européens.
Après vingt ans de pression sur la Russie, cette dernière réagit lorsque ce qu'elle a toujours considéré comme une ligne rouge insurmontable est franchie : l'annexion de facto de l'Ukraine au système de l'OTAN (qui a aujourd'hui également son mot à dire sur les questions politiques et dicte l'ordre du jour) et sa transformation en une base militaire potentiellement hostile à la Russie. Une nation, l'Ukraine, déjà en faillite économique et littéralement achetée par les Occidentaux, une nation que les mêmes institutions et organisations occidentales ont, dans des temps pas si lointains, déclarée tout sauf démocratique et parmi les meilleurs endroits du monde pour la corruption, une base logistique pour la contrebande d'armes vers l'Afrique et le Moyen-Orient, etc.
Ayant franchi la ligne et empêché ce que l'Occident avait l'intention de faire à son détriment, la Russie est intervenue pour rétablir l'ordre. Et l'Occident, sous l'impulsion des Américains, entre en guerre contre elle : "pour défendre la démocratie lésée", déclare-t-il. Il soutient militairement l'Ukraine et mène une guerre commerciale contre la Russie en annonçant qu'il la mettrait en faillite en une semaine. Le déroulement de ces sanctions, même un imbécile le comprend.
Maintenant, après la question des céréales ukrainiennes sans lesquelles le tiers monde mourrait de faim - alors que, allez savoir pourquoi, on a pu faire partir vingt cargos d'Ukraine, 19 sont arrivés en Europe et un seul est parti vers l'Afrique - la question du gaz est au centre. Ce gaz que l'UE a immédiatement (au lendemain du 24 février) menacé d'arrêter d'acheter "parce qu'avec le gaz Poutine finance la guerre" et qui, maintenant que c'est Poutine qui fait le plein et menace de ne pas fournir, met les chancelleries européennes en ébullition, mettant à nu toute l'insipidité des dirigeants européens. Les gazettes et les politiciens, d'un côté, disent que le prix stratosphérique du gaz n'est pas dû à la guerre mais à la spéculation, de l'autre, parlent de chantage et de représailles poutiniennes (sic !), lui imputant directement le coût du gaz.
Le coût du gaz a commencé à augmenter des mois avant l'intervention russe en Ukraine, mais même si on ne vous le dit pas, il est évident que les spéculateurs étaient bien conscients qu'il y aurait tôt ou tard une guerre en Ukraine. Il est soit naïf, soit de mauvaise foi de prétendre qu'il n'y a pas d'interconnexion entre l'appareil militaro-politique et les bourses, qu'elles traitent de la finance, du gaz ou des navets. En Ukraine, tout était prêt pour lancer une attaque majeure... sur le Donbass et la Crimée, et cela se savait, et dans quelle mesure cela se savait !
Avant l'établissement de la "bourse du gaz", le gaz était acheté par les États avec des contrats à long terme, et l'Italie a encore plusieurs contrats de ce type. C'est pour cette raison que l'ENI a pu réaliser un bénéfice de 700% supérieur, se chiffrant à sept milliards, cette année. Elle vend le gaz qu'elle achète encore au prix prévu par les anciens contrats au prix fixé par la bourse aujourd'hui.
Mais au-delà de la question du prix, le problème aujourd'hui pour l'Europe, et pour l'Italie en particulier, est la disponibilité du gaz, qu'il coûte toujours les 2 euros auxquels il nous était vendu auparavant, ou les 10 euros fixés par la bourse néerlandaise. Et le gaz de la Russie est indispensable. Sans ce gaz, il y aura de la souffrance, pour les familles, pour les entreprises, pour l'économie. Sans le gaz nécessaire, les entreprises vont sauter et on estime que 100.000 entreprises sont d'ores et déjà en danger, avec un million de travailleurs qui seront licenciés ou mis au chômage.
Comment pourrait-on s'en sortir ? Tout d'abord en envoyant le système libéral au diable et en reprenant les négociations directes sur l'achat de gaz à la Russie (la Hongrie le fait), puis en échappant aux sanctions que les États-Unis nous imposent. Car les problèmes pour nous ne viennent pas seulement du gaz. Ou avons-nous oublié la question des engrais, des "terres rares", des différents métaux indispensables à l'industrie, de l'aluminium au cuivre, etc., sans lesquels les entreprises feront immanquablement faillite ?
Hier, M. Zelensky a téléphoné à l'UE germano-centrée pour réclamer un huitième train de sanctions, tandis que la disposition visant à empêcher les touristes russes de venir en Europe a été adoptée à la hâte. Et comme si cela ne suffisait pas, Mme Truss, celle qui affirme n'avoir aucun problème à utiliser des bombes atomiques, est sur le point d'arriver à la tête du gouvernement britannique. Elle s'entendra bien avec Meloni qui, hier encore, n'a pas dédaigné de s'incliner inconditionnellement devant le délire atlantiste, rabrouant en fait Salvini qui, en revanche, avait vu juste sur les sanctions.
Nous ne sommes pas du tout bien placés. Nous avons mis notre tête dans la bouche du canon. L'Europe a décidé de se suicider spectaculairement.
20:30 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, sanctions, europe, russie, gaz, hydrocarbures |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 06 septembre 2022
Les États-Unis pompent les poches des Européens avec l'excuse de la guerre

Les États-Unis pompent les poches des Européens avec l'excuse de la guerre
par Luciano Lago
Source: https://www.ideeazione.com/gli-stati-uniti-stanno-ripulendo-le-tasche-degli-europei-con-la-scusa-della-guerra/
L'Occident collectif parle de l'introduction éventuelle d'un plafond sur les prix du pétrole en provenance de Russie. Toutefois, Moscou ne vendra pas d'or noir aux pays qui prennent une telle mesure, a déclaré le vice-premier ministre Alexander Novak. Quelles conséquences se cachent derrière le désir des États-Unis et de leurs alliés d'isoler la Russie, a demandé l'expert en économie Dmitry Adamidov.
Novak a qualifié de complètement absurde l'idée que les pays du G7 présentent un plan visant à limiter le prix du pétrole russe. L'idée de l'Occident menace la sécurité énergétique du monde entier, a-t-il ajouté. Moscou ne travaillera pas dans des conditions non commerciales.
L'histoire se répète, affirme l'expert économique indépendant Dmitry Adamidov. La Russie a déjà connu des situations similaires: certains pays hostiles ont refusé de payer le gaz en roubles, tandis que d'autres ont refusé d'acheter directement le carburant.
"L'histoire était assez révélatrice. Rien n'a changé, les médiateurs sont juste apparus après les scandales et les cris. Le pétrole fait peut-être une diversion, mais pas tout: des concepts comme le 'mélange letton', le 'pétrole belge' sont apparus. D'où viendrait bien le pétrole en Belgique? Cela semblerait étrange qu'il y en ait. En général, les propres intermédiaires de l'UE en tirent toujours de l'argent", a ajouté l'interlocuteur de PolitExpert.
Cette fois, la situation avec les intermédiaires se répétera, dit l'économiste. Peu importe le nombre de pays qui s'accordent pour fixer un plafond de prix. Selon M. Adamidov, les restrictions imposées peuvent facilement être levées en cas de besoin.
L'Europe fixera un prix plafond pour le pétrole russe, la Russie le vendra en passant par des intermédiaires asiatiques ou américains (comme c'est déjà le cas actuellement avec l'Inde et la Turquie). Le Venezuela peut fournir du pétrole russe. L'Iran peut être mis sur le marché, bien sûr, mais il n'a pas autant de volume pour conquérir une niche. Mais elle conclura simplement un contrat avec la Fédération de Russie et le pétrole russe ira en Europe, mais il sera appelé "iranien".
La Russie a de grandes possibilités de réorienter le marché, la décision de l'Occident ne jouera donc pas un rôle majeur. Il s'agit d'une performance américaine, qui est jouée pour "prendre de l'argent dans la poche des consommateurs" en Europe et dans d'autres pays sous le prétexte de combattre la Fédération de Russie, dit l'interlocuteur de PE. Par conséquent, les restrictions sur le pétrole russe aggraveront une crise qui s'est déjà aggravée, a-t-il conclu :
"L'économie européenne s'effondre. D'ailleurs, les Européens le comprennent, mais ne peuvent rien faire. C'est ainsi que se manifeste leur indépendance politique. De cette manière sophistiquée, les Américains et les autres parties intéressées résolvent leurs problèmes : ils détruisent l'industrie européenne, qui a toujours été l'alliée de la Russie. Les derniers fonds et fournitures sont retirés des poches de la population".
Les pays européens ont ressenti toute la force des sanctions anti-russes, plongeant dans une crise énergétique. Le politologue finlandais Johan Bäckman a prédit des émeutes en Finlande en raison des sales coups perpétrés par le gouvernement d'Helsinki dans la lutte contre la crise énergétique.
Note : Il est difficile de comprendre la logique de la position des eurocrates de Bruxelles qui, dans une situation de marché caractérisée par une forte prévalence de la demande d'énergie sur l'offre, prétendent mettre en place un cartel d'achat au rabais. La manœuvre des eurocrates cache en réalité une subordination aux intérêts des multinationales américaines et une volonté de favoriser les lobbies intermédiaires.
16:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : états-unis, europe, affaires européennes, politique internationale, énergie, pétrole, gaz, russie, sanctions, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Trois articles de l'analyste finlandais Markku Siira sur les récentes turbulences au Xinjiang
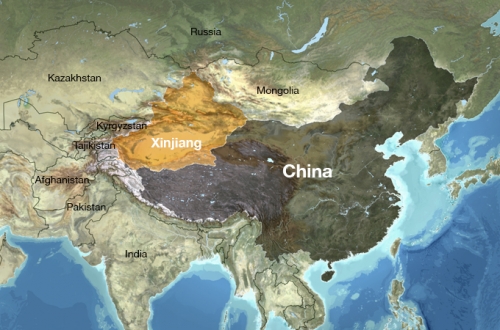
Trois articles de l'analyste finlandais Markku Siira sur les récentes turbulences au Xinjiang
* * *
Pas de surprise: l'organisation américaine derrière la propagande du Xinjiang
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/09/02/ei-mikaan-yllatys-amerikkalaisjarjesto-xinjiangin-propagandan-takana/
Le gouvernement régional chinois du Xinjiang a tenu une conférence de presse en mai, déclarant que la fondation américaine National Endowment for Democracy (NED en abrégé) a été "le principal soutien des forces et organisations anti-chinoises qui cherchent à séparer la région du Xinjiang de la Chine". La NED est également l'organisation à l'origine d'allégations quant à des violations des droits de l'homme.
Selon Liu Weidong, chercheur à l'Institut d'études américaines de l'Académie chinoise des sciences sociales, entre 2004 et 2020, la NED a versé plus de 8,75 millions de dollars à des organisations séparatistes du Xinjiang, ce qui en fait le principal donateur du tristement célèbre "Congrès mondial ouïghour" et d'autres groupes cherchant à séparer la région du Xinjiang de la Chine.
Surnommée la 'seconde CIA', la NED a infiltré divers pays pour inciter les citoyens à s'engager dans le 'militantisme démocratique' afin de servir les intérêts de la politique étrangère américaine. Partout où il y a des "manifestations spontanées" contre des régimes indésirables pour les États-Unis, la NED et ses employés sont derrière l'agitation.

Carl Gershman, qui a dirigé la NED depuis sa fondation en 1984 jusqu'en 2021, a même ouvertement soutenu que la Chine a besoin d'une révolution de couleur pour résoudre les problèmes du Xinjiang et qu'un changement de régime pourrait faire du pays une république fédérale au goût de l'Occident.
En 2022, la NED a financé neuf programmes liés au Xinjiang avec 2,5 millions de dollars. Les programmes comprenaient "l'utilisation des nouveaux médias pour créer de la propagande et la création d'une base de données sur les droits de l'homme des Ouïghours". Ces programmes avaient et ont toujours un objectif très clair : fomenter une soi-disant crise des droits de l'homme en Chine afin de favoriser les objectifs américains et occidentaux.
Non seulement la NED a fourni des fonds à certaines organisations, mais elle a également formé et encouragé les forces anti-chinoises et les groupes séparatistes "à mieux coopérer avec la stratégie américaine visant à contenir la Chine".
Qu'ont fait les organisations séparatistes avec le soutien de la NED ? Liu a déclaré que pour obtenir la reconnaissance de la NED, les séparatistes du Xinjiang et le Congrès Ouïghour Mondial ont travaillé dur pour fabriquer des mensonges et répandre la désinformation sur le Xinjiang. Cette propagande est truffée d'accusations exagérées allant des "camps de concentration" au "génocide" et aux "crimes contre l'humanité", utilisant le vocabulaire typique des acteurs occidentaux.
Le Congrès mondial ouïghour, fondé aux États-Unis en 2004, avec l'aide des forces anti-chinoises des États-Unis et de l'Occident, a mis en place un "tribunal ouïghour", dans lequel des personnes révélées par la suite comme étant des acteurs payés dans des apparitions médiatiques ont fait de faux témoignages sur des "violations des droits de l'homme", tandis que les médias occidentaux continuent de diffuser ces allégations.
Depuis la fin du 20ème siècle, les États-Unis, qui ont tout militarisé, ont toujours utilisé les "droits de l'homme" comme prétexte pour s'ingérer dans les affaires des autres pays et même pour déclencher des guerres, provoquant de graves crises humanitaires et des flux de réfugiés en Europe et ailleurs. "Afin de promouvoir le processus d''américanisation', la NED est également active en Ukraine depuis longtemps.
"Les États-Unis accusent toujours avec arrogance les autres pays de violations des droits de l'homme, alors qu'ils sont eux-mêmes la principale cause des catastrophes humanitaires, les destructeurs de l'ordre international, les violateurs des droits de l'homme et les auteurs de génocides", a déclaré Xu Guixiang, porte-parole du gouvernement régional du Xinjiang, lors d'une conférence de presse en mai.
Malgré les opérations américaines, la population du Xinjiang jouit d'une vie stable sans attaques terroristes soutenues par l'Occident depuis plus de cinq ans. Le Congrès mondial ouïghour et d'autres mouvements anti-chinois continueront sûrement à fabriquer des histoires sensationnelles - du moins tant que l'argent de l'aide occidentale sera disponible.
* * *

Les manigances occidentales en matière de droits de l'homme - Rapport de l'ONU sur le Xinjiang
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/09/01/lannen-ihmisoikeusaseen-laukauksia-ykn-raportti-xinjiangista/
Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a publié un rapport sur le traitement des musulmans ouïghours dans le Xinjiang, en Chine, à la fin de son mandat de quatre ans. Bachelet a visité le Xinjiang en Chine en mai.
Le poste de Haut Commissaire aux droits de l'homme fait souvent l'objet de pressions politiques intenses dans le monde entier. Presque tous les commissaires ont quitté leur poste après un mandat, et Bachelet ne fait pas exception.
Depuis son voyage au Xinjiang, la déléguée chilienne a notamment été critiquée pour ne pas avoir adopté une position assez ferme sur la situation des Ouïghours. Il ne fait aucun doute que Bachelet subit la pression des États-Unis, qui cherchent à renverser le régime socialiste en Chine.
J'ai déjà écrit sur les Ouïghours et la campagne anti-chinoise de l'Occident - qui est également perceptible en Finlande - mais il semble que le sujet doive être revisité.
Puisque les grands médias occidentaux, avec leurs journalistes, se chargent de la critique habituelle de la Chine, je vais me concentrer sur d'autres points de vue. Il y a quelques éléments qui ressortent du récent rapport de l'ONU et qui ne manqueront pas d'être négligés par les médias grand public, alors permettez-nous au moins de corriger cela.
La grande majorité des violations présumées des droits de l'homme sont basées sur le témoignage de quarante personnes, et la plupart d'entre elles ont déjà été interrogées par des organisations et des journalistes qui ont supposé, comme si c'était une évidence, que leurs rapports sont vrais.
 Le rapport mentionne également cinq fois le think-tank australien Australian Strategic Policy Institute comme source, même si cet institut fait bel et bien partie du département de propagande relevant du complexe militaro-industriel occidental, qui cherche à produire du matériel anti-chinois pour étayer la "stratégie indo-pacifique" des Américains. Ce seul fait place le contenu du rapport sous un jour bien étrange.
Le rapport mentionne également cinq fois le think-tank australien Australian Strategic Policy Institute comme source, même si cet institut fait bel et bien partie du département de propagande relevant du complexe militaro-industriel occidental, qui cherche à produire du matériel anti-chinois pour étayer la "stratégie indo-pacifique" des Américains. Ce seul fait place le contenu du rapport sous un jour bien étrange.
Le rapport de l'ONU répète les récits occidentaux, tissés de sarcasmes, sur la politique chinoise de planning familial, sur la mauvaise nature de l'ingérence dans l'extrémisme religieux et sur la destruction des mosquées, même si le nombre de mosquées dans la région du Xinjiang est l'un des plus élevés au monde.
Le rapport, publié juste à temps pour le congrès du parti communiste chinois, répète des allégations basées sur des sources non vérifiées, des traductions "non officielles" de documents chinois et des interprétations subjectives de la loi chinoise.
Même si le rapport de l'ONU était considéré comme l'entière vérité, il prouverait au mieux que la Chine, qui essaie de tout faire le plus efficacement possible, a éradiqué l'extrémisme islamiste au Xinjiang pour des raisons de sécurité nationale et conformément à la loi chinoise.
Cependant, les discours occidentaux sur les "crimes contre l'humanité" et le "génocide" sont des exagérations propagandistes sans aucun fondement dans la réalité. Si les États-Unis, par exemple, disposaient de preuves solides de tels crimes, ils n'auraient pas à se contenter de vagues insinuations et d'une campagne de dénigrement. Cependant, tous les moyens sont utilisés dans la guerre de l'information et pour obtenir de l'influence hybride.
Le cas des musulmans ouïghours semble être examiné de près par les pays musulmans. Pourtant, seuls les États-Unis et leurs alliés occidentaux lancent des allégations sur de soi-disant mauvais traitements infligés aux Ouïghours, alors que ce sont eux qui ont tué des millions de musulmans et provoqué d'énormes flux de réfugiés avec leurs sales guerres. Après tout cela, l'inquiétude de l'Occident au sujet des Ouïghours ne semble pas très crédible.
La Chine a également publié une réponse succincte au rapport de l'ONU, qui clarifie la situation passée au Xinjiang, les attaques terroristes et les activités extrémistes. Bien entendu, les médias occidentaux ne donnent pas beaucoup de détails à ce sujet. Dans les déclarations chinoises, les allégations de génocide au Xinjiang ont été qualifiées de "mensonge du siècle".
L'"arme des droits de l'homme", maniée par l'Occident, est pointée sur la Chine pour des raisons de luttes de pouvoir géopolitiques et géoéconomiques et de ressources naturelles. J'ai bien deviné, il y a quelque temps, que les Ouïghours étaient évoqués surtout en raison des énormes gisements de pétrole et de gaz découverts dans le Xinjiang. Les oligarques cupides de l'Occident n'y auront pas accès tant que la Chine sera dirigée par un régime nationaliste.
La guerre de l'Occident contre la Chine se poursuit sur tous les fronts et les enjeux augmentent. Si les manifestations en faveur des droits de l'homme et la rhétorique de la révolution de couleur ne parviennent pas à renverser le régime socialiste en Chine, il y aura certainement, tôt ou tard, une transition de la guerre de l'information à la confrontation armée.
* * *

Les États-Unis veulent un changement de pouvoir en Chine
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/08/31/yhdysvallat-haluaa-vallanvaihdon-kiinassa/
Le vingtième congrès national du parti communiste chinois est prévu pour le 16 octobre. À cette occasion, les délégués définiront la stratégie et les priorités de développement de la Chine et éliront un dirigeant pour le pays qui exercera ses fonctions pendant les cinq prochaines années.
Selon Valery Kulikov, il est probable que l'actuel secrétaire général du Parti, Xi Jinping, soit réélu pour un troisième mandat, car la règle selon laquelle une même personne ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs en tant que secrétaire général a été abolie en 2018.
Xi Jinping est à la tête du Parti communiste depuis près de dix ans et, durant cette période, il s'est constamment concentré sur le renforcement de la souveraineté nationale de la Chine dans l'arène politique, ainsi que dans les domaines du commerce, de l'économie et de la science.
Cette politique a certainement renforcé son autorité personnelle en Chine, mais elle s'est également attirée les foudres des puissances occidentales, et Washington est désormais déterminé à trouver un moyen d'écarter Xi du pouvoir.
De nombreux membres de l'administration de Joe Biden ont exprimé leur opposition à la politique chinoise actuelle. En mai de cette année, le secrétaire d'État Antony Blinken a décrit la Chine comme "le plus sérieux défi à long terme pour l'ordre international". Il a ajouté que la seule réponse à la "menace" posée par Pékin était la "dissuasion unie" et "l'investissement dans les forces armées".

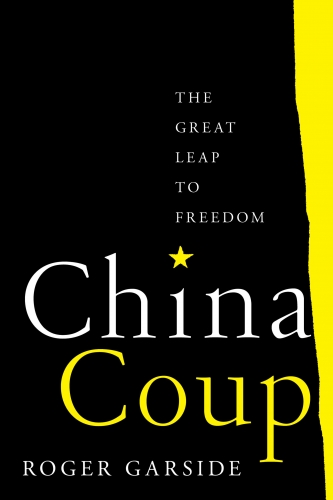
L'attitude de l'élite américaine a été traduite dans les couvertures du livre par l'ancien diplomate Roger Garside, qui, dans son livre China Coup : The Great Leap to Freedom, a décrit sans vergogne comment l'actuel dirigeant chinois pourrait être renversé par une révolte organisée par ses rivaux politiques. Quoi qu'il en soit, les auteurs du coup d'État passeraient alors d'un régime socialiste à une démocratie libérale de type occidental.
Dans son livre, Garside affirme que sous le "leadership trop affirmé" de Xi, la Chine a été mise sur une trajectoire de collision avec les États-Unis. La "révolution de palais" de Pékin serait déclenchée par la menace d'une guerre commerciale portant atteinte à l'économie chinoise. Dans le scénario de Garside, les États-Unis dirigent astucieusement la "cinquième colonne" de la Chine et créent les conditions pour que les rivaux de Xi puissent l'affronter.
Les idées pour un changement de pouvoir ne se limitent pas au niveau de l'écriture. Au début de l'année, George Soros, spéculateur milliardaire de 92 ans, partisan convaincu de toutes les "révolutions de couleur" fomentées par l'Occident, a lancé un appel à peine voilé à un changement du régime communiste lors d'une réunion du Forum économique mondial, qualifiant Xi Jinping de "plus grande menace pour l'ordre mondial libéral".
Dans une tentative d'organiser une révolution dans la Chine nationaliste, Soros et ses diverses organisations ont ciblé les jeunes élites économiques et financières du pays dans l'espoir qu'elles puissent agir comme une opposition pro-occidentale face aux vétérans du parti et aux militaires et créer une crise politique intérieure en Chine.
Par le biais de sa fondation, Soros suit toujours la même formule utilisée à l'approche des coups d'État : travailler avec des jeunes gens politiquement actifs et sélectionner les candidats les plus "prometteurs", les plus vulnérables aux tentations du libéralisme, pour les former aux États-Unis et en Europe afin de promouvoir les intérêts des capitalistes financiers occidentaux.
Mais les plans du spéculateur monétaire vieillissant et de l'élite dirigeante occidentale sont entravés par le fait qu'au cours des cinq dernières années, le régime de Xi Jinping a mis en place un certain nombre de mécanismes pour contrer l'influence étrangère : le Parti communiste a désormais une hiérarchie de commandement plus forte et le pays a également lancé des campagnes de lutte contre la corruption.
Par conséquent, la campagne de sabotage n'a pas réussi comme prévu initialement. Washington a donc changé de tactique et lancé une nouvelle campagne anti-chinoise axée sur les aspirations à l'indépendance de l'île taïwanaise.
Washington a choisi Taïwan comme point central de son offensive contre la Chine continentale parce que les précédentes tentatives de déstabilisation, axées sur le Xinjiang et Hong Kong, ont échoué lamentablement.
Cela est apparu clairement ce printemps lorsque Michelle Bachelet, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, est revenue d'une visite dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang et a été accusée, après une conférence de presse, d'être "trop douce avec la Chine". Les communautés musulmanes du monde entier ont également protesté contre les tentatives d'utiliser les Ouïghours comme une arme de propagande contre la Chine.
Les tentatives de Washington d'organiser des manifestations hostiles à Xi Jinping à Hong Kong à l'été 2019 n'ont pas mieux réussi. Les projets visant à reconnaître Hong Kong comme un État indépendant et à établir des relations commerciales distinctes avec lui, excluant ainsi la Chine, ont échoué sur des amendements juridiques. Les "experts" de Washington ont ensuite ciblé l'île de Taiwan.
Début août, l'administration Biden a envoyé Nancy Pelosi, chef du parti démocrate à la Chambre des représentants, faire un voyage provocateur à Taipei. L'objectif de cette visite était d'humilier Xi Jinping et de saper sa position politique, ainsi que d'inciter les électeurs américains à soutenir les démocrates lors des prochaines élections de mi-mandat.
Washington est bien conscient qu'en ce moment, peu avant le congrès du Parti communiste chinois, la stabilité sociale, économique et politique est d'une importance capitale pour Pékin, aussi tous les efforts sont déployés pour déstabiliser le régime de Xi.
Ayant fait leur premier pas dans le jeu de Taïwan, les États-Unis ont continué à provoquer avec d'autres visites politiques sur l'île. Le 14 août, une délégation du Congrès dirigée par le sénateur Ed Markey et soutenue par quatre autres sénateurs est arrivée à Taipei pour une visite de deux semaines. Ensuite, le gouverneur républicain de l'Indiana, Eric Holcomb, et, peu après, la sénatrice du Tennessee, Marsha Blackburn, ont à leur tour rendu visite à Taïwan.
Pour montrer sa loyauté envers les États-Unis, la Lituanie, petit État vassal balte toujours prêt à soutenir tout projet d'hégémonie occidentale, a également envoyé une délégation dirigée par le vice-ministre des Transports et des Communications Agne Vaiciukevičiūtė pour un voyage de cinq jours à Taïwan. La Lituanie a déjà pris position contre la Chine par le passé, "pour être du bon côté du nouveau rideau de fer".

Le Japon, vieil ennemi de la Chine en Asie, a également suivi l'exemple de son hôte transatlantique et a envoyé une délégation dirigée par l'ancien ministre de la défense, le libéral-démocrate Shigeru Ishiba (photo), pour un voyage de quatre jours à Taiwan. Peu après, un autre homme politique japonais, Keiji Furuya, s'est également rendu sur l'île chinoise.
Kulikov interprète l'objectif de ces visites comme une volonté de "faire pression sur Taipei pour que l'île fasse une déclaration formelle d'indépendance dans l'espoir qu'une réponse modérée de la Chine à ces provocations sera perçue comme un coup porté à l'autorité du parti au pouvoir en Chine et de Xi Jinping".
Alors que les événements ci-dessus se déroulent, les États-Unis et la Chine ont tous deux démontré leur puissance militaire dans les eaux au large de Taïwan. Il est probable que les États-Unis continueront à proférer des menaces dans l'espoir que la Chine fasse une erreur et entre dans un conflit qui entraînera des difficultés similaires à celles auxquelles la Russie a été confrontée avec l'opération en Ukraine.
L'administration de Xi Jinping est certainement consciente des plans cyniques de Washington. Pékin s'est très probablement préparé aux machinations des États-Unis, évaluant différents scénarios et préparant des contre-mesures pour l'automne.
16:24 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, xinkiang, asie, affaires asiatiques, taïwan, états-unis, ned, politique internationale, actualité, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 02 septembre 2022
Quelques réflexions sur Gorbačëv et la fin de l'URSS

Quelques réflexions sur Gorbačëv et la fin de l'URSS
par Gennaro Scala
Source: Gennaro Scala & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/qualche-riflessione-su-gorba-ev-e-la-fine-dell-urss
L'effondrement de l'Union soviétique a été entièrement dû à l'idiotie de Gorbačëv, tel qu'il semble être compris à partir des "célébrations" de certains à l'annonce de sa mort. Cela dénote la régression infantile, qui comporte aussi une barbarie considérable, dans laquelle sont tombés ceux qui prétendent se référer à Marx, connu, entre autres, pour avoir promu l'analyse structurelle. Il faut se demander comment une seule personne a pu faire échouer tout un système qui, jusqu'à quelques années auparavant, rivalisait pour l'hégémonie avec les États-Unis, et il faut se demander comment quelqu'un comme Gorbačëv est arrivé à la tête de l'Union soviétique.
Quelles ont été les causes de l'effondrement de l'Union soviétique est une question trop complexe pour être traitée de manière adéquate dans un message sur FB, j'en ai traité indirectement dans mon livre "Pour un nouveau socialisme". Je voudrais ici soulever une question : le mondialisme. Marx voulait donner au communisme une perspective mondialiste. Extrait d'un article important, très négligé par les "marxologues", son dernier article publié dans le Rheinische Zeitung dans les derniers jours de 1848, avant son exil en Angleterre, où il désigne l'Angleterre elle-même comme le principal ennemi de la révolution, mais déclare en même temps qu'étant donné sa puissance mondiale, seul un mouvement de portée mondiale pourrait la vaincre. C'est grâce à cette approche mondialiste que le communisme soviétique a pu être un défi mondial à l'hégémonie mondiale des États-Unis qui a succédé à celle de l'Angleterre (pour plus de détails, voir mon livre précité).
Dans le défi mondial lancé à l'hégémonie américaine, l'Union soviétique a perdu pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien qu'étant un mondialisme, le soviétisme n'était pas un véritable impérialisme, c'est-à-dire avec les connotations économiques du terme, capable de drainer des pays subordonnés vers le centre des ressources à utiliser dans la compétition avec les Etats-Unis.
Pour des raisons inhérentes aux conditions exceptionnelles dans lesquelles l'État soviétique est né, et pour les immenses défis auxquels il a été confronté à sa naissance et plus tard avec l'attaque nazie, il n'a jamais surmonté la centralisation du pouvoir étatique, de sorte qu'une formation étatique stable n'a jamais été atteinte, l'État soviétique étant toujours géré selon les critères de l'État d'exception. Cela était également dû à l'absence d'une théorie efficace de l'État au sein du marxisme. Domenico Losurdo a mis l'accent sur ces deux questions.
Le défi avec les États-Unis n'était pas le défi entre deux systèmes de vie différents. Que le travailleur soit employé par une entreprise privée ou qu'il soit employé par l'État, nous avons la même aliénation de ses conditions de vie, alors que le communisme de Marx aspirait à la libération du travailleur qui consistait à pouvoir contrôler ces conditions de vie, qui passent avant tout par le travail. Sous le prétexte qu'il s'agissait d'un pays socialiste en Union soviétique, même les syndicats ont été interdits (alors que Lénine avait déclaré que les syndicats devaient subsister afin de "défendre les travailleurs contre leur propre État").

Par conséquent, certaines nations européennes avec une forte présence syndicale étaient plus socialistes. Pour ces raisons, les Soviétiques ont souffert de l'hégémonie du "consumérisme" occidental. Sauf que si un ingénieur occidental pouvait acheter une Mercedes, la plus haute aspiration d'un ingénieur soviétique pouvait être la Trabant. Certains philosophes tels que Lukács et son élève Agnes Heller (photo) ont écrit qu'au lieu de rivaliser sur la consommation, le système aurait dû offrir la possibilité d'une "vie raisonnable", comme une extension de la "bonne vie" aristotélicienne au monde actuel (un thème qui reste très pertinent aujourd'hui), mais cela aurait signifié permettre une participation politique que le système soviétique ne pouvait pas permettre. En Union soviétique, une classe moyenne s'est formée, nécessaire dans la sphère de la production, le complexe militaire, l'éducation, la bureaucratie d'État, etc., mais elle était comprimée dans la consommation et le mode de vie, ce qui fit qu'elle s'est finalement tournée vers le mode de vie occidental. C'était la base de Gorbačëv dans le parti communiste qui a fini par liquider l'État. C'est la thèse de Costanzo Preve.
La première fissure majeure dans le mondialisme soviétique s'est produite avec la Chine, qui a rejeté la doctrine Brejnev d'intervention dans les pays socialistes qui ne suivaient pas les directives soviétiques, ce qui a conduit à une quasi guerre à la frontière avec la Russie en 1969. Cette rupture a ensuite conduit à la normalisation des relations entre la Chine et les États-Unis avec la visite de Nixon en 1972, qui a jeté les bases de la collaboration économique et de l'exportation de capitaux. Les États-Unis pensaient subjuguer la Chine, mais étant donné le contrôle conservé par l'État chinois sur l'économie, cela n'a conduit qu'à l'industrialisation ultime de la Chine. D'une certaine manière, le gorbatchevisme était interne au communisme, mais il n'en a retenu que le "bon" côté universaliste, la paix entre les peuples, la coexistence, etc., mais a oublié la question de l'impérialisme, croyant aux fausses promesses occidentales de détente et de collaboration.
Les États-Unis en ont profité pour démolir le système d'alliance soviétique, visant en fin de compte la démolition de la Russie elle-même. La guerre actuelle en Ukraine est elle-même le résultat de cette politique américaine.
La naissance du monde multipolaire s'est d'abord présentée comme un mondialisme alternatif. Mais un tel mondialisme était voué à la défaite, tout comme le mondialisme libéral, car il contredisait la dynamique fondamentale de notre monde. Probablement qu'avec une classe politique moins désorientée et avec moins d'illusions que celle de Gorbatchev, cette transition nécessaire aurait été moins traumatisante pour la Russie.
Cette déclinaison mondialiste particulière du socialisme qu'était le communisme appartient désormais définitivement au passé. S'il doit y avoir un socialisme de l'avenir, ce sera un socialisme qui saura se penser dans le monde multipolaire de demain.
15:41 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, mikhail gorbatchev, russie, urss, histoire, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Donation américaine de plusieurs millions de dollars: une fondation de gauche veut renverser Orbán - et Soros se pointe à nouveau...

Donation américaine de plusieurs millions de dollars: une fondation de gauche veut renverser Orbán - et Soros se pointe à nouveau...
Source: https://zuerst.de/2022/09/01/millionenspende-aus-den-usa-linke-stiftung-wollte-orban-stuerzen-und-soros-ist-wieder-dabei/
Budapest/New York. En Hongrie, un solide scandale politique fait grand bruit: une fondation dirigée par des critiques du gouvernement hongrois d'Orbán et par d'éminents gauchistes américains a apporté un soutien financier considérable à l'opposition hongroise à l'approche des dernières élections législatives d'avril, dans le but de provoquer un changement de gouvernement à Budapest. Mais : les contributions financières étrangères aux partis politiques hongrois sont interdites. Des accusations d'abus se font déjà entendre dans les cercles du parti au pouvoir, le Fidesz.
Péter Márki-Zay, maire de Hódmezővásárhely (sud-est de la Hongrie) et ancien candidat à la présidence pour les élections législatives d'avril, a lui-même attiré l'attention sur cette affaire. En ce qui concerne les comptes détaillés de la campagne électorale, qu'il vient seulement de voir, Márki-Zay a admis qu'il avait reçu plusieurs millions de forints en provenance des Etats-Unis en juillet et que ces fonds devaient maintenant servir à payer les factures de la campagne.
Il n'a pas caché que tous les dons avaient été utilisés pour tenter de "renverser" le Premier ministre Orbán - et qu'ils continueraient à l'être.
Selon Márki-Zay, les dons proviennent d'une fondation américaine appelée Action for Democracy, qui n'a été créée qu'en février 2022, juste avant les élections hongroises.

Entre-temps, Action for Democracy ne se concentre plus exclusivement sur la Hongrie. Sur son site Internet, la fondation dresse la liste des "principaux pays contestés dans le monde", "où nous estimons que la démocratie est la plus menacée et où des élections auront lieu l'année prochaine, qui décideront du sort de ces démocraties". Il s'agit notamment de l'Italie, du Brésil, de la Hongrie, de la Pologne et de la Turquie. Dans tous ces pays, les partis nationaux-conservateurs sont au pouvoir ou, comme dans le cas de l'Italie, ont de fortes chances de remporter les prochaines élections.
Bien que le conseil consultatif de la fondation soit présidé par l'écrivain hongrois Kati Marton, il compte de nombreux autres membres éminents, dont l'historien britannique Timothy Garton Ash, l'historienne américaine Anne Applebaum, l'ancien commandant en chef de l'OTAN, le général Wesley K. Clark, le politologue libéral américain Francis Fukuyama, l'historien américain Timothy Snyder et l'ancien ministre des affaires étrangères britannique David Milliband.
Le responsable de la communication du Fidesz, István Hollik, a indiqué aux médias qu'il était illégal en Hongrie qu'un parti reçoive des fonds de l'étranger. Selon lui, Márki-Zay et son équipe ont "abusé de la loi" puisqu'ils ont reçu les fonds sur le compte de leur association. Hollik a également attiré l'attention sur le fait qu'Action for Democracy avait des "milliers de liens" avec George Soros. (mü)
Demandez ici un exemplaire de lecture gratuit du magazine d'information allemand ZUERST ! ou abonnez-vous ici dès aujourd'hui à la voix des intérêts allemands: https://zuerst.de/abo/ !
Suivez également ZUERST ! sur Telegram : https://t.me/s/deutschesnachrichtenmagazin
14:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hongrie, actualité, viktor orban, george soros, europe, europe centrale, europe danubienne, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nouvelle doctrine de sécurité européenne : soutenir l'Ukraine - jusqu'à sa propre ruine

Nouvelle doctrine de sécurité européenne: soutenir l'Ukraine - jusqu'à sa propre ruine
Source: https://zuerst.de/2022/08/30/neue-europaeische-sicherheitsdoktrin-unterstuetzung-fuer-die-ukraine-bis-zum-eigenen-ruin/
La Haye/Berlin. Une position de plus en plus radicale s'impose dans la politique européenne vis-à-vis de l'Ukraine: alors qu'aux Etats-Unis, des voix de plus en plus fortes appellent le gouvernement américain à la retenue, les partisans inconditionnels de la guerre semblent désormais prendre le dessus dans les capitales d'Europe occidentale.
Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) a récemment déclaré que l'Allemagne soutenait pleinement le gouvernement de Kiev à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août. Dans son message de bienvenue, que Scholz a conclu par les mots "Slava Ukraini" ("Salut à l'Ukraine !"), il a annoncé que l'Allemagne se tenait "fermement aux côtés de l'Ukraine menacée, aujourd'hui et aussi longtemps que l'Ukraine aura besoin de notre soutien".
L'Allemagne poursuivra également les sanctions contre la Russie, continuera à soutenir financièrement l'Ukraine, à l'aider à se reconstruire, à transporter des céréales ukrainiennes par train vers les ports européens, à soigner les Ukrainiens blessés dans les hôpitaux allemands et à accueillir les réfugiés ukrainiens, a poursuivi le chancelier.
Peu de temps après, la ministre allemande des Affaires étrangères, Mme Baerbock (Verts), a confirmé cette position et a assuré à l'Ukraine, dans une interview accordée au journal Bild am Sonntag, qu'elle continuerait à la soutenir dans sa lutte contre la Russie pendant des années si nécessaire, par exemple en lui fournissant des armes lourdes.

"Bien sûr, je souhaiterais que la guerre se termine le plus rapidement possible, mais nous devons malheureusement partir du principe que l'Ukraine aura encore besoin de nouvelles armes lourdes de la part de ses amis l'été prochain", a déclaré Mme Baerbock, ajoutant : "Pour moi, c'est clair : l'Ukraine défend aussi notre liberté, notre ordre de paix, et nous la soutenons financièrement et militairement - et ce aussi longtemps que nécessaire. Point final".
Le gouvernement fédéral allemand n'est pas seul à adopter cette position. Le gouvernement néerlandais, dirigé par le Premier ministre libéral Mark Rutte, lui a emboîté le pas. La ministre de la Défense Karin Hildur "Kajsa" Ollongren (photo) a annoncé que son gouvernement n'avait pas de limite quant au nombre d'armes qu'il fournirait à l'Ukraine pour contrer l'invasion russe. La ministre est membre du parti libéral de gauche D'66 ("Démocrates '66").

"L'industrie doit livrer des armes aux Pays-Bas et en Ukraine, et nous devons financer cela", a déclaré la ministre de la Défense.
Aux Pays-Bas aussi, les livraisons massives d'armes à l'Ukraine nuisent désormais à leur propre capacité de défense. Ces derniers mois, les Pays-Bas, membre de l'OTAN, ont fait don de la quasi-totalité de leurs stocks d'armes à l'Ukraine, pour une valeur d'environ 210 millions d'euros, et ne pourraient donc plus remplir leurs obligations envers l'OTAN en cas d'urgence. Pour la ministre de la Défense, ce n'est pas un problème : elle a déclaré qu'elle allait commander de nouvelles armes aux entreprises d'armement et les transmettre immédiatement à Kiev. (mü)
Demandez ici un exemplaire gratuit du magazine d'information allemand ZUERST ! ou abonnez-vous dès aujourd'hui à la voix des intérêts allemands: https://zuerst.de/abo/ !
Suivez également ZUERST ! sur Telegram : https://t.me/s/deutschesnachrichtenmagazin
13:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, allemagne, pays-bas, ukraine, défense |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 31 août 2022
Analyse de la stratégie des Etats-Unis en Afrique: Washington peut-il rattraper la Chine?

Analyse de la stratégie des Etats-Unis en Afrique: Washington peut-il rattraper la Chine?
Leonid Savin
Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/analysis-us-strategy-africa-can-washington-catch-china
Au début du mois d'août, la Maison Blanche a publié un mémorandum pour une stratégie en Afrique subsaharienne [i]. Il s'agit d'un document assez unique qui expose les objectifs et les méthodes des États-Unis dans la région. Ce faisant, le texte lui-même commence par une citation du secrétaire d'État Anthony Blinken, qui a déclaré en novembre 2021 que "l'Afrique façonnera l'avenir - et pas seulement l'avenir du peuple africain, mais celui du monde entier". Cela peut sembler plutôt inhabituel, puisque le département d'État publie habituellement ses propres stratégies.
Cette approche indique une action synchronisée de diverses agences. Le Département du commerce, le Pentagone et d'autres organismes, allant des gouvernements fédéraux aux gouvernements locaux, poursuivront également activement leurs objectifs. Les différents exemples cités dans le document montrent que ce travail est déjà en cours depuis des années.
La question est de savoir comment atteindre un nouveau niveau et consolider leur influence. Car dans tous les cas, Washington sera confronté à la nécessité de contrer d'autres acteurs actifs en Afrique. Il s'agit avant tout de la Chine et de la Russie, qui sont ouvertement présentées comme des défis et des problèmes pour les intérêts américains dans la région.
"La République populaire de Chine considère la région comme une arène importante pour défier l'ordre international fondé sur des règles, promouvoir ses propres intérêts commerciaux et géopolitiques étroits, miner la transparence et l'ouverture et affaiblir les relations des États-Unis avec les peuples et les gouvernements africains".
"La Russie considère la région comme un environnement fertile pour les entreprises militaires para-étatiques et privées, qui fomentent souvent l'instabilité pour des gains stratégiques et financiers. La Russie utilise ses liens sécuritaires et économiques ainsi que la désinformation pour saper l'opposition de principe des Africains à la poursuite de l'invasion russe en Ukraine et aux violations des droits de l'homme qui y sont liées", indique le rapport".
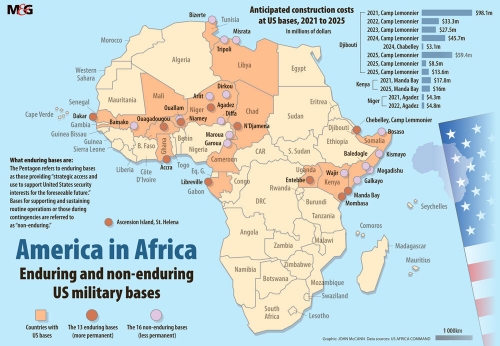
En somme, la stratégie énonce quatre objectifs pour faire avancer les priorités des États-Unis avec leurs partenaires régionaux au cours des cinq prochaines années. Elle indique que "les États-Unis utiliseront toutes leurs capacités diplomatiques, de développement et de défense, et renforceront leurs liens commerciaux en se concentrant sur les écosystèmes numériques et en se recentrant sur les pôles urbains pour soutenir ces objectifs :
- 1) Promouvoir l'ouverture et les sociétés ouvertes ;
- 2) fournir un dividende pour la démocratie et la sécurité ;
- 3) Promouvoir la reprise post-pandémique et les opportunités économiques ;
- 4) Soutenir la conservation, l'adaptation au changement climatique et une transition énergétique juste.
Examinons de plus près ces points. Le premier objectif est énoncé dans le style de l'Open Society Institute de George Soros. Il est possible que ses actifs soient également utilisés pour transformer les systèmes politiques des pays africains. Comme le parti démocrate américain et le programme de George Soros en général, la Maison Blanche estime qu'il y a trop de régimes autoritaires dans la région qui doivent être remplacés par des régimes plus fidèles aux États-Unis.
En clair, un coup d'État par le biais d'une révolution de couleur ou en corrompant les autorités en place. Bien que la Maison Blanche déclare extérieurement la nécessité de lutter contre la corruption, il est clair pour tout le monde que la politique étrangère américaine elle-même utilise activement des éléments de corruption, que l'on appelle pudiquement "lobbyisme".
Il est noté que "malgré un fort soutien populaire à la démocratie en Afrique subsaharienne - quelque 69% selon de récents sondages - la démocratie fait toujours défaut. Ces dernières années, l'Afrique a été en proie à une succession de coups d'État militaires et d'échecs démocratiques, ce qui pourrait entraîner une nouvelle détérioration des conditions de gouvernance et de sécurité, ainsi que des conséquences négatives pour les pays voisins.
En 2022, Freedom House a classé seulement huit pays d'Afrique subsaharienne comme libres - le nombre le plus bas depuis 1991. Ces échecs ont accru les possibilités d'influence étrangère indue et reflètent la montée en puissance de gouvernements qui utilisent les technologies de surveillance, diffusent des informations erronées, exploitent la corruption et commettent des violations des droits de l'homme en toute impunité.
Alors que les forces démocratiques ont récemment remporté les élections au Malawi et en Zambie, les dirigeants autocratiques des autres pays gardent un contrôle étroit du pouvoir. Le décalage entre les aspirations de la population et la fermeture de l'espace civique dans certains pays a entraîné une instabilité accrue et une vague de mouvements de protestation."
Cette citation mentionne "l'influence étrangère indue", qui peut également être attribuée à l'ingérence des États-Unis dans la région, à la fois directement et par le biais de proxies et de satellites européens.
En ce qui concerne les méthodes sur le premier point, le soutien aux réformes, la création de diverses fondations et initiatives, l'assistance juridique et la promotion des droits de l'homme sont mentionnés. Il est probable que cela se fasse en mettant l'accent sur le contrôle des ressources naturelles, ce qui est voilé derrière un verbiage tel "aider à atteindre la transparence dans l'utilisation de ses ressources naturelles, y compris les ressources énergétiques et les minéraux essentiels, pour un développement durable, tout en aidant à renforcer les chaînes d'approvisionnement qui sont diverses, ouvertes et prévisibles".
Il ne fait aucun doute que par lesdites chaînes d'approvisionnement, on entend une monopolisation par les États-Unis d'importants produits de base et matières premières provenant des pays africains. La façon dont les entreprises américaines obtiendront la marge est une autre question. Cela peut se faire par le biais d'actions, du paiement de services de conseil ou déguisé en prêts et crédits destinés à des projets pertinents.
Pour le moins, ce genre d'énergie de la part de Washington devrait rendre les gouvernements africains méfiants. D'autant plus qu'on ne leur a pas demandé ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin.
Le deuxième point est directement lié au premier. Voici une citation qui permet de comprendre parfaitement ce que les États-Unis veulent dire :
"Les États-Unis soutiendront les démocraties africaines en soutenant la société civile, notamment les activistes, les travailleurs et les dirigeants soucieux de réforme ; en donnant des moyens d'action aux groupes marginalisés tels que les personnes LGBTQ+ ; en se concentrant sur les voix des femmes et des jeunes dans les efforts de réforme ; et en protégeant les élections libres et équitables en tant que composantes nécessaires mais non suffisantes des démocraties dynamiques. Les États-Unis soutiendront l'ouverture et les opportunités démocratiques en s'appuyant sur l'Initiative présidentielle pour le renouveau démocratique, le Sommet pour la démocratie et l'Année de l'action.
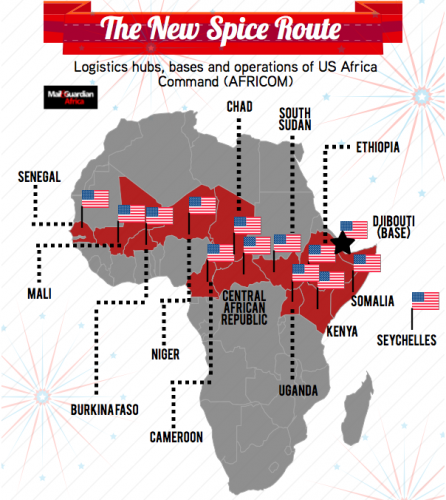
Les États-Unis concentreront leurs efforts diplomatiques, tireront parti de leurs programmes de développement et utiliseront leurs outils de défense pour renforcer et permettre à leurs partenaires de répondre aux causes des conflits dans toute la région.
"Nous nous concentrerons sur le renforcement de la capacité des partenaires africains à promouvoir la stabilité et la sécurité régionales en permettant à des institutions de sécurité gouvernementales plus professionnelles, plus compétentes et plus responsables d'assurer la sécurité interne".
"Nous investirons également dans les efforts locaux de prévention et de consolidation de la paix afin d'atténuer et de traiter les vulnérabilités, en utilisant la loi bipartisane sur l'instabilité mondiale dans les zones côtières d'Afrique de l'Ouest et au Mozambique".
Les États-Unis donneront la priorité aux ressources de lutte contre le terrorisme afin de réduire la menace que les groupes terroristes font peser sur les États-Unis eux-mêmes, leur population et leurs cibles diplomatiques et militaires, en ne dirigeant des capacités unilatérales que là où elles sont légitimes et où la menace est la plus aiguë.
"Nous travaillerons principalement avec, avec et par l'intermédiaire de nos partenaires africains, en coordination avec nos principaux alliés, de manière bilatérale et multilatérale, afin de poursuivre des objectifs communs de lutte contre le terrorisme et de promouvoir des approches civiles et non cinétiques lorsque cela est possible et efficace".
"Dans le cadre de cette approche, nous utiliserons des programmes spéciaux pour renforcer la capacité des agences partenaires locales de sécurité, de renseignement et de justice à identifier, perturber, désorganiser et partager des informations sur les terroristes et les réseaux qui les soutiennent".
Si Washington va soutenir les soi-disant "groupes marginalisés" représentant des tas de sodomites locaux ou influençant délibérément les récits sur les relations entre personnes de même sexe, cela va clairement vers l'ingérence dans les affaires intérieures des États.
Sur le plan de la sécurité, on se demande également qui et quoi l'armée américaine va soutenir.
Il convient de noter ici que le Pentagone fait désormais activement campagne pour que les entreprises privées de défense américaines investissent dans des technologies de pointe et des projets énergétiques pour l'armée africaine par le biais d'un fonds spécial, Prosper Africa, sous les auspices du gouvernement américain [ii].
Le Commandement pour l'Afrique du Pentagone, qui est responsable du continent, possède des bases et des installations dans un certain nombre de pays. Il existe également des cellules de la CIA dans la région, ainsi que des employés d'autres agences qui collectent et traitent divers types d'informations. Sans parler des représentants de sociétés militaires privées, au moins la tristement célèbre structure Eric Prince, qui, après les scandales en Irak, s'est engagée activement dans ses affaires rien qu'en Afrique.
Quant aux alliés des États-Unis, il existe déjà une initiative mondiale d'infrastructure et d'investissement au sein du G7, pour laquelle il était prévu d'allouer 600 milliards de dollars. Les États-Unis semblent pousser leurs partenaires à poursuivre leurs propres intérêts. Cette initiative est liée au projet Prosper Africa déjà mentionné, ainsi qu'à d'autres - Power Africa et Feed the Future. En outre, les États-Unis espèrent transformer numériquement l'Afrique grâce à leurs entreprises informatiques.
Sur le troisième point, Washington essaie de lancer des projets économiques spécifiques, bien que certains d'entre eux, encore une fois, s'inscrivent dans les deux premiers objectifs. Car la création de communautés économiques inclusives va de pair avec la diffusion de la démocratie (telle que la conçoivent les États-Unis). Le rétablissement après la pandémie du coronavirus et la sécurité alimentaire sont soulignés. Il est intéressant de noter que d'autres maladies répandues et dangereuses en Afrique subsaharienne ne sont pas du tout mentionnées dans la stratégie.
Nous pouvons en conclure que la mention des covidés est de nature routinière et qu'en réalité, les États-Unis ne se préoccupent pas du tout du système de santé des pays africains. Il faut dire que de nombreux États africains ont des taux de mortalité assez élevés et précoces, y compris la mortalité infantile. Mais la Maison Blanche se contente d'escamoter la question, promettant dans l'abstrait le bien-être futur.
Enfin, le quatrième point s'inscrit dans la lignée des précédents. Il s'agit du partenariat des États-Unis avec les gouvernements africains, la société civile et les communautés locales pour soutenir et gérer les écosystèmes naturels qui permettront de réduire les émissions de carbone et de contrôler le changement climatique. Les États-Unis ont deux programmes à cet effet : le Plan américain de conservation des forêts mondiales et le Programme régional pour l'environnement en Afrique centrale. Dans le même temps, Washington a l'intention de lancer un plan énergétique, bien qu'aucune précision ne soit donnée.
Il est à noter que la Chine est mentionnée quelques fois tandis que la Russie l'est sept fois. Il est clair que les Etats-Unis devront surtout faire face à la présence chinoise dans la région, car Pékin a depuis longtemps des projets d'infrastructure en Afrique, ainsi que des prêts qui ne sont pas encombrés de visées politiques manipulatrices et qui sont bien accueillis par les gouvernements locaux.
Bien sûr, en dehors des exhortations pathétiques énoncées dans la stratégie, il existe des intérêts américains objectifs et rationnels liés au fait que d'ici 2050, le nombre d'Africains devrait atteindre 25 % de la population mondiale. Cela signifie le plus grand marché de consommation et la plus grande force de travail. Si nous appliquons la loi des grands nombres, cela signifie la capacité intellectuelle et technologique.
L'Afrique possède également la deuxième plus grande superficie de forêt tropicale du monde et possède 30 % des minéraux les plus importants. En termes d'influence politique, l'Afrique subsaharienne dispose de 28 % des voix dans le système des Nations unies. La manipulation de ces votes semble cruciale pour Washington.
D'où cet intérêt stratégique pour les pays africains. Malgré l'instabilité de certains d'entre eux, les troubles politiques et l'incertitude, Washington veut mettre sa patte sur l'avenir du continent, alors qu'il a déjà été directement impliqué dans de nombreux projets destructeurs.
L'intérêt pour l'Afrique de la part de l'UE et des acteurs individuels de ce commonwealth, comme l'Allemagne et la France, est également remarquable. Paris a récemment perdu une partie de son influence, tandis que Berlin tente de promouvoir sa propre feuille de route, qui a les mêmes objectifs que ceux de Washington.
De manière révélatrice, la publication de la stratégie a coïncidé avec la tournée d'Anthony Blinken en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Ses déclarations étaient clairement anti-russes. En particulier, il a parlé négativement des activités des sociétés militaires privées russes au Mali et en République centrafricaine, qui aident beaucoup les gouvernements à établir la paix et la stabilité.
En outre, le secrétaire d'État américain s'est rendu en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République du Congo en juillet. Cela témoigne du travail systématique de Washington dans la région. Mais si Moscou est évoquée dans le contexte de la crise en Ukraine et de l'interaction des forces de sécurité, Pékin est une question plus ample pour la Maison Blanche.
Le fait est que la Chine est depuis de nombreuses années le premier partenaire commercial de l'Afrique, où le chiffre d'affaires commercial atteint 200 milliards de dollars par an. Plus de 10.000 entreprises chinoises sont présentes dans les pays africains. En 2020, le Fonds de développement des infrastructures de l'initiative "la Ceinture et la Route" d'un milliard de dollars a été créé, et deux ans plus tôt, un programme d'aide de 60 milliards de dollars à l'Afrique a été approuvé [iii].

Depuis 2011. La Chine a été l'un des principaux donateurs et investisseurs dans les projets d'infrastructure en Afrique et il est peu probable que les États-Unis rattrapent et dépassent rapidement Pékin à cet égard.
En outre, la Chine a précédemment payé les dettes d'un certain nombre de pays africains dans le cadre d'engagements internationaux, ce qui a été perçu positivement à la fois par les élites politiques et les sociétés africaines, malgré la propagande anti-chinoise occidentale accusant Pékin de mener des politiques néocoloniales et de s'endetter. Il n'existe aucun souvenir historique négatif d'une présence chinoise en Afrique et le propre passé de la Chine offre un espoir de développement aux pays africains également.
La Chine a également un intérêt direct dans la stabilité à long terme de l'Afrique, car environ un tiers du pétrole entrant dans l'Empire du Milieu est extrait et exporté depuis des pays africains (Soudan, Angola et Nigeria). Et environ 20 % supplémentaires du coton qui entre en Chine sont également d'origine africaine. Sans parler des autres produits - des fruits et légumes aux minéraux. Pékin s'efforcera donc activement de maintenir son influence.
L'intérêt pour l'implantation de bases militaires tient précisément à ces raisons. La stratégie du "collier de perles" de la Chine repose sur la Corne de l'Afrique, puis se poursuit par voie terrestre dans le Heartland africain.
En termes de cyberinfrastructure, la Chine met en œuvre le projet Digital Silk Road en Afrique. Ce projet est en grande partie mené par ZTE, qui a déjà obtenu des contrats d'une valeur de 2,7 milliards de dollars grâce à des prêts [iv]. Ce n'est pas une nouvelle pour Washington. Divers groupes de réflexion américains proches du gouvernement parlent depuis longtemps de l'influence croissante de la Chine en Afrique [v].
Cela dit, les évaluations concernant les intérêts américains ont varié. Par exemple, la RAND Corporation a noté dans une étude sur le sujet que "la Chine n'est pas nécessairement une menace stratégique pour les intérêts américains" [vi]. Mais sous l'administration de Donald Trump, la rhétorique anti-chinoise aux États-Unis a augmenté. Et bien que les démocrates aient été assez critiques envers Trump sur de nombreuses questions de politique étrangère, la ligne de confrontation avec Pékin s'est poursuivie.
Les groupes de réflexion américains continuent de développer des solutions différentes à de nombreux dossiers, de Taïwan aux relations bilatérales. L'Afrique n'est pas oubliée non plus. Dans le même temps, les critiques à l'égard de Pékin sont reprises par les satellites européens des États-Unis. Certains médias mondialistes continuent de colporter des mythes anti-Chine et de faire l'éloge des Etats-Unis.
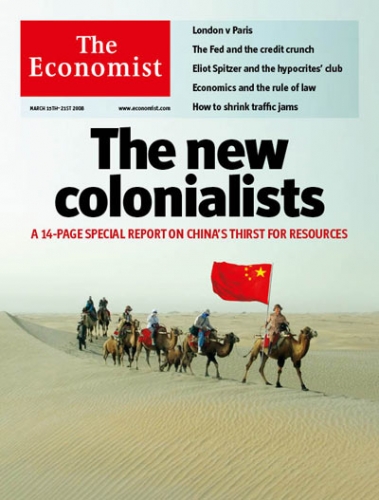
Par exemple, The Economist a écrit en mai 2022 que "la Chine fait preuve de plus d'audace dans ses relations avec l'Afrique. Xi Jinping et ses émissaires s'engagent régulièrement avec l'Afrique ; lors des sommets triennaux Chine-Afrique, les dirigeants chinois aiment promettre haut et fort de nouveaux fonds et programmes".
L'Amérique apporte une contribution précieuse à l'Afrique, mais de manière moins visible. Ses forces armées aident les gouvernements africains à lutter contre les groupes extrémistes. Elle a investi massivement dans l'amélioration de la santé publique en fournissant des vaccins contre le covid de fabrication occidentale qui fonctionnent mieux que les vaccins chinois (et sont gratuits).
En avril, l'administration a alloué plus de 200 millions de dollars d'aide à la Corne de l'Afrique en réponse à la crise alimentaire exacerbée par la guerre de la Russie en Ukraine. Il n'y a généralement rien de mal à faire connaître les efforts occidentaux pour soutenir la démocratie, qui reste la forme de gouvernement la plus populaire parmi les Africains. Et M. Biden devrait également se rendre en Afrique.
Une approche occidentale moins condescendante serait opportune. Les gouvernements africains n'attendent plus de la Chine des prêts énormes et des méga-projets. La condescendance de la Chine à l'égard de Vladimir Poutine et son approche punitive à l'égard de pays comme la Lituanie rappellent qu'elle aussi peut être une brute.
Depuis 20 ans, la Chine est le principal partenaire des gouvernements africains qui cherchent à transformer leurs économies. La plupart des politiciens africains et leurs citoyens ont apprécié les avantages découlant de cette relation. Mais se tourner vers la Chine a souvent été la seule option. L'Occident doit offrir une alternative" [vii].
En théorie, si l'Occident voulait établir son influence en Afrique, il devrait le faire. Mais le problème est que l'Occident ne peut offrir aucune alternative. La seule chose qu'il peut essayer de faire est d'investir davantage dans divers grands projets. Le fait est que si la Chine investit beaucoup, ce n'est pas beaucoup pour l'Afrique dans son ensemble, et il faut plus d'argent pour le développement des infrastructures [viii].
Mais il y a ici une question de conditions. L'Occident n'a pas l'habitude de donner de l'argent ou des prêts sans exigences politiques. De ce fait, les prêts chinois sont plus attractifs. En outre, il existe d'autres opportunités, comme la banque BRICS (où l'Afrique du Sud est l'un des membres de ce club) ou l'activité d'autres acteurs de la région, comme l'Iran et la Turquie.
Comprenant cela, les États-Unis ne sont pas susceptibles de concurrencer directement la Chine, mais ils essaieront d'occuper des niches vides et d'étendre leur présence là où ils ont une position crédible. Il est probable que parallèlement à cela, les États-Unis et leurs agents mèneront une guerre de l'information contre la Chine, vilipendant par tous les moyens possibles toute initiative de Pékin.
La probabilité d'utiliser la diaspora africaine vivant aux États-Unis est élevée. À tout le moins, cette option est indiquée dans la stratégie. Toutefois, même une action aussi limitée de Washington pourrait avoir des conséquences désagréables pour les pays africains, car elle limiterait leur souveraineté d'une manière ou d'une autre. Et l'enracinement de l'armée et des services de renseignement américains sous le prétexte de la sécurité menacera la stabilité de la région.
Notes:
[i] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/08/07/background-press-call-by-senior-administration-officials-previewing-the-u-s-strategy-toward-sub-saharan-africa/
[ii] https://www.prosperafrica.gov/
[iii] https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2019/10/03/what-china-is-really-up-to-in-africa/?sh=5eb7ba1f5930
[iv] https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/610844c1b59c8123f42a0c3e/1627931842061/PB+60+-+Tugendhat+and+Voo+-+China+Digital+Silk+Road+Africa.pdf
[v] https://www.csis.org/programs/africa-program/archives/china-africa
[vi] https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9760.html
[vii] https://www.economist.com/special-report/2022-05-28
[viii] https://www.fpri.org/article/2022/01/chinese-economic-eng...
18:50 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, affaires africaines, politique internationale, géopolitique, états-unis, chine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La compétition entre grandes puissances et l'escalade du conflit en Ukraine

La compétition entre grandes puissances et l'escalade du conflit en Ukraine
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/08/25/suurvaltakilpa-ja-ukrainan-kiihtyva-konflikti/
En examinant plus objectivement les événements des six derniers mois en Ukraine, il faut reconnaître que les dirigeants russes ont fait preuve d'une grande retenue en essayant de minimiser les dommages et les pertes civiles. La Russie aurait pu bombarder Kiev et la plupart des grandes villes pour les réduire en ruines dès février si elle le souhaitait.
Washington, pour sa part, est déterminé à intensifier la guerre contre Moscou, comme le montrent clairement les récents événements en Crimée, avec l'explosion d'engins ballistiques. Le monde est en train d'être redivisé et les objectifs de cette guerre vont bien au-delà de l'Ukraine. Le front de la guerre ne peut dès lors que s'étendre.
La guerre de l'information et diverses opérations sales vont tout aussi certainement augmenter. Les terroristes ukrainiens, comme de nombreux autres groupes opérant dans le monde, sont formés et armés par les services de renseignement américains et britanniques. En Finlande, Mika Aaltola, de l'Institut de politique étrangère, jubile déjà à l'idée de "porter la guerre en Russie".
En effet, l'Ukraine n'est pas seule : le régime de Zelensky ne prend pas ses propres décisions, mais travaille sous la stricte direction de l'Occident. Yahoo News a rapporté en mars que, depuis 2015, la CIA menait un programme de formation secret pour les forces spéciales et le personnel de renseignement ukrainiens afin de les préparer pour l'avenir.
Un ancien responsable de la CIA a déclaré sans ambages à l'époque que le programme avait appris aux Ukrainiens "comment tuer des Russes". Les États-Unis ont donc formé des Ukrainiens à des actes terroristes qui s'étendent au-delà de l'Ukraine. Nous en avons déjà vu un avant-goût : non seulement la journaliste Darya Dugina, mais aussi des fonctionnaires des régions russes d'Ukraine ont été assassinés à l'aide de voitures piégées.
Depuis la "révolution" de Kiev, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont armé et entraîné non seulement l'armée ukrainienne, mais aussi les forces paramilitaires. Ces programmes de formation ont été massivement développés ces dernières années. Leurs sinistres opérations sont planifiées et coordonnées non pas à Kiev mais à Washington et à Londres.
À ce stade, le prétexte de la "non-participation" des États-Unis à la guerre contre la Russie a déjà été abandonné, comme en témoigne la publicité donnée à l'aide américaine en armement et aux milliards déversés en Ukraine. Les reportages de guerre des médias impriment également les mêmes phrases et images d'une "guerre d'agression contre la Russie" dans l'esprit des masses, semaine après semaine et mois après mois.
Il est également révélateur que les médias occidentaux n'accordent aucun espace aux propositions de paix, mais se contentent de répéter que "la guerre contre la Russie doit être gagnée". Le président Sauli Niinistö, s'exprimant lors des Journées des ambassadeurs, a déclaré que le soutien de la Finlande à l'Ukraine se poursuivrait également "aussi longtemps que nécessaire". Slava Ukraini, a tweeté le Premier ministre Sanna Marin à l'occasion du jour de l'indépendance de l'Ukraine.
Mais on craint aux États-Unis que l'hiver prochain ne mette plus que jamais à l'épreuve le soutien européen à l'Ukraine. L'élite politique américaine ne semble pas se préoccuper des problèmes économiques et énergétiques de l'Europe, le pays hôte transatlantique reprochant vaguement à l'Europe la lassitude de la guerre.

Jusqu'à présent, le Kremlin a fait preuve d'une étonnante retenue dans sa réponse aux tentatives de Washington d'intensifier la guerre. L'administration Biden a hypocritement mis en garde contre le danger d'une troisième guerre mondiale, mais a elle-même délibérément franchi toutes les lignes rouges et n'a fait qu'aggraver le conflit.
Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a rendu encore plus clair le fait que les grandes puissances doivent tenir davantage compte de leur interdépendance. Dans un monde global, la sécurité et les dangers sont partagés. En élargissant l'OTAN et en incitant les pays de l'euro à entrer en guerre, les États-Unis ne font qu'alimenter le dilemme de la sécurité.
L'importance excessive accordée à la victoire ou à la défaite dans la compétition entre grandes puissances, la création artificielle de "menaces" et le fait d'attirer les pays voisins dans la course aux armements ne feront qu'exacerber l'environnement sécuritaire régional. Les retombées d'un conflit local peuvent être imprévisibles. Pour couronner le tout, une partie des armes lourdes envoyées par l'Occident en Ukraine a déjà été vendue à des criminels et des terroristes sur le marché noir.
C'est précisément ce genre de réaction en chaîne de l'instabilité que visent les plans de Washington, afin que le déclin politique et économique ne se termine pas seulement aux États-Unis. L'hégémon devra éventuellement se retirer, mais avant cela, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour affaiblir les puissances rivales. À cette fin, l'Ukraine, la Finlande et de nombreux autres pays ne sont que des pions à sacrifier.
18:16 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, ukraine, russie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 30 août 2022
Le désordre international conflictuel

Le désordre international conflictuel
Il sera très difficile pour la logique multilatérale d'avoir une chance.
Alberto Hutschenreuter*
Source : https://saeeg.org/index.php/2022/08/18/el-desorden-internacional-confrontativo/
L'état actuel des relations internationales est extrêmement préoccupant, car non seulement il n'existe aucune configuration qui assure une stabilité relative, mais le degré de discorde entre les centres prééminents nous laisse face à des scénarios qui n'excluent pas une détérioration majeure, face à laquelle le multilatéralisme, qui connaît sa plus profonde inutilité depuis les années 1990, ne pourra pratiquement rien faire, contrairement, d'ailleurs, à se qui s'est encore passé en avril 2009, lorsque, au lendemain de la crise financière de 2008, les dirigeants des principales puissances économiques réunis au sommet du G-20 à Londres ont adopté des mesures pour éviter une dépression majeure (selon l'ancien diplomate indien Shivshankar Menon, il s'agissait de "la dernière réponse cohérente du système international à un défi transnational").
Aujourd'hui, il y a un état de "non-guerre" entre l'Occident et la Russie, c'est-à-dire qu'il y a une confrontation ouverte entre la Russie et l'Ukraine, mais il y a aussi, au niveau supérieur ou stratégique de cette guerre, une confrontation indirecte entre la Russie et l'OTAN. Et peut-être sommes-nous prudents en disant "indirect", car lorsqu'on lit la récente vision stratégique de l'Alliance approuvée à Madrid et la conception navale russe plus récente, toutes deux montrent ces acteurs comme des "gladiateurs" sur le point de s'affronter (comme Thomas Hobbes concevait la prédisposition naturelle des États les uns envers les autres).
La guerre, les États et la discorde constituent les principaux éléments de l'équation des relations internationales. Et il est pertinent de le rappeler, car jusqu'avant la pandémie, malgré le climat international déjà endommagé par la guerre interne et internationale en Syrie depuis 2011 et les événements en Ukraine-Crimée en 2013-2014, les approches marquant le déclin de la violence humaine et même la dépréciation de la guerre entre centres prééminents étaient prédominantes.

Certains rapports réputés sont catégoriques par rapport à la contestation de ces approches. D'une part, les dépenses militaires : selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales en 2021 ont dépassé pour la première fois les deux mille milliards de dollars, atteignant la somme impressionnante de 2113 milliards de dollars, soit 0,7 % de plus qu'en 2020 et 12 % de plus qu'il y a dix ans.
D'autre part, selon le Global Peace Index 2022, un rapport annuel publié par l'Institute for Economics and Peace, le scénario international et intra-national est sombre et inquiétant en raison de multiples conflits ouverts : le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus instable et violent qu'il y a trois décennies. Le GEM utilise 23 indicateurs et trois axes pour mesurer le niveau de paix des États : le niveau de sécurité de la société, l'ampleur des conflits nationaux et internationaux en cours, et la militarisation des États. Selon cette étude, en 2021, les plus grandes détériorations ont concerné les relations entre pays voisins, l'intensité des conflits internes, le nombre de populations déplacées, l'ampleur de la terreur politique et l'instabilité politique. Depuis des lieux qui affirmaient naguère le cours presque invariable du monde vers une gouvernance centrée sur la galaxie des mouvements sociaux et l'éveil d'une nouvelle conscience mondiale animée par des questions thématiques qui perturbaient l'action individuelle et enracinaient l'effort concerté, l'anarchie n'était pas seulement dépassée, mais reflétait une mise en évidence "pathologique" (et donc "éternisante" au sens "tragique" que cela implique pour la réflexion théorique et la performance politique internationale) de l'absence d'autorité centrale parmi les États.

Eh bien, les cas de l'Ukraine et de Taïwan-Chine (plus les nombreux autres qui ont eu lieu au cours des années 2020 et 2021, les "années pandémiques") nous indiquent que l'anarchie, la guerre (sa conséquence la plus risquée) et la rivalité sont toujours en vigueur et que, de plus, il n'y a aucune raison de croire que la situation, au-delà de la pertinence de questions telles que l'environnement ou les technologies avancées, connaîtra un changement d'échelle. Il faut ajouter à cela que la pandémie, qui n'impliquait aucune menace d'une nation à l'autre, n'a pas donné naissance, au-delà des déclamations, à un nouveau système de valeurs coopératives ou à une nouvelle gouvernance fondée sur "l'humanité d'abord".
Il règne donc un désordre international, une situation qui, bien que défavorable à la sécurité et à la stabilité entre les États, constitue néanmoins une "régularité" dans les relations internationales. Mais ce qui est inquiétant, c'est le niveau de confrontation et de rivalité entre les acteurs. Une telle situation n'existe plus depuis longtemps, car après la "longue paix" du régime de la guerre froide (1945-1991), puis le "régime de la mondialisation" (1992-1998) et enfin l'hégémonie américaine (2001-2008), les relations internationales, notamment après les événements d'Ukraine-Crimée (2013-2014), se sont progressivement enfoncées dans un état de plus en plus hostile, sans qu'aucune de leurs puissances prééminentes ne fasse l'effort d'imaginer des schémas ou des techniques qui fourniraient de nouveaux biens publics pour un fonctionnement moins précaire de ces relations.
Le fait est que l'hostilité et la discorde n'impliquent aucun équilibre ni aucune modération, même dans le désordre. Nous revenons ici à Shivshankar Menon, déjà cité, qui vient d'avertir que tous les acteurs prééminents, même ceux des couches moyennes et aussi les institutionnalistes (comme l'Allemagne), présentent ce que l'on pourrait appeler un "comportement révisionniste" ; c'est-à-dire que chacun poursuit ses propres fins au détriment de l'"ordre" international et tente de changer la situation. Selon leurs propres termes : "De nombreux pays sont mécontents du monde tel qu'ils le voient et cherchent à le changer à leur avantage. Cette tendance pourrait conduire à une géopolitique plus mesquine et plus litigieuse et à des perspectives économiques mondiales moins bonnes. Faire face à un monde de puissances révisionnistes pourrait être le défi déterminant des années à venir".

En outre, le manque d'ordre implique déjà un manque de ce que l'on appelle des "tampons de conflit", c'est-à-dire des logiques d'influence de la part des puissances qui peuvent empêcher le déclenchement de confrontations entre des puissances moindres ; une situation de désordre conflictuel implique non seulement un tel manque stratégique, mais pourrait déclencher de dangereux conflits dormants ou latents qui existent dans diverses parties du monde, au-delà de ceux qui existent sur des "plaques géopolitiques" sensibles.
En bref, les relations internationales se sont détériorées au cours des presque 10 dernières années. La pandémie n'a créé aucune forme de coopération accrue entre les États (au contraire, elle a servi d'élément factuel qui a renforcé la méfiance). Sous Xi, la Chine est entrée dans un cycle de plus grande affirmation de soi au niveau national, tout en se fixant pour objectif de devenir une puissance à part entière entre 2035 et 2050. Les États-Unis sont prêts à jouer un rôle basé sur une nouvelle primauté ou un modèle étranger offensif.
La Russie est entrée en guerre pour empêcher l'Occident, par le biais de l'OTAN, de consommer une victoire finale ou une "paix carthaginoise" avant elle. L'Union européenne a peut-être compris qu'il ne suffit pas d'être une puissance institutionnelle (l'Allemagne a modifié la ligne classique de sa politique de défense tournée vers l'extérieur). Une nouvelle dynamique de blocs géostratégiques et géoéconomiques semble se dessiner dans la zone Indo-Pacifique. Le Japon a augmenté de manière significative ses dépenses militaires, tout en reprenant les pulsions d'affirmation nationale autrefois promues par Shinzo Abe, récemment assassiné.
Comme si cela n'était pas assez inquiétant, les acteurs dotés de l'arme nucléaire ne font aucun effort pour progresser vers des accords visant à réglementer ce secteur ; au contraire, il ne reste pratiquement plus de zones pour étendre (ou plutôt rétablir) l'équilibre, alors que pratiquement tous améliorent leurs capacités.
Dans ce cadre, il sera très difficile pour la logique multilatérale d'avoir une chance, sauf dans des cas très spécifiques. Par conséquent, si les deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, n'en viennent pas d'abord à une confrontation ou à une querelle majeure à la suite d'un incident ou d'une provocation américaine (une puissance qui décide d'une orientation extérieure basée sur "la tentation de la primauté", comme l'appelle Robert Kagan qui en fait la promotion), peut-être que le cours du monde vers un bipolarisme sino-américain pourrait donner forme à l'esquisse d'un ordre international, précaire, mais un ordre tout de même. Un "G-2" compétitif et conflictuel, certes, mais aussi avec une coopération minimale. L'expérience montre que les systèmes bipolaires ont tendance à être plus stables que les systèmes multipolaires.
Une accélération de la démondialisation économique et de la délocalisation technologico-industrielle pourrait également inciter, notamment les Etats-Unis, à la provocation. Mais même l'interdépendance économique ne garantit pas l'inhibition des conflits.
Par conséquent, un tel régime éventuel à deux bases n'est une possibilité que sous forme de conjecture, rien de plus. Ce qui est inquiétant, c'est qu'au-delà de cette conjecture, rien d'autre n'est en vue, du moins pour l'instant.
* * *

À propos de l'auteur :
* Doctorat en relations internationales (USAL). Il a été professeur à l'UBA, à l'Escuela Superior de Guerra Aérea et à l'Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Membre et chercheur de la SAEEG. Son dernier livre, publié par Almaluz en 2021, s'intitule "Ni guerra ni paz. Une ambiguïté troublante".
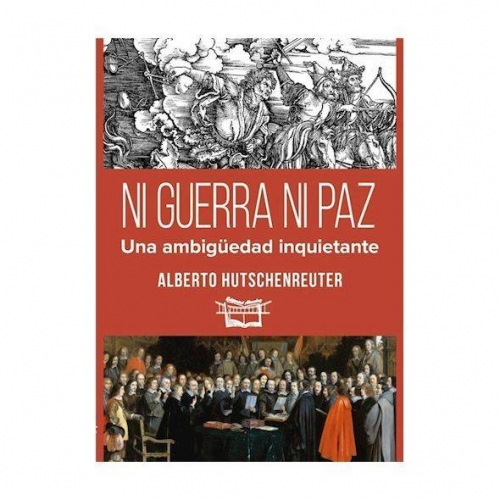
©2022-saeeg®
19:20 Publié dans Actualité, Géopolitique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, ordre international, relations internationales, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 août 2022
Allemagne: l'ex-inspecteur général Harald Kujat exhorte le gouvernement fédéral à placer enfin les intérêts allemands au centre de ses préoccupations!

Allemagne: l'ex-inspecteur général Harald Kujat exhorte le gouvernement fédéral à placer enfin les intérêts allemands au centre de ses préoccupations!
Source: https://zuerst.de/2022/08/23/ex-generalinspekteur-kujat-mahnt-bundesregierung-endlich-deutsche-interessen-in-den-mittelpunkt-stellen/
Berlin. L'ancien inspecteur général de l'armée allemande et président du comité militaire de l'OTAN, le général à la retraite Harald Kujat, a de nouveau critiqué avec force la politique ukrainienne du gouvernement allemand. Dans une tribune publiée par le journal allemand Preußische Allgemeine Zeitung, Kujat prédit que l'Allemagne sera la grande perdante du conflit.
En effet, "le gouvernement fédéral soutient l'Ukraine dans une mesure bien trop considérable en lui octroyant des aides financières, en lui livrant des armes et des équipements militaires ainsi qu'en imposant des sanctions à la Russie, qui entraînent pour les citoyens allemands des charges financières et économiques croissantes ainsi que des restrictions dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Les dommages à long terme pour l'économie allemande, en particulier les conséquences de l'état d'urgence énergétique prévu pour l'automne, et les effets sur sa compétitivité ne peuvent être évalués jusqu'à présent que de manière rudimentaire", constate Kujat. Dans le même temps, les livraisons d'armes excessives à l'Ukraine "continuent de 'piller' les capacités déjà extrêmement limitées de la Bundeswehr à remplir sa mission constitutionnelle de défense du territoire et de l'alliance".
Dans ce contexte, l'ex-général rappelle au gouvernement fédéral son "devoir le plus noble d'éviter tout dommage à l'Allemagne" et met en garde avec insistance contre une escalade de la guerre, qui pourrait également être provoquée par de nouvelles livraisons d'armes allemandes à Kiev.
Le tableau complet comprend également "le fait que le peuple ukrainien se bat pour les intérêts géostratégiques des Etats-Unis dans la rivalité avec les deux autres grandes puissances, la Russie et la Chine".
L'Ukraine ne peut pas gagner la bataille militairement, ce qui rend encore plus douteux le bien-fondé des livraisons d'armes allemandes. Le "tribut payé par les forces armées ukrainiennes est extrêmement élevé en raison de la conduite statique des opérations, qui ne fait que retarder les gains de terrain russes. Les combats de retardement sont menés dans les espaces urbains et les grandes villes, comme l'a récemment enquêté Amnesty International, sans tenir compte de la population civile".
En revanche, la Russie n'a jusqu'à présent "même pas été proche d'une défaite militaire", tandis que l'Ukraine "n'est pas en mesure de reconquérir la Crimée ou le Donbass".
Dans ce contexte, Kujat fait également référence aux voix de plus en plus fortes aux Etats-Unis qui indiquent un changement de cap de la politique américaine en Ukraine. Dans ce contexte, il est tout à fait irresponsable de la part du gouvernement allemand de s'engager sans alternative dans une politique de soutien aveugle à Kiev. Il est donc "temps que le gouvernement fédéral reconnaisse les signes du temps et place les intérêts sécuritaires, stratégiques et économiques de notre pays au centre de sa politique, donnant ainsi des signaux à toute l'Europe et s'affirmant de la sorte face aux grandes puissances". (st)
Demandez ici un exemplaire de lecture gratuit du magazine d'information allemand ZUERST ! ou abonnez-vous ici dès aujourd'hui à la voix des intérêts allemands: https://zuerst.de/abo/ !
Suivez également ZUERST ! sur Telegram : https://t.me/s/deutschesnachrichtenmagazin
17:47 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, allemagne, harald kujat, affaires européennes, ukraine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 août 2022
L'interconnexion de la BRI et de l'INSTC complètera le puzzle eurasien
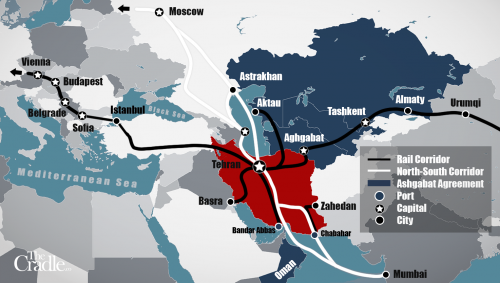
L'interconnexion de la BRI et de l'INSTC complètera le puzzle eurasien
Pepe Escobar
Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/un-puzzle-eurasiatico-linterconnettivita-bri-e-instc-completera-il-puzzle
Interconnecter l'Eurasie intérieure est un acte d'équilibre taoïste : ajouter une pièce à la fois, patiemment, à un puzzle géant. Cela demande du temps, des compétences, une vision et, bien sûr, de grandes découvertes.
Récemment, en Ouzbékistan, une pièce essentielle a été ajoutée au puzzle en renforçant les liens entre l'initiative "Belt and Road" (BRI) et le corridor international de transport Nord-Sud (INSTC).
Le gouvernement de Mirzoyev à Tachkent est profondément engagé à stimuler un autre corridor de transport d'Asie centrale : un chemin de fer Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan-Afghanistan.
Cette question était au centre d'une réunion entre le président du conseil d'administration de Temir Yullari - les chemins de fer nationaux ouzbeks - et ses homologues du Kirghizstan et d'Afghanistan, ainsi que des cadres de la société logistique chinoise Wakhan Corridor.

En ce qui concerne l'intersection complexe du Xinjiang avec l'Asie centrale et du Sud, il s'agit d'une initiative révolutionnaire, qui fait partie de ce que j'appelle la guerre du corridor économique.
Les Ouzbeks ont présenté de manière pragmatique le nouveau corridor comme essentiel pour le transport de marchandises à des tarifs réduits - mais cela va bien au-delà de simples calculs commerciaux.
Imaginez, en pratique, des conteneurs de marchandises arrivant par train de Kashgar, dans le Xinjiang, à Osh, au Kirghizstan, puis à Hairatan, en Afghanistan. Le volume annuel devrait atteindre 60.000 conteneurs rien que la première année.
Cela serait crucial pour développer le commerce productif de l'Afghanistan, loin de l'obsession de l'"aide" comme au temps de l'occupation américaine. Les produits afghans pourraient enfin être facilement exportés vers les voisins d'Asie centrale et aussi vers la Chine, par exemple vers le marché dynamique de Kashgar.
Et ce facteur de stabilisation renforcerait les coffres des talibans, maintenant que les dirigeants de Kaboul sont très intéressés par l'achat de pétrole, de gaz et de blé russes à des prix très avantageux.
Comment faire revenir l'Afghanistan dans le jeu
Cette voie ferrée pourrait également donner lieu à un projet routier qui traverserait le corridor ultra-stratégique de Wakhan, ce que Pékin envisage depuis quelques années déjà.
Le Wakhan est partagé par le nord de l'Afghanistan et la région autonome de Gorno-Badakhshan au Tadjikistan: une longue bande géologique aride et spectaculaire qui s'étend jusqu'au Xinjiang.
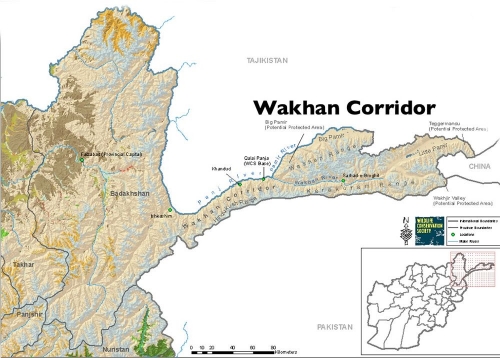
Il est désormais clair non seulement pour Kaboul, mais aussi pour les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), que les Américains humiliés ne rendront pas les milliards de dollars "confisqués" des réserves de la Banque centrale afghane - ce qui permettrait au moins d'atténuer la crise économique actuelle et la famine de masse imminente en Afghanistan.
Le plan B consiste donc à renforcer les chaînes d'approvisionnement et de commerce de l'Afghanistan, actuellement dévastées. La Russie prendra en charge la sécurité de l'ensemble du carrefour de l'Asie du Sud et du Centre. La Chine fournira la majeure partie du financement. Et c'est là qu'intervient le chemin de fer Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan-Afghanistan.
La Chine voit la route à travers le Wakhan - une proposition très compliquée - comme un autre corridor BRI, se connectant au Pamir Highway au Tadjikistan, repavée par la Chine, et aux routes du Kirghizstan, reconstruites par la Chine.
L'Armée populaire de libération (APL) a déjà construit une route d'accès de 80 km depuis la section chinoise de la route du Karakoram - avant qu'elle n'atteigne la frontière avec le Pakistan - jusqu'à un col de montagne dans le Wakhan, actuellement accessible uniquement aux voitures et aux jeeps.
La prochaine étape pour les Chinois serait de continuer sur cette route pendant 450 km jusqu'à Fayzabad, la capitale provinciale du Badakhshan afghan. Cela constituerait le couloir routier de réserve pour le chemin de fer Chine-Asie centrale-Afghanistan.
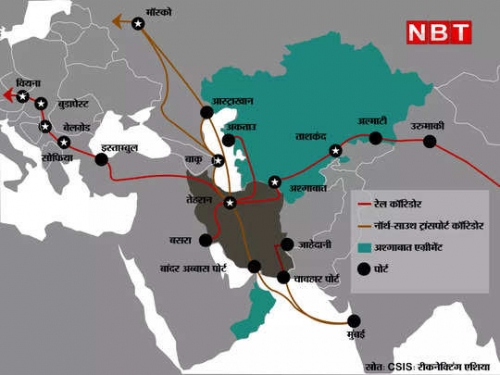
Le point essentiel est que les Chinois, ainsi que les Ouzbeks, comprennent parfaitement la position extrêmement stratégique de l'Afghanistan: non seulement en tant que carrefour entre l'Asie centrale et l'Asie du Sud, relié aux principaux ports maritimes du Pakistan et de l'Iran (Karachi, Gwadar, Chabahar) et à la mer Caspienne via le Turkménistan, mais aussi en aidant l'Ouzbékistan enclavé à se connecter aux marchés d'Asie du Sud.
Tout ceci fait partie du labyrinthe des couloirs de la BRI; et en même temps, il se croise avec l'INSTC en raison du rôle clé de l'Iran (lui-même de plus en plus lié à la Russie).
Téhéran est déjà engagé dans la construction d'une voie ferrée vers Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan (il a déjà reconstruit la route). De cette façon, l'Afghanistan sera inclus à la fois dans la BRI (dans le cadre du Corridor économique Chine-Pakistan, CPEC) et dans l'INSTC, ce qui donnera une impulsion à un autre projet: un chemin de fer Turkménistan-Afghanistan-Tadjikistan (TAT), qui sera relié à l'Iran et donc à l'INSTC.
Du Karakoram à Pakafuz
La route du Karakoram - dont la partie nord a été reconstruite par les Chinois - pourrait tôt ou tard avoir une consœur ferroviaire. Les Chinois y réfléchissent depuis 2014.
En 2016, une voie ferrée reliant la frontière Chine-Pakistan à Gilgit, dans les régions du nord, et descendant ensuite jusqu'à Peshawar, avait été incluse dans le projet de corridor économique Chine-Pakistan (CPEC). Mais rien ne s'est passé: le chemin de fer n'a pas été inclus dans le plan à long terme 2017-2030 du CPEC.
Cela pourrait se produire au cours de la prochaine décennie : l'ingénierie et la logistique constituent un énorme défi, comme ce fut le cas pour la construction de la route du Karakorum.
Et puis il y a l'aspect "suivre l'argent". Les deux principales banques chinoises qui financent les projets de l'IRB - et donc le CPEC - sont la China Development Bank et l'Export Import Bank. Même avant la crise sanitaire, ils réduisaient déjà leurs prêts. Et avec la crise sanitaire, ils doivent maintenant équilibrer les projets étrangers avec les prêts nationaux pour l'économie chinoise.
Au lieu de cela, la priorité en matière de connectivité s'est déplacée vers le chemin de fer Pakistan-Afghanistan-Ouzbékistan (Pakafuz).

La section clé de Pakafuz relie Peshawar (la capitale des zones tribales) à Kaboul. Une fois achevé, nous verrons la ligne Pakafuz interagir directement avec le futur chemin de fer Chine-Asie centrale-Afghanistan : un nouveau labyrinthe BRI directement relié à l'INSTC.
Tous ces développements révèlent leur réelle complexité lorsque nous voyons qu'ils font simultanément partie de l'interaction entre la BRI et l'INSTC et de l'harmonisation entre la BRI et l'Union économique eurasienne (UEEA).
En substance, en termes géopolitiques et géoéconomiques, la relation entre les projets BRI et EAEU permet à la Russie et à la Chine de coopérer à travers l'Eurasie, tout en évitant une course à la domination dans le Heartland.
Par exemple, Pékin et Moscou sont tous deux d'accord sur la nécessité primordiale de stabiliser l'Afghanistan et de l'aider à gérer une économie durable.
Parallèlement, certains membres importants de la BRI - comme l'Ouzbékistan - ne font pas partie de l'EAEU, mais cela est compensé par leur adhésion à l'OCS. Dans le même temps, l'entente BRI-EEA facilite la coopération économique entre les membres de l'UEE tels que le Kirghizstan et la Chine.
Pékin a en effet obtenu l'approbation totale de Moscou pour investir en Biélorussie, au Kazakhstan, au Kirghizstan et en Arménie, tous membres de l'UEE. L'EAEU, dirigée par Sergei Glazyev, et la Chine discutent conjointement d'une future devise ou d'un panier de devises excluant le dollar américain.
La Chine se concentre sur l'Asie centrale et occidentale
Il ne fait aucun doute que la guerre par procuration qui se déroule en Ukraine entre les États-Unis et la Russie crée de sérieux problèmes pour l'expansion de la BRI. Après tout, la guerre des États-Unis contre la Russie est aussi une guerre contre le projet BRI.
Les trois principaux corridors de l'IRB du Xinjiang vers l'Europe sont le Nouveau pont terrestre eurasien, le Corridor économique Chine-Asie centrale-Asie occidentale et le Corridor économique Chine-Russie-Mongolie.
Le nouveau pont terrestre eurasien utilise le chemin de fer transsibérien et une deuxième liaison qui traverse le Xinjiang-Kazakhstan (via le port continental de Khorgos) puis la Russie. Le corridor qui traverse la Mongolie est en fait deux corridors : l'un va de Beijing-Tianjin-Hebei à la Mongolie intérieure puis à la Russie ; l'autre va de Dalian et Shenyang puis à Chita en Russie, près de la frontière chinoise.


Actuellement, les Chinois n'utilisent pas le pont terrestre et le corridor mongol autant que par le passé, principalement en raison des sanctions occidentales contre la Russie. L'accent actuel de la BRI est mis sur l'Asie centrale et l'Asie occidentale, avec une branche bifurquant vers le golfe Persique et la Méditerranée.
Et c'est ici que nous voyons un autre niveau d'intersection très complexe se développer rapidement: la manière dont l'importance croissante de l'Asie centrale et de l'Asie occidentale pour la Chine se mêle à l'importance croissante de la CIST pour la Russie et l'Iran dans leur commerce avec l'Inde.
Appelons-le le vecteur amical de la guerre des couloirs de transport.
Le vecteur dur - la guerre réelle - a déjà été mis en place par les suspects habituels. Ils sont, comme on peut s'y attendre, déterminés à déstabiliser et/ou à détruire tout nœud d'intégration BRI/INSTC/EAEU/SCO en Eurasie, par tous les moyens nécessaires: en Ukraine, en Afghanistan, au Baloutchistan, dans les "stans" d'Asie centrale ou au Xinjiang.
En ce qui concerne les principaux acteurs eurasiens, il s'agit d'un train anglo-américain qui ne mène nulle part.
Publié dans The Craddle
22:10 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bri, instc, eurasie, eurasisme, chine, afghanistan, ouzbékistan, pakistan, russie, iran, corridors économiques, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 août 2022
Un politologue hongrois: l'Allemagne craint plus les Etats-Unis que la Russie

Un politologue hongrois: l'Allemagne craint plus les Etats-Unis que la Russie
Source: https://contra24.online/2022/08/ungarischer-politologe-deutschland-fuerchtet-die-usa-mehr-als-russland/
Pour le politologue hongrois Zoltán Kiszelly, il est clair qu'à Berlin, on a plus peur de Washington que de Moscou. C'est pourquoi, selon lui, les Allemands ont cédé à la pression des Américains pour sanctionner Nord Stream 2.
Les Allemands font face à une crise énergétique de grande ampleur en raison de leur décision de céder à la pression américaine et de fermer le gazoduc Nord Stream 2 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré Zoltán Kiszelly, un politologue et directeur de l'influent Centre d'analyse politique de la Fondation Századvég, basé en Hongrie.
M. Kiszelly a déclaré à la chaîne d'information hongroise Origo que le chancelier allemand Olaf Scholz, lorsqu'il était ministre des Finances, avait tout fait pour que Nord Stream 2 puisse être mis en service. Cependant, en tant que chancelier, Scholz a changé de cap. Selon M. Kiszelly, si les Allemands avaient agi intelligemment et maintenu Nord Stream 2 ouvert, ils ne seraient pas dans la situation où ils se trouvent aujourd'hui. Au lieu de cela, ils auraient eu une énergie bon marché et une grande partie de leurs problèmes auraient été résolus immédiatement.
L'Allemagne a actuellement un gouvernement majoritairement de gauche, composé des sociaux-démocrates, des libéraux du Parti libéral-démocrate et du Parti vert. Leur projet d'imposer une taxe sur le gaz, qui pèserait sur les ménages allemands et affecterait l'industrie, suscite de vives critiques. M. Kiszellly se demande pourquoi les coûts sont répercutés sur les consommateurs allemands et non sur les importateurs de gaz. Il a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi le gouvernement allemand choisissait une telle voie. Non seulement cette surtaxe sur le gaz touchera durement les consommateurs, mais ils devront également payer la TVA sur cette taxe, selon la Commission européenne.

Selon le politologue hongrois, le gouvernement allemand tente de faire payer aux citoyens du pays les pertes subies par les marchands de gaz, ce qui signifie que la famille moyenne allemande devra payer en moyenne 300 à 400 euros de plus cette année. Il s'agit clairement d'un transfert de charges sur la population allemande, et tout cela dans le cadre d'une politique encouragée par le gouvernement de gauche.
Les Allemands supplient désormais les Russes de leur fournir plus de gaz, avec un débit réduit à 20% de la moyenne. Si les Allemands rouvraient Nord Stream 2, le prix du gaz baisserait drastiquement, ce qui réduirait les revenus des Russes provenant d'une augmentation du prix du gaz. Selon M. Kiszelly, les Allemands cèdent à la pression des Américains pour fermer Nord Stream 2 parce qu'ils ont plus peur des Américains que des Russes.
Il a également fait référence au plan "Fit for 55" de la Commission européenne, qui vise à réduire les émissions de carbone de 55% d'ici 2030. Ce plan pourrait avoir un impact dramatique sur les entreprises européennes, et la situation actuelle concernant les combustibles fossiles comme le charbon illustre la situation difficile dans laquelle l'Europe s'est placée. Kiszelly souligne que les Polonais, les Tchèques et les Allemands tentent de remplacer le charbon russe par du charbon colombien, sud-américain et australien expédié depuis l'autre bout du monde, ce qui augmente les émissions de carbone en cours de route.
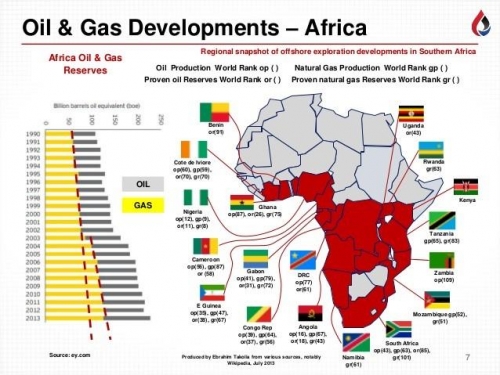
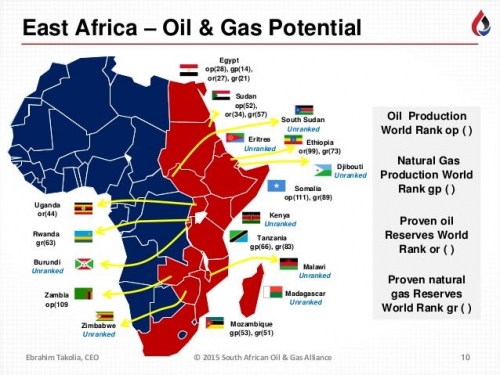
En contrepartie, l'Afrique produit également de plus en plus de pétrole et de gaz, ce qui augmentera l'importance du continent pour la sécurité énergétique de l'Europe. Cela peut aider temporairement, mais étant donné que la Commission européenne prévoit d'éliminer complètement les énergies fossiles d'ici 2050 au plus tard, ce n'est pas un modèle durable et les Africains ne peuvent pas compter dessus à long terme. C'est aussi ce que disent les Qataris et les Norvégiens. Ainsi, Scholz s'est récemment rendu en Norvège pour discuter avec les Norvégiens de l'exploitation de nouveaux gisements de gaz en mer du Nord, mais la Norvège souhaite atteindre la neutralité climatique dès 2030, ce qui est donc une exigence irréaliste.
Les solutions proposées pour installer davantage de raffineries de pétrole et de terminaux GNL sont également problématiques. Avant de pouvoir rentabiliser les investissements dans de tels projets de construction gigantesques, les pays de l'UE doivent cesser d'importer de grandes quantités de pétrole et de gaz afin de réaliser la transition verte.
Néanmoins, les capacités sont déjà engagées et les Norvégiens ne peuvent pas produire plus, tandis que les Arabes et l'OPEP+ ne veulent augmenter la production que de manière minimale afin de maintenir les prix de l'énergie à un niveau élevé, sachant qu'ils ne pourront plus vendre autant d'ici 10 à 15 ans. Selon Kiszelly, il est même logique pour eux de maximiser leurs profits maintenant, alors que les Européens sont dans l'urgence.
15:12 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : énergie, pétrole, gaz, gaz naturel, russie, allemagne, europe, politique internationale, sanctions, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Comparer la Chine et la Russie - Le pouvoir de l'idéologie ou le pouvoir du nihilisme?

Comparer la Chine et la Russie - Le pouvoir de l'idéologie ou le pouvoir du nihilisme?
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/08/13/kiina-ja-venaja-vertailussa-ideologian-vai-nihilismin-valta/
Comme nous le rappelait Branko Milanović, économiste serbo-américain, en janvier 2013, Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine et président de la Commission militaire centrale, a prononcé un discours intéressant devant les membres du Comité central du Parti (traduction anglaise ici: https://redsails.org/regarding-swcc-construction/).
Le discours a été évoqué en Occident pendant des années par la suite, notamment dans le contexte de la volonté d'épouvanter en permanence en évoquant l'autoritarisme du régime chinois et de la décision de Xi d'éradiquer de la Chine ce qu'il appelle le "nihilisme historique", un courant corrosif qui pourrait menacer la vitalité du Parti et les intérêts nationaux.
Dans son discours, Xi remet en question les doutes des commentateurs nationaux et étrangers quant à savoir si la voie de la Chine est encore socialiste. Certains ont appelé le modèle actuel de la Chine "capitalisme social", d'autres "capitalisme d'État" ou "capitalisme technocratique". Selon Xi, ce sont toutes des interprétations complètement erronées.
Le "socialisme aux caractéristiques chinoises" reste fidèle à l'idée, par laquelle Xi signifie que, malgré les réformes, le régime chinois s'en tient au socialisme, à sa théorie, à son système et aux objectifs fixés par le Congrès national du Parti.
Il s'agit notamment de "la construction d'une économie de marché socialiste, d'une politique socialiste-démocratique, d'une culture socialiste avancée, d'une harmonie civile et écologique socialiste, du développement humain, de la réalisation progressive d'une prospérité commune pour tous les peuples, d'un État moderne socialiste riche, fort, démocratique et harmonieux, sous la direction du Parti communiste".
Parmi les autres points notables du discours de Xi, citons son interprétation de la fin de l'Union soviétique et son insistance sur l'importance de l'idéologie. Sans une base idéologique solide, un gouvernement d'État instable commettra des erreurs désastreuses, qui pourraient même conduire à l'effondrement. C'est ce qui est arrivé à l'ancienne superpuissance du socialisme, l'Union soviétique, qui a officiellement cessé d'exister le 25 décembre 1991.
Pour Xi, la cause de l'effondrement de l'Union soviétique et de la disparition de son parti communiste est le "nihilisme idéologique": les classes dirigeantes ne croyaient plus aux avantages et à la valeur du système, mais n'avaient pas d'autres coordonnées idéologiques dans lesquelles inscrire leur pensée.

Pourquoi l'Union soviétique et son parti communiste se sont-ils effondrés ? Le rejet complet de l'expérience historique soviétique, le rejet de l'histoire du parti et le rejet de Lénine et de Staline ont plongé l'idéologie soviétique dans le chaos et le nihilisme historique que Xi craint.
Elle a rendu les organisations du parti à tous les niveaux presque inopérantes. Elle a privé le parti de son leadership sur l'armée. Finalement, le parti communiste soviétique - aussi grand qu'il ait été - a éclaté, entraînant avec lui la fédération socialiste.
Le manque de confiance dans le système était dû à l'échec de l'Union soviétique dans la vie économique et à son incapacité à créer un système de prise de décision participatif qui aurait séduit ou aurait été acceptable pour la majorité de la population. Les racines de l'effondrement étaient donc à la fois économiques et idéologiques.
Le président chinois Xi affirme que lorsqu'un parti perd le contrôle idéologique et est incapable de fournir une explication satisfaisante de sa propre gouvernance, de ses objectifs et de ses buts, il s'effondre en un parti d'individus aux liens lâches, unis uniquement par des ambitions personnelles, des aspirations à la richesse et au pouvoir.
Le parti est alors dominé par le "nihilisme idéologique". Le pire résultat - que Xi crain pour la Chine - est que le pays soit pris en charge par des personnes qui n'ont aucune idéologie, mais un désir totalement cynique et égoïste de régner. C'est ce qui s'est passé en Russie dans les années 1990, où les "nihilistes idéologiques" du KGB ont pris le contrôle du pays, avec l'aide des Américains.
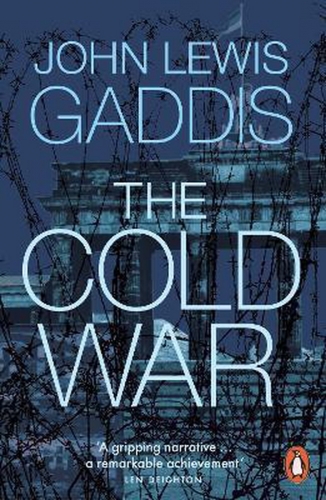
Les nihilistes idéologiques du KGB étaient considérés à l'Ouest comme de meilleurs gouvernants que les communistes, qui avaient plus de principes. John Lewis Gaddis, le cynique historien américain de la guerre froide, dans The Cold War : A New History, considérait Lavrenti Beria comme "le seul dirigeant soviétique digne d'éloges avant Gorbatchev" parce que Beria était "totalement impartial sur le plan idéologique et prêt à servir n'importe quel régime tant qu'il restait lui-même en piste".
Dans les derniers jours de l'Union soviétique, les membres du KGB étaient considérés comme les seuls à pouvoir maintenir un certain ordre et faire tourner les roues de l'économie. C'est pourquoi le chef du KGB, Youri Andropov, a été élu secrétaire général du parti communiste - un renversement total de la soumission traditionnelle de l'appareil de renseignement au parti.
La dépendance à l'égard des services de renseignement s'est répétée dans les dernières années du gouvernement d'Eltsine, lorsque quatre de ses cinq premiers ministres avaient des liens avec le KGB (il s'agissait de Primakov, Stepashin, Kirienko et enfin Poutine). Le vide intellectuel a permis l'ascension au pouvoir de pragmatiques sans principes, que Xi décrit comme des "nihilistes idéologiques".
Sous Poutine, le vide idéologique a été comblé par le nationalisme et l'orthodoxie conservateurs - sans oublier l'islam domestique, le judaïsme et le bouddhisme. Poutine a également critiqué la culture politiquement extrémiste du déni du réel et du libéralisme débridé de l'Occident, mais la politique économique de la Russie contemporaine est toujours capitaliste, et non socialiste.
L'accent superficiel mis sur les caractéristiques externes du pouvoir de l'État conduit de nombreux commentateurs politiques occidentaux à parler de l'"autocratie" de Xi et de Poutine, comme s'ils étaient exactement de la même espèce. Le discours de Xi montre que les dirigeants de la Chine et de la Russie contemporaine ne sont pas si semblables.
La différence entre les administrations d'État chinoise et russe est que la Chine a cherché à préserver le pouvoir hégémonique de l'idéologie communiste et à contrôler ainsi les différents organes du pouvoir (tels que l'armée et la police), tandis qu'en Russie, l'idéologie politique a été remplacée par le pragmatisme et la géopolitique du pouvoir (bien sûr, l'administration d'État avec ses différentes branches du pouvoir contrôle toujours les différents organes de la société).
Les commentateurs enthousiastes de la chute de l'Union soviétique aimaient à penser que la fin du communisme entraînerait l'épanouissement de la démocratie libérale partout. Cependant, l'exportation américaine, la démocratie fumeuse et impérialiste, n'a conduit qu'à ce que Xi décrit comme un "nihilisme idéologique" et une politique de pouvoir qui a consolidé le pouvoir de l'oligarchie, sans aucun égard pour le peuple.
Le président chinois est, à mon avis, quelque peu correct dans ses affirmations. S'il n'y a pas de recherche systématique d'une société meilleure et de tentative d'élever le niveau de vie de la population, il ne reste que l'intérêt personnel de la classe dirigeante et une politique opportuniste et à courte vue qui mènera tôt ou tard le pays à la ruine.
La Russie aussi a besoin d'une idéologie d'État viable, mais les pragmatiques des groupes de pouvoir ne peuvent pas en créer une (parce qu'ils ne croient pas aux idéologies ?). Si, après Poutine, la Russie est dirigée par quelqu'un comme l'actuel premier ministre, le technocrate Mikhail Mishustin, le "nihilisme idéologique" qui a conduit à l'effondrement de l'Union soviétique se poursuivra.
Si la montée en puissance de la Chine n'est pas inversée et que le socialisme devient un contrepoids politique globalement attrayant au libéralisme toxique de l'Occident, peut-être les communistes pourront-ils jouer un plus grand rôle dans le futur gouvernement russe ? Un mélange russe de socialisme et de nationalisme pourrait mieux fonctionner dans une grande puissance qu'une imitation du libéralisme économique occidental.
Les communistes russes marquent également des points, du moins à mes yeux, car ils ont résisté au fascisme sanitaire de ces dernières années, contrairement au parti au pouvoir, Russie Unie, qui ressemble à une coalition. Il serait souhaitable que la Chine abandonne elle aussi sa stratégie de taux d'intérêt zéro, mais il se peut que des besoins de politique étrangère et de sécurité se cachent derrière ce plan d'action et soient tenus secrets pour le public.
S'il avait le choix, dans la crise mondiale actuelle, le monde préférerait avoir une idéologie socialiste nationaliste plus axée sur le peuple qu'un nihilisme libéral-capitaliste et technocratique dont les objectifs ne font que promouvoir la tyrannie socio-économique d'une petite puissance supranationale.
14:49 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : actualité, politique internationale, chine, russie, asie, affaires asiatiques, xi jinping |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 août 2022
Tous sous le parapluie de l'OTAN, exposés au déluge universel

Tous sous le parapluie de l'OTAN, exposés au déluge universel
par Marcello Veneziani
Source : Marcello Veneziani & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/tutti-sotto-l-ombrello-della-nato
La lutte électorale en Italie s'annonce comme une course pour savoir qui est le plus aligné sur l'OTAN et qui est le plus tourné vers l'Atlantique, à genoux comme vers la Mecque : droite et gauche, centre gauche et centre droit se disputent l'uniforme et la livrée de ses soldats ou de ses grooms, sans la moindre dissidence, distinction ou retenue. Et pourtant, si nous devions juger à la lumière de nos intérêts géopolitiques et stratégiques réels, les expériences historiques de ces dernières années, les effets de certaines positions récentes de l'OTAN, les profils très modestes des dirigeants occidentaux, les cultures qui inspirent le soi-disant modèle euro-atlantique, et enfin l'opinion publique italienne et européenne elle-même, qui est tout sauf favorable à cet enracinement, il y aurait énormément de place pour remettre en question l'aplatissement militaire et militant devant les ukases de l'OTAN, sans si et sans mais, dont font montre la politique et les pouvoirs qui l'animent. On ne peut pas non plus accorder le moindre crédit à la ligne grilliste de Conte, qui, en tant que premier ministre, s'est couché comme un paillasson devant les puissances euro-atlantiques et qui cherche maintenant à embobiner les récalcitrants.
Commençons par l'argument le plus fort en faveur de la ligne pro-OTAN : les menaces chinoise et russe et le danger islamique ne nous permettent pas de "baisser la garde" (une expression obsessionnelle, héritée de la pandémie, qui nous réduit à des chiens de garde ou à des gardes permanents par des agents médicaux et de sécurité). Je ne sais pas dans quelle mesure le parapluie de l'OTAN nous protège de ces menaces et dans quelle mesure il nous y expose. Si le parapluie de l'OTAN nous a protégés des dangers et des guerres, dans combien de dangers et combien de guerres nous a-t-il entraînés ces dernières années ? Les tensions avec le monde islamique, l'infiltration dans les soulèvements des pays arabes, l'éternelle crise palestinienne, l'implication dans de malheureuses aventures guerrières, même près de nous, de la Serbie et du Kosovo à la Libye, maintenant les tensions avec la Russie, la Chine et la moitié du monde asiatique... Combien de haine envers l'Occident et envers nous avons-nous accumulé avec l'interventionnisme militaire de l'OTAN, en suivant servilement les politiques musclées et hégémoniques des États-Unis ?

Depuis longtemps, nous subissons les effets dramatiques des interventions militaires de l'OTAN dans le monde : en termes de flux migratoires incontrôlés et d'islamisation croissante et de haine anti-occidentale, mais aussi en termes de crises économiques et sociales et d'approvisionnement en énergie, d'entreprises militaires coûteuses et de détournement de ressources pour faire face aux effets des politiques interventionnistes dans tant de régions du monde. De plus, cette ligne ne sert même pas à étendre l'influence de notre civilisation et de ses traditions: au contraire, partout où l'on arrive avec la force des armes, des réactions opposées se déclenchent, des traditions, des coutumes, des attitudes et des religions antithétiques à l'Occident sont redécouvertes dans une fonction antagoniste. Avec l'OTAN, la civilisation occidentale n'est pas protégée, mais les biens, la technologie et la liberté sont exportés sous une forme ou une autre de nihilisme. Et autant nous sommes aplatis par l'OTAN, autant nous avons honte de nos racines occidentales. Pas la Kultur mais la Zivilisation, comme l'ont dit Thomas Mann et plus tard Oswald Spengler ; c'est-à-dire l'expansion de notre mode de vie et de nos moyens économiques et technologiques, mais sans une culture nourrie par un fondement civil, moral et religieux.

L'OTAN a pu avoir du sens lorsqu'il y avait une bipolarité mondiale entre deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS ; et elle avait un sens lorsque la mondialisation coïncidait avec l'occidentalisation du monde. Mais depuis quelque temps, ce scénario a changé. Les superpuissances mondiales ont été contournées et entourées par d'autres puissances hégémoniques comme la Chine et des superpuissances technologiques et démographiques comme l'Inde, par de grands pays non alignés comme l'Iran, le Brésil, l'Afrique du Sud, et par des poudrières ingouvernables comme l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est. Sans un Roi du Monde, une Puissance Universelle, aucun Empire du Bien et aucune alliance militaire ne peut s'ériger en gardien, arbitre et dépositaire du monde, sauf au prix de conflits douloureux, coalisant le ressentiment de tous contre l'Occident. Cela est confirmé par les effets de la position de l'OTAN et des États-Unis en Ukraine.
Dans ce contexte, il serait beaucoup plus profitable pour l'Europe de se désengager de cette logique de l'Occident contre le reste du monde, et d'esquisser sa propre politique étrangère autonome de confrontation avec le monde au-delà de l'Occident, qui comprend également l'endiguement des visées hégémoniques ou expansionnistes des autres et aussi un "protectionnisme" intelligent de notre économie par rapport aux invasions inconsidérées des biens et des technologies des autres. Trump avait deviné la même chose lorsqu'il a essayé de désengager les États-Unis de leur rôle de gendarme du monde, il n'a pas initié de guerres et de bombardements, il a même traité avec des dictateurs individuels et des puissances mondiales avec un visage dur, mais sans s'arroger le rôle d'empereur du monde. Lui, qui était si enthousiaste, avait les pieds sur terre à cet égard, bien plus que son prédécesseur et que son calamiteux successeur. Les mobilisations armées servent non seulement à exercer un impérialisme moral sur le monde, mais aussi à polariser le consensus en faveur des présidents en exercice, et à disposer des besoins de l'industrie de guerre.
L'autre folie de l'Occident dirigé par l'OTAN est de s'aventurer dans ce genre de guerre semi-froide avec l'Asie russo-chinoise sans leadership ferme, clairvoyant et unifié. La précaire administration Biden est incapable de tenir le fort de l'Occident ; l'Europe n'est plus celle de Kohl et de Mitterrand, mais pas non plus celle de Merkel ; l'Angleterre, depuis qu'elle a perdu Boris Johnson, est sans leadership. Si vous appelez l'Occident, qui répond? Seulement les dirigeants de l'OTAN ?
En bref, si c'est le parapluie qui doit nous protéger, nous sommes exposés au déluge universel. Mais dans la campagne électorale italienne actuelle, tout le monde joue des fanfares pour l'OTAN et jure fidélité éternelle à la Mecque de l'Atlantique...
18:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, otan, atlantisme, occidentalisme, marcello veneziani, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Etats-Unis: la folie de répéter les mêmes erreurs encore et encore

Etats-Unis: la folie de répéter les mêmes erreurs encore et encore
Source: https://piccolenote.ilgiornale.it/57287/usa-la-follia-di-ripetere-sempre-gli-stessi-errori
"L'hégémonie américaine est toujours vivante. Et les spécialistes des soins intensifs tentent toujours de réanimer le patient moribond. Sa famille et ses amis disent qu'il lutte toujours. Cependant, les fossoyeurs de cet ordre à l'agonie sont déjà arrivés et se trouvent juste derrière la porte : l'un s'appelle Russie et l'autre Chine". C'est ainsi que commence un article amusant, mais toutefois très intelligent, de Jim Fitzgerald dans Antiwar, dont nous citons de larges extraits.
La Force vous rendra libre
Comme l'a observé John Mearsheimer, écrit Fitzgerald, le moment unipolaire qui a suivi la chute de l'ancienne Union soviétique a été une période absolument unique dans l'histoire. À ce moment-là, et pour les 30 années suivantes, l'Amérique était la seule superpuissance encore debout. La vision de Thomas Woodrow Wilson de démocratiser le monde s'est avérée une tentation irrésistible pour les élites guidant la politique étrangère occidentale. Les évangélistes de ce nouvel ordre mondial ont donc entrepris de répandre la démocratie dans toute l'Asie orientale, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord".
"Ils ont utilisé l'architecture basée sur les institutions nées pendant la guerre froide (l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce) pour diffuser les valeurs libérales et 'associer tout le monde au capitalisme'."
"Aveuglés par leur propre idéalisme, ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un puisse refuser une offre aussi généreuse. Après tout, comme le président George W. Bush s'en est souvent vanté, "la liberté est dans le cœur de chaque individu". En d'autres termes, si l'occasion lui était offerte, chacun choisirait naturellement d'être libre. Cette idée est un écho au dicton du président Wilson : "Le monde doit être rendu sûr par la démocratie [c'est moi qui souligne]".
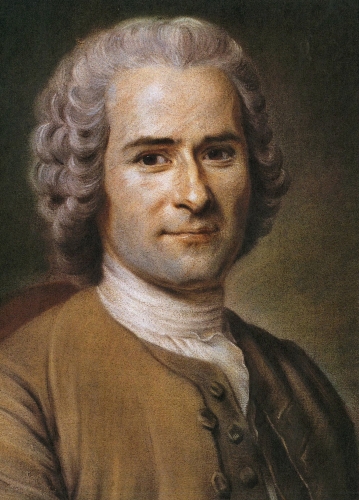
"La doctrine Wilson, cependant, doit être interprétée à la lumière du penseur français Jean-Jacques Rousseau. Rousseau affirmait que "l'homme naissait libre, mais que partout il était enchaîné". Cependant, pour Rousseau, la condition humaine est telle que les hommes ne sont pas toujours conscients de ce qui est bon pour eux. Par conséquent, ils doivent être forcés à être libres par d'autres qui savent mieux qu'eux. Comme le disait Rousseau, "Celui qui refuse d'obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps ; cela signifie simplement qu'il sera forcé d'être libre".
"Aucune phrase plus précise n'a jamais été écrite pour décrire l'essence de la politique étrangère américaine de l'après-guerre froide. L'Amérique s'est constamment consacrée à la mission violente de forcer les hommes à être libres; pourtant, ils restent enchaînés".
L'Amérique de la guerre et du gouvernement
"Il suffit de regarder l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, le Yémen et l'Iran pour constater les échecs de la politique étrangère américaine. De plus, les élites qui dirigent la politique étrangère américaine semblent paradoxalement enhardies par leurs échecs car elles tentent les mêmes politiques usées en Ukraine et à Taiwan."
"La visite de la vice-présidente Pelosi à Taïwan et la lettre de Mitch McConnell et de 25 autres sénateurs en faveur de son initiative sont le dernier exemple en date de la politique basée sur la provocation inhérente à l'ordre libéral."
"Il devrait être évident pour quiconque prête attention qu'au lieu de prévenir les guerres, l'hégémonie américaine en crée là où il n'y en a pas. En effet, l'Amérique a été en guerre tout au long de l'ère unipolaire, et Pelosi, et d'autres avec elle, semblent vouloir encore provoquer une autre guerre."
"Mais les choses changent et changent vite. La Russie n'est plus la nation faible et anémique qu'elle était il y a 30 ans, et la Chine n'est plus le pays pauvre qu'elle était après la Seconde Guerre mondiale. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a alerté le projet hégémonique américain et dévoilé les objectifs expansionnistes d'institutions comme l'OTAN".
"C'est pourquoi presque tous les responsables politiques étrangers en poste à Washington, les dirigeants des institutions internationales et les groupes de réflexion deviennent apoplectiques. Leur ordre s'effondre et leurs décisions et actions semblent être dictées par le désespoir."
"Malheureusement, il n'y a aucun signe que ces politiciens soient prêts à changer de cap. Ils sont des exemples vivants de la définition de la folie d'Einstein : "Faire la même chose encore et encore et s'attendre à des résultats différents". Ils semblent totalement incapables de sortir d'un état d'esprit qui, en termes de politique étrangère, a déjà fait son temps".
Fitzgerald conclut donc en expliquant que la seule issue est de revenir à une politique étrangère basée sur le réalisme dans le cadre d'un équilibre des forces entre les puissances.

Kissinger, la diversité des valeurs et le sens des limites
Dans une interview récente, Kissinger expose les deux règles de base d'un tel réalisme. Premièrement, "l'acceptation de la légitimité de valeurs parfois contradictoires. En fait, si vous croyez que le but ultime de toutes vos actions doit être l'imposition de vos valeurs, alors l'équilibre, à mon avis, devient impossible". Règle d'or très peu respectée.
L'autre règle "est l'équilibre dans le comportement, ce qui signifie qu'il y a des limites à l'exercice de ses compétences et de son pouvoir par rapport à ce qui est indispensable à l'équilibre général". Un tel sens des limites est hors de l'horizon de la politique étrangère américaine, une conséquence de l'illusion de toute-puissance qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique.
L'ébranlement des certitudes antérieures conduit l'Amérique à agir à l'instinct, poursuit Kissinger, sans vision stratégique ; cela amène le monde au bord d'une guerre avec la Russie et la Chine "sur des questions que nous avons en partie créées nous-mêmes, sans idée claire de la façon dont cela va se terminer".
Une situation d'autant plus difficile que le fondement du dialogue, outil indispensable à la recherche de compromis, a été perdu. En fait, explique Kissinger, les Américains voient "les négociations en termes missionnaires [...] en essayant de convertir ou de condamner leurs interlocuteurs au lieu d'approfondir et de comprendre leur mentalité".
Une leçon politique qui explique parfaitement la folie et les risques du moment.
17:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, états-unis, bellicisme américain, hégémonie américaine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 août 2022
Nouvelle géopolitique, créer le G10 + 2

Nouvelle géopolitique, créer le G10 + 2
Rodolfo Sanchez Mena
Source: https://www.geopolitika.ru/es/article/nueva-geopolitica-crear-g102
Nous allons analyser d'un point de vue géopolitique la création du G10 qui regrouperait le Mexique, le Brésil, l'Indonésie, la Turquie, l'Inde et l'Iran, l'Argentine, le Venezuela, l'Afrique du Sud, le Nigeria + la Chine-Russie.
Le changement géopolitique que connaît le monde prendrait une nouvelle physionomie avec la création du G10+2 avec les pays non alignés et le Sud global, alliés à la Chine et à la Russie, afin de multiplier le potentiel des puissances intermédiaires et avec cette constellation réaliser un nouveau monde où règneront la paix, la prospérité et le bien-être des peuples du monde.
Le G10+2 rassemble des puissances moyennes d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Elle possède la plupart des ressources stratégiques du monde. Pour l'essentiel, les membres du G10+2 ont développé une culture très riche, avec une tradition d'humanisme et de solidarité. Ils disposent d'énergie, de mines, de ressources alimentaires, d'eau, pour les transformer en bien-être et en richesse généralisés afin de libérer les êtres humains de l'esclavage du travail salarié. La création du G-10+2, avec la Chine et la Russie, consoliderait le monde multipolaire, ce serait la fin du monde unipolaire et de sa stratégie de domination néolibérale.
Afin de maintenir la domination hégémonique et la déprédation de ces ressources et fondamentalement pour arrêter la nouvelle géopolitique qui se profile à l'horizon avec la création de ce G10+2, deux sommets ont été organisés, celui du G7 et celui de l'OTAN en Espagne.

En termes géopolitiques, le G7 réunit sept pays qui ont déjà perdu leur hégémonie mondiale, avec en tête les États-Unis et leur allié nord-américain, le Canada, et les Européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, et le seul pays asiatique, le Japon.
Cinq pays stratégiques, l'Argentine, l'Inde, l'Indonésie, le Sénégal et l'Afrique du Sud, participaient à la deuxième session du G7 en tant qu'invités stratégiques, dans le but de bloquer la création du G10+2. Le président de l'Argentine, Alberto Fernández, était le seul représentant de l'Amérique latine, des Caraïbes et des Antilles. Et le seul gouvernement qui soutient les sanctions contre la Russie. L'Inde, l'Indonésie, le Sénégal et l'Afrique du Sud s'abstiennent d'imposer des sanctions. Le président Fernández, face à la guerre énergétique déclenchée contre la Russie, a proposé à l'Europe les ressources stratégiques que possède son pays comme alternative d'approvisionnement et de baisse des prix: "Nous avons les deuxièmes réserves de gaz de schiste et les quatrièmes réserves de pétrole de schiste du monde".
L'importance de la présence du président indonésien Joko Widodo, un rôle clé pour le G7, puisqu'il assure la présidence tournante du G20, le groupe qui réunit les grandes puissances et les puissances émergentes, dont fait toujours partie la Russie.
Il est important de noter que l'Inde et l'Afrique du Sud font toutes deux partie des BRICS. L'Argentine et l'Iran ont demandé à rejoindre les BRICS, ce qui consolidera et élargira la participation de l'Iran dans la région de l'Amérique latine.
Le président français Macron appelle le Venezuela et l'Iran à réintégrer le marché du pétrole pour contrer les prix et les pénuries de pétrole de Poutine. Le Venezuela et l'Iran sont tous deux des alliés de la Russie et de la Chine. Les Européens reconnaissent Juan Guaydo comme le président du Venezuela nommé par les États-Unis. Le président vénézuélien Maduro s'est rendu en Iran pour renforcer les accords géostratégiques.
Le président iranien Seyed Ebrahim Raisi a reçu le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. "Raisi a déclaré que le renforcement de la coopération est un moyen efficace de lutter contre les sanctions américaines et l'unilatéralisme économique contre les pays indépendants... Lavrov a également déclaré que la Russie soutient le rôle de l'Iran dans les organismes internationaux et régionaux, y compris l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS)". Point important étant donné l'insistance à vouloir que l'OCS rejoigne les BRICS.
Biden arrive au sommet du G7 à son pire moment, nous dit Bloomberg. Ses partenaires européens craignent une défaite électorale de Biden lors des élections de novembre. "Le chancelier allemand Olaf Scholz... voit en Biden une force motrice pour maintenir la pression sur Moscou et pense que l'unité entre les alliés pourrait s'effilocher une fois de plus si les républicains remportent à nouveau la Maison Blanche en 2024."
Les Français voient des conséquences à court terme de la défaite de Biden "Plusieurs dirigeants du G-7 s'inquiètent du fait qu'une défaite à mi-parcours limitera ce que Biden peut promettre et réaliser dans les mois à venir, selon un haut fonctionnaire du gouvernement français...".
Un débat inconfortable sur le soutien à l'Ukraine émerge rapidement. "Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été l'allié le plus engagé de Biden sur l'Ukraine, a abordé la question dans un article d'opinion... dans le journal italien Corriere della Sera..."
"Sous la surface, des approches différentes de la crise ukrainienne émergent parmi les pays occidentaux : la crainte que les Européens ne poussent à une solution négociée rapidement ?" écrit Johnson. "Il y a un risque de lassitude vis-à-vis de l'Ukraine dans le monde. Et c'est clair."
En réponse à la lassitude exprimée par Johnson, "Biden a nié cette semaine que la fatigue s'installe, mais a reconnu qu'"il va y avoir un peu de jeu d'attente : ce que les Russes peuvent soutenir et ce que l'Europe va être prête à soutenir."

Le sommet de l'OTAN en Espagne devrait ouvrir un nouveau front de guerre dans les 10 pays qui composent la région du Sahel : Sénégal, Gambie, Mauritanie, Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cameroun et Nigeria.
Un conflit prolongé en Ukraine, où même les États-Unis n'ont pas l'intention d'y mettre fin, couplé au scénario de guerre hybride de l'OTAN qui s'élargit au Sahel, avec les groupes fondamentalistes du Jihad islamique, est lié à la théorie spéculative visant à user Poutine et à provoquer sa chute. L'échec des sanctions contre la Russie et leur boomerang sur l'Occident incitent à accélérer le changement géopolitique.
Pour les pays d'Amérique latine, la création d'un G10+2 est le moyen de sortir des conséquences de la guerre en Ukraine, affirme Carlos Fernández-Vega dans sa chronique "Dinero", en analysant le diagnostic de la CEPALC. "Le conflit actuel, souligne la CEPALC, a accentué la tendance à une plus grande régionalisation des échanges et de la production que l'on observe depuis quelques années au niveau mondial. L'Amérique latine et les Caraïbes n'échappent pas à cette tendance, selon laquelle les pays recherchent une plus grande autonomie stratégique dans l'approvisionnement en produits et intrants clés".
C'est à cela que sert la nouvelle géopolitique en Amérique latine, en Asie et en Afrique avec la création du G10+2 ; une nouvelle stratégie en faveur de la paix, du bien-être et de la défense des ressources stratégiques, pour empêcher leur pillage et la promotion d'un nouveau colonialisme pour sauver Biden et le vieux monde du changement géopolitique mondial.
18:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, g7, g20, g10+2, amérique latine, amérique ibérique, amérique du sud, argentine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 12 août 2022
Vladimir Poutine et la multipolarité

Vladimir Poutine et la multipolarité
Shahzada Rahim
Source: https://katehon.com/en/article/vladimir-putin-and-multipolarity?fbclid=IwAR2UMAT3P9gJ-xk1DsIX1ZtybNBUUbMA4QjJUpUcClnSER6KfmUO4_tFCEA
Depuis son accession à la présidence russe, Vladimir Poutine a attiré l'attention des grands médias mondiaux pour deux raisons majeures. Premièrement, dans sa jeunesse, il a servi dans les services de renseignement soviétiques (KGB) et pendant la désintégration de l'Union soviétique, il était colonel au siège du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est. Cela signifie que le jeune dirigeant russe a des souvenirs éléphantesques de l'époque soviétique. Deuxièmement, après la chute de l'Union soviétique, le jeune Vladimir Poutine, qui est diplômé en droit et ancien officier du KGB, s'est retrouvé sans emploi pendant une brève période jusqu'à ce que le maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, le nomme au bureau, où il a d'abord servi en tant qu'officier junior avant de devenir maire adjoint. Ces deux expériences sont devenues la raison principale qui a attiré l'attention des grands médias mondiaux sur la personnalité obscure, mystérieuse et incompréhensible du jeune leader russe.
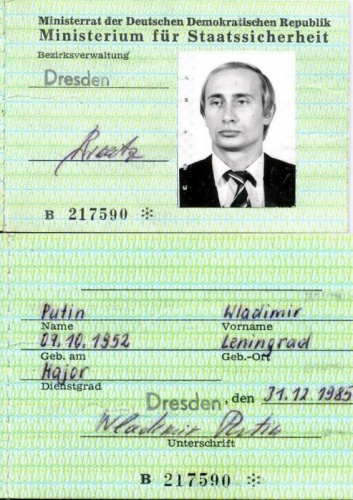
Au lendemain de l'attaque terroriste de septembre 2001, Vladimir Poutine est devenu le premier dirigeant mondial à se rendre aux États-Unis et a rencontré le président américain de l'époque, George W. Bush. Après une brève rencontre avec le jeune dirigeant russe, le président Bush a déclaré publiquement : "J'ai regardé l'homme dans les yeux. Je l'ai trouvé très franc et digne de confiance". Peut-être que la tentative du président Bush de sonder l'âme de Vladimir Poutine n'était pas une gaffe géopolitique, car dans ses décisions et sa défense des intérêts de la Russie, Vladimir Poutine s'est toujours montré franc et digne de confiance.
Néanmoins, ce n'est pas seulement dans la sphère politique que Vladimir Poutine a été mal compris et mal interprété, mais aussi dans la sphère géopolitique. Selon les mots du célèbre animateur de télévision russe et icône des médias mondiaux Vladimir Pozner, "Au cours des vingt dernières années, les dirigeants occidentaux ont mal compris Vladimir Poutine et, par conséquent, au cours de la même période, la façon dont Vladimir Poutine s'est présenté était le reflet même de la mentalité politique occidentale.
Si nous analysons la personnalité du dirigeant russe d'un point de vue géopolitique, il apparaît sans aucun doute comme un réaliste pragmatique complet qui considère toujours la "sécurité" de la Russie comme sa priorité absolue. Au cours des premières années de sa présidence, Vladimir Poutine a établi des relations étroites tant avec les États-Unis qu'avec ses voisins européens. Pour obtenir les garanties de sécurité des États-Unis et de ses alliés européens, la Russie a collaboré avec l'OTAN pour créer le Conseil OTAN-Russie en 2002. La tâche principale du Conseil OTAN-Russie était la recherche d'un consensus, la coopération et la consultation mutuelle sur les questions de sécurité. Il ne faut peut-être pas oublier ce geste pragmatique de Vladimir Poutine.

En outre, depuis les premiers jours de son mandat, Vladimir Poutine n'a cessé de partager les lignes rouges de la sécurité de la Russie avec les États-Unis et ses alliés de l'OTAN en Europe. Les experts en politique étrangère ont qualifié le pragmatisme de la politique étrangère de Poutine, celle d'une approche de la Russie face à son étranger proche, d'efficace jusqu'en 2004. Les préoccupations de la Russie en matière de sécurité ont commencé à s'aggraver lorsqu'un grand nombre d'États post-soviétiques d'Europe baltique et orientale ont rejoint l'Union européenne. Néanmoins, dès le début, la Russie a perçu l'expansion vers l'est de l'UE sous l'angle du dilemme de la sécurité et, par conséquent, lors de plusieurs rencontres internationales, Vladimir Poutine a remis en question la politique d'expansion vers l'est de l'UE. Ici, la montée en flèche des préoccupations sécuritaires de Poutine peut être mise en parallèle avec l'analyse du célèbre auteur géopolitique Tim Marshall. Selon Marshall, tout au long de l'histoire, la Russie a été prisonnière de sa géographie plate, vaste et trop étendue, où la "sécurité" est toujours restée l'obsession de ses dirigeants.
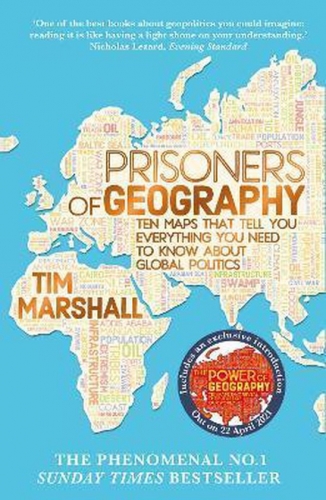
De même, la politique d'expansion vers l'est de l'UE, qui a débuté en 2004, est devenue le principal sujet de débat et de discussion parmi les élites politiques et sécuritaires russes. Les élites russes de la sécurité, en particulier, pensaient que l'expansion vers l'est de l'UE visait à ouvrir la voie à l'OTAN pour atteindre les frontières russes. Ainsi, de cette discussion est né un nouveau phénomène de sécurité, celui de "l'encerclement de la Russie", qui a fini par dominer la politique étrangère russe pour les années à venir. La plupart des élites politiques et de sécurité russes ont directement blâmé les États-Unis pour l'américanisation des politiques étrangères et de défense européennes. À cet égard, si quelqu'un veut comprendre le contexte du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, il doit étudier la transformation de la politique étrangère russe après 2004. En outre, l'année 2004 est importante pour deux raisons majeures.
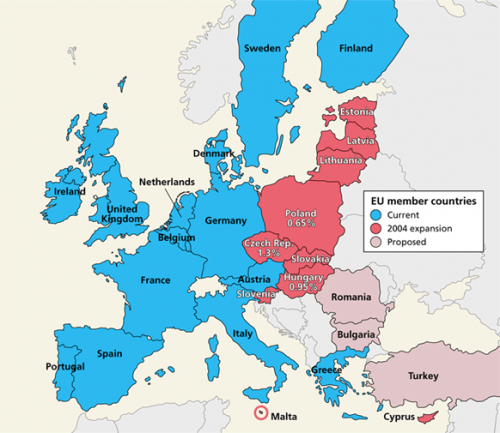
Premièrement, 2004 a marqué le début de l'expansion de l'UE vers l'est et donc des avancées de l'OTAN vers les frontières russes. Deuxièmement, au cours de ces mêmes années, les révolutions de couleur ont commencé dans l'espace post-soviétique, en commençant par l'Ukraine, dont la Russie pense qu'elles étaient parrainées par l'OTAN pour renverser les régimes favorables à la Russie. Ainsi, dans le sillage des révolutions de couleur, le terme "Sécurité de la sphère d'influence de la Russie" est devenu l'obsession majeure des élites politiques et sécuritaires russes.
Dans ce dernier contexte, si nous révisons la pensée géopolitique du président russe, alors, selon Poutine, la chute de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique du vingtième siècle qui a mis en péril la sécurité géopolitique de la Russie. C'est peut-être la raison pour laquelle, dès les premiers jours de son mandat, Vladimir Poutine a spéculé sur les problèmes de sécurité de la Fédération de Russie. Même, concernant les lignes rouges de la Russie, il a lancé un avertissement clair aux États-Unis et à ses alliés européens de l'OTAN lors de son discours à la Conférence sur la sécurité de Munich en 2007. Vladimir Poutine a déclaré : "le fait que nous soyons prêts à ne pas placer l'armée de l'OTAN en dehors du territoire allemand donne à l'Union soviétique une solide garantie de sécurité" - où sont ces garanties ? Ainsi, du point de vue géopolitique de Poutine, les Américains et leurs alliés européens ont éclipsé et méprisé les garanties de sécurité données à la Russie et ont permis à l'OTAN d'encercler la Russie, ce qu'il considère comme une promesse non tenue.
En tant que réaliste pragmatique, Vladimir Poutine estime que puisque l'Amérique et ses alliés européens ont rompu la promesse, la Russie a le droit naturel d'assurer sa sécurité dans l'espace post-soviétique. Par conséquent, les événements tels que la guerre avec la Géorgie (2008) et l'annexion de la Crimée (2014) n'étaient qu'un calme avant la tempête. À mon avis, ces événements ont été le signal d'alarme pour que l'OTAN abandonne son expansionnisme le long des frontières russes. Malheureusement, à l'Ouest, ces deux événements majeurs n'ont pas été reçus comme des avertissements majeurs ; au contraire, l'Ouest les a considérés comme une agression russe et un néo-impérialisme, ce qui est complètement hors de toute logique.
Selon Poutine, l'Occident doit respecter la Russie en tant que pôle distinct dans l'ordre international, aux côtés d'autres puissances mondiales émergentes comme la Chine et l'Inde. Selon Poutine, le moment unipolaire est terminé et l'état de droit international ne peut être renforcé et mis en œuvre que si l'Occident respecte la "sphère d'influence" de chaque pôle. En outre, la multipolarité émergente est réelle et l'Occident doit comprendre ce fait, s'il est un tant soit peu sérieux en matière de paix et de sécurité internationales.
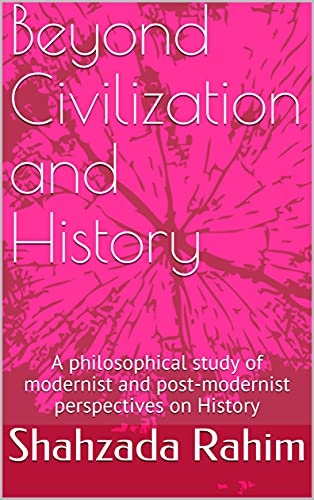
L'Auteur:
Shahzada Rahim est l'auteur du livre Beyond Civilization and History et un expert en géopolitique. Il est le rédacteur en chef du portail d'information The Eurasian Post.
22:27 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, vladimir poutine, géopolitique, politique internationale, multipolarité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 août 2022
Alice Weidel : "L'Ukraine aurait dû devenir neutre"

Alice Weidel : "L'Ukraine aurait dû devenir neutre"
Kiev aurait dû être encouragée à devenir un Etat neutre, affirme Alice Weidel dans un entretien.
Source: https://contra24.online/2022/08/alice-weidel-ukraine-haette-neutral-werden-muessen/
Alice Weidel, la présidente du parti Alternative pour l'Allemagne (AFD), a identifié l'erreur de l'Occident concernant l'Ukraine. Selon la politicienne, les alliés de Kiev auraient dû policer l'image de ce pays d'Europe de l'Est en l'encourageant à devenir Etat neutre au lieu de l'entraîner dans l'OTAN et l'UE.
Dans un entretien avec la ZDF publié dimanche, on a demandé à Mme Weidel pourquoi certains membres de l'AFD justifiaient l'offensive russe contre l'Ukraine ou même diffusaient de la "propagande du Kremlin". La chef de groupe de l'AFD a répondu : "Dans notre parti et notre groupe, il est indiscutable qu'il s'agit d'une guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, contraire au droit international".
Weidel a toutefois souligné qu'en considérant le conflit actuel dans ce pays d'Europe de l'Est, il ne fallait pas négliger le contexte historique des événements actuels. "L'intégration de l'Ukraine et les projets d'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN et l'UE sont, depuis des décennies, quelque chose que les Russes n'accepteront jamais", a précisé la politicienne allemande.
Moscou a toujours été clair sur le fait qu'il n'accepterait pas une "puissance adverse dans son arrière-cour", a-t-elle ajouté. Mme Weidel a ajouté que "l'Ukraine est une ligne rouge pour la Russie depuis des décennies". La chef de file de l'AFD a ajouté que l'Occident traitait ce sujet hautement sensible avec "insouciance" et qu'il avait commis une erreur en ne faisant pas de l'Ukraine un pays neutre.
Mme Weidel a souligné que son parti considérait le conflit actuel en Ukraine comme extrêmement dangereux, notamment pour l'Allemagne, qui n'est pas aussi éloignée des champs de bataille que les États-Unis. La politicienne a également mis en garde contre la résurgence d'une mentalité cherchant à reconstituer des blocs opposés, soit une situation similaire à celle de la guerre froide, la Russie et la Chine développant des relations de plus en plus étroites entre elles. Un tel scénario n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne, a déclaré la chef du groupe parlementaire AFD.

Fin mars, Steffen Kotré, membre du Bundestag de l'AfD, a affirmé que les États-Unis utilisaient l'Ukraine comme tête de pont pour déstabiliser la Russie. Si nous évoquons cela, nous devrions également parler des laboratoires biologiques qui sont dirigés contre la Russie", a déclaré le député - une allusion évidente aux affirmations de Moscou selon lesquelles les États-Unis auraient établi de telles installations secrètes dans le pays d'Europe de l'Est.

Le mois suivant, Tino Chrupalla, président et principal porte-parole de l'AfD, a parlé des "intérêts légitimes de la Russie en matière de sécurité", ajoutant que le conflit en Ukraine avait "plusieurs pères". Chrupalla a également demandé à plusieurs reprises que le gouvernement fédéral lève les sanctions contre la Russie, car elles affectent le plus les entreprises et les citoyens allemands, a déclaré le politicien de l'AfD.
Interrogée à nouveau sur les déclarations de certains membres de l'AfD, Mme Weidel a réaffirmé que le parti qualifiait l'intervention militaire de la Russie en Ukraine de "guerre d'agression contraire au droit international" et a ajouté : ceux qui tiennent publiquement des propos qui s'écartent de la ligne du parti seront traités "en interne". La politicienne a toutefois refusé d'entrer dans les détails concernant les conséquences auxquelles de tels membres du parti doivent s'attendre.
Pour plus de nouvelles et d'informations (sans censure Facebook), consultez notre chaîne Telegram (https://t.me/comagde) et notre groupe de discussion Telegram (https://t.me/+sydNkheo8hdiN22ZI). Vous pouvez également nous rendre visite sur Gettr.com (https://gettr.com/user/contra24).
17:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, ukraine, allemagne, afd, alice weidel, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



